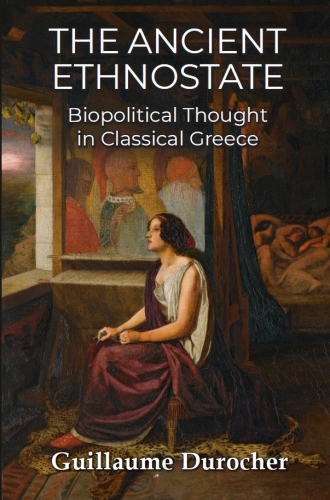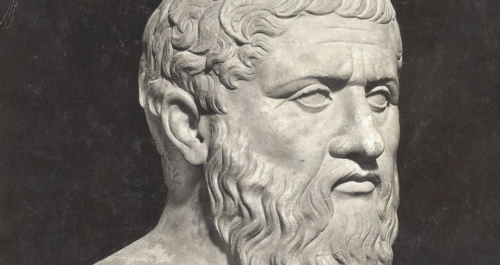samedi, 15 novembre 2025
Philosophes païens en des temps troublés

Philosophes païens en des temps troublés
Ralf Van den Haute
Le terme « néoplatonisme » est une invention de Thomas Taylor (1758-1835), qui s’est fait connaître comme l’auteur de la première traduction anglaise des œuvres complètes de Platon et d’Aristote. Il a également traduit les œuvres de plusieurs autres philosophes et poètes, dont Proclus et Porphyre, deux soi-disant néoplatoniciens.
À partir du IIe siècle de notre ère, Platon regagne en importance dans la philosophie. L’aristotélisme et le stoïcisme se fondent dans ce courant, qui subit aussi l’influence d’un mysticisme intégrant des éléments du pythagorisme, de l’hermétisme ou des oracles chaldéens.
Le terme « néoplatoniciens » est imprécis, car ces philosophes se considéraient eux-mêmes comme les disciples de Platon, une élite, une « race consacrée », et affirmaient clairement qu’ils n’apportaient rien de nouveau. Il s’agit plutôt d’une forme authentique de platonisme, bien que d’autres influences soient également présentes.
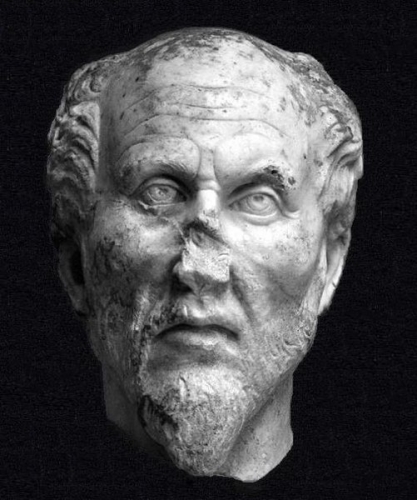
Le philosophe grec Plotin, né en Égypte (IIIe siècle), est considéré comme le fondateur de ce que l’on appellera bien plus tard le néoplatonisme.
Les néoplatoniciens tels que Ammonius Saccas, Plotin, Proclus, Julius Firmicus Maternus, Porphyre et Salluste vécurent à une époque de grands bouleversements culturels et religieux, à savoir la transition du paganisme au christianisme. À cette époque, aux IIIe et IVe siècles après J.-C., l’Empire romain était sous pression en raison de l’influence croissante du christianisme, et le polythéisme traditionnel était en déclin lorsque Constantin le Grand fit du christianisme la religion d’État et réprima sévèrement toute forme d’hérésie. C’est aussi l’époque où l’empereur Julien, après la mort de Constantin, rétablit le paganisme.
Bien que le néoplatonisme soit essentiellement un système philosophique issu des idées de Platon, avec une forte insistance sur l’unité de l’être (l’« Un »), il joue un rôle particulier dans le contexte du paganisme. Les néoplatoniciens considéraient le monde comme une structure hiérarchique remontant à une source ultime, l’« Un » ou le « Bien », et utilisaient cela comme base de leur vision du monde. Le panthéon traditionnel des dieux grecs et romains occupait également une place centrale chez les néoplatoniciens.
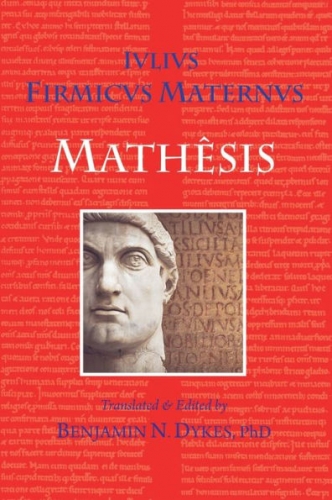
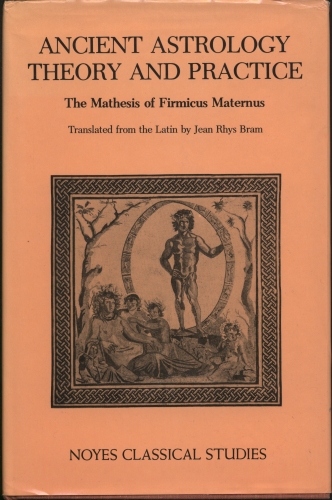
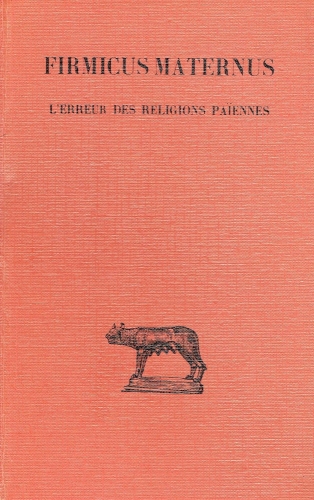
Que ces philosophes des IIIe et IVe siècles se trouvaient à un tournant de l’histoire se manifeste aussi dans leur attitude envers le christianisme. Julius Firmicus Maternus, avocat romain originaire de Syracuse en Sicile, s’est fait connaître avec les Matheseos Libri VIII, l’un des ouvrages les plus célèbres de l’astrologie classique, dans lequel il critique vivement les adversaires de l’astrologie. Il se convertit cependant au christianisme, renonça à l’astrologie et, vers 346, dans un autre ouvrage, De errore profanorum religionum, il présente le paganisme comme une erreur. Les convertis sont toujours les plus zélés : il appelle à la destruction de toutes les statues des dieux, à interdire toute activité dans les temples et à fondre les statues d’or et d’autres métaux pour en faire des pièces de monnaie. Il s’irritait surtout du fait que la plupart des Romains étaient encore païens – même si le christianisme était déjà la religion d’État depuis près de deux décennies. Cela contraste fortement avec ses opinions antérieures. Les autres néoplatoniciens étaient clairement hostiles à la religion révélée chrétienne.
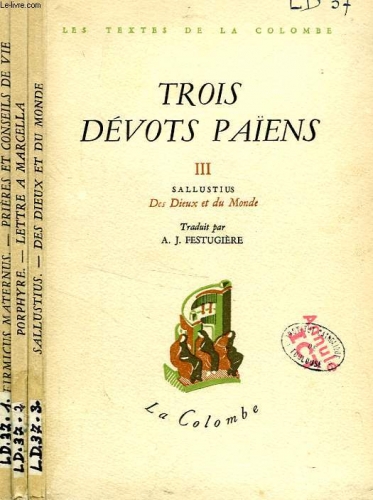
De l’astrologie au paganisme
Le lecteur sera peut-être surpris de voir l’astrologie et le paganisme mentionnés ensemble. A. J. Festugière, philologue classique qui a publié chez Arfuyen un recueil de textes de trois pieux païens – Firmicus, Porphyre et Salluste – souligne que l’astrologie dans l’Antiquité était davantage une religion qu’un art permettant de calculer, à partir de la position des astres, l’espérance de vie ou le succès d’une entreprise. Le ciel souvent clair du sud de l’Europe favorisait la contemplation et l’étude des corps célestes : la régularité des mouvements des étoiles et des planètes conduit naturellement à des réflexions sur l’ordre, la sagesse et l’infini. Festugière explique l’importance de l’astrologie antique pour les néoplatoniciens comme suit.
Les anciens Grecs ont probablement découvert l’astrologie et les oracles chaldéens via les Perses dans la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère. La philosophie et les mathématiques grecques fusionnent alors en un ensemble particulier de science et de religion, que les Romains finiront aussi par connaître. Les étoiles se voient attribuer un statut similaire à celui des dieux. Le Soleil est une étoile particulière qui, par sa lumière et sa chaleur, est la source de toute vie. La Lune, autre astre proche, provoque les marées et influence le corps féminin. On percevait chez les planètes des correspondances subtiles avec le monde végétal et animal. Festugière : « Tout est Un. Le monde est un grand animal (l’auteur utilise le mot animal, qui signifie à l’origine “animé”), un être immortel et divin. »
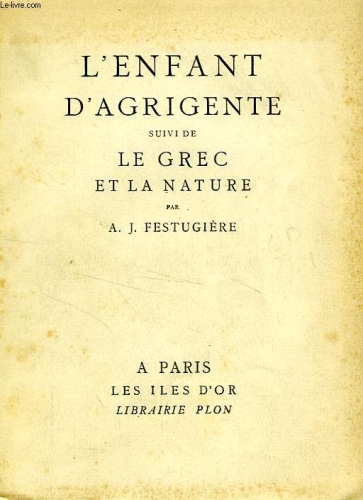
Au début de notre ère, cette religion astrale, fondée sur les étoiles, exerçait une influence bien plus grande qu’on ne l’imagine aujourd’hui. Elle était largement répandue parmi le peuple et les puissants de l’époque, à la campagne comme en ville. Sous les empereurs sévères (193-235 de notre ère), cette religion acquit un caractère officiel et donna un nouvel élan au paganisme déclinant. Il n’est donc pas surprenant que lorsque l’empereur Julien (IVe siècle de notre ère) voulut raviver la religion païenne, il le fit avec des hymnes dédiés au dieu Soleil, le Soleil invaincu, Sol Invictus.
Le culte des corps célestes provoqua aussi des conflits parmi les néoplatoniciens : un camp privilégiait une approche philosophique, l’autre se concentrait davantage sur les pratiques rituelles, et certains combinaient les deux aspects. Pendant des siècles, on a pu croire que les néoplatoniciens formaient une école cohérente, mais il ne faut pas oublier que tous ces philosophes n’ont pas vécu à la même époque et que leurs visions différaient donc.
Œuvres importantes
Les néoplatoniciens utilisaient divers textes et idées qui reflètent clairement leurs convictions païennes :
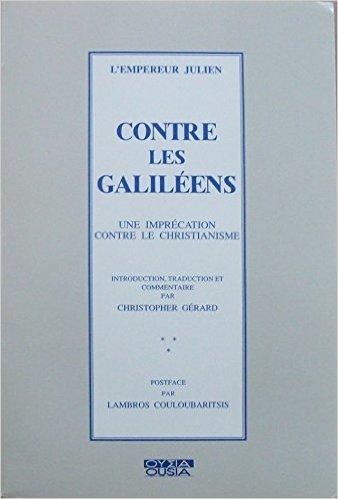
- Contre les Galiléens de l’empereur Julien. Un réquisitoire contre la secte des Galiléens, qu’il considère comme une simple tromperie humaine, sans dimension divine, séduisant les esprits faibles et transformant une fiction incroyable en vérité. Cette œuvre est fondamentale car elle va bien au-delà d’une accusation : Julien approfondit aussi l’essence du divin. Il se réfère à la définition du divin chez Platon et compare la vision platonicienne grecque à l’hébraïque.

- Les Ennéades de Plotin. Un recueil de traités philosophiques, notamment sur la structure hiérarchique de la réalité. La philosophie de Plotin est fortement centrée sur l’Un (qu’il appelle aussi le Bien), qui est la réalité suprême (par opposition à la matérialité). Remarquable : Plotin considère le mal comme un manque de Bien, et donc non comme une réalité absolue. Il est intéressant de noter que Plotin, élève d’Ammonius Saccas, s’intéressait aux mages perses et aux brahmanes indiens. Il n’a cependant pas pu réaliser son projet, car la campagne contre la Perse de l’empereur Gordien III, à laquelle il s’était joint, échoua et il dut rentrer bredouille.
- Le rôle des rituels : Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens et cherchait à détruire les temples païens.
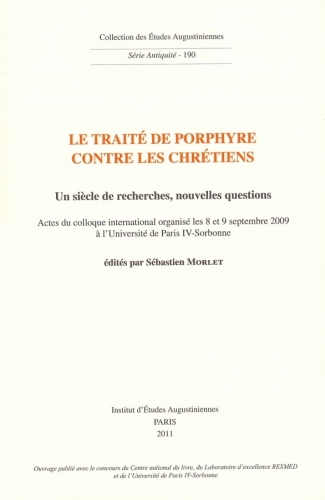
- Contre les chrétiens de Porphyre : Dans cette œuvre, le christianisme est critiqué comme incompatible avec la sagesse philosophique du paganisme. Porphyre soutenait que la théologie chrétienne n’était pas compatible avec la philosophie platonicienne, et que les chrétiens méprisaient à tort les temples et rituels traditionnels de l’Antiquité. Porphyre, élève de Plotin, fut l’un des plus éminents philosophes néoplatoniciens de son temps. Il était un adversaire déterminé du christianisme et écrivit plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il défendait aussi les rituels païens et les pratiques des temples comme essentiels pour l’âme.
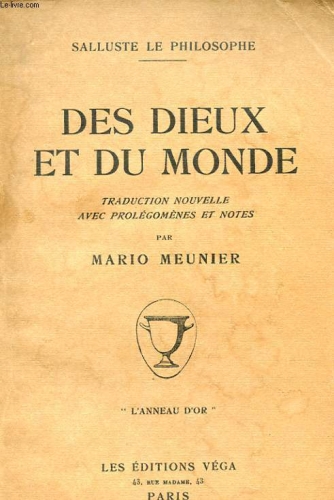
- Des dieux et du monde de Salluste : Cette œuvre offre une défense approfondie des anciennes religions grecques et romaines. Elle met en avant la conception platonicienne du divin comme source de tout, tout en restant fidèle aux conceptions païennes des dieux. Il discute de la relation entre le monde et les dieux, et de la façon dont la nature elle-même peut être vue comme une manifestation du divin. Ses idées sont proches de la vision néoplatonicienne de l’« Un » comme source de tout et insistent sur les rituels, les sacrifices et la nécessité de l’observance religieuse. Salluste n’était d’ailleurs pas opposé à l’idée pythagoricienne de la réincarnation, largement répandue dans le Bas-Empire romain.
Bien que les philosophes néoplatoniciens fussent essentiellement païens, on peut dire que leur paganisme ne correspond pas exactement aux anciennes religions polythéistes de l’Antiquité classique. Ils interprétaient l’ancienne religion et les rituels grecs à travers un prisme philosophique, fortement influencé par les idées de Platon sur la hiérarchie de la réalité et le rôle de l’« Un ». Leurs œuvres reflètent leur confiance dans le paganisme, la philosophie platonicienne et la nécessité des rituels, mais ils s’opposaient aussi au christianisme naissant et aux changements qu’il apportait. Les néoplatoniciens étaient très conscients de leur rôle de maillon dans une « chaîne d’or ».
Des néoplatoniciens comme Porphyre et Salluste croyaient fermement au pouvoir des rituels, des sacrifices et de la vénération des dieux. Cela contraste avec le christianisme, qui s’opposait résolument aux rituels païens. La pensée païenne fut combattue par tous les moyens par le gnosticisme puis par le christianisme. Parmi l’élite, il n’y avait pas seulement un scepticisme croissant. Salluste déplore le grand nombre d’athées, c’est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas les dieux grecs. Il comptait probablement aussi les chrétiens parmi eux. Beaucoup, dans le Bas-Empire romain, n’adhéraient à aucune religion. Sur ce point, rien de nouveau sous le soleil.
Les néoplatoniciens restent un phénomène remarquable en ce qu’ils se trouvent à la frontière de deux époques. Ils font encore partie de la fin de l’Antiquité, mais le début du Moyen Âge est déjà à la porte. Leurs textes païens, issus de la période où le paganisme, après quelques derniers sursauts, fut supplanté par le christianisme dans une grande partie de l’Europe, sont aussi importants pour cette raison : leur quête d’une piété polythéiste est une quête éternelle qui ne nous est pas étrangère à notre époque.

Hymne polythéiste
Pour conclure cette brève introduction à l’univers des néoplatoniciens, j’avais d’abord pensé à un hymne de Proclus, mais j’ai finalement choisi un hymne à Hécate et Janus du même auteur. Hécate, déesse grecque associée aux mystères, protectrice des femmes enceintes et de la jeunesse, est aussi liée à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts.

Janus est un dieu romain, dont le temple sur le forum romain était rituellement ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix, et qui a donné son nom au mois de janvier. Il est lié au passage du temps. Il est le dieu romain des commencements et des fins, des choix et des portes. Ovide écrit à son sujet : « Je veille, avec la bienveillante troupe des Heures (horae, dont le mot français “heure” est dérivé, signifie saisons, donc le temps), sur les portes du ciel, et Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi. » Janus, également connu sous le nom de Januspater, occupe une place importante dans la hiérarchie religieuse romaine et, avec Mars – Marspiter – et Jupiter, il est le seul à porter le titre de dieu père. Hécate et Janus sont tous deux des divinités des frontières, et plus précisément de la frontière entre l’humain et le divin, et peuvent protéger les hommes de tout danger. Proclus leur demande dans cet hymne protection contre la maladie, et de l’aider dans sa quête de lumière et de piété. La forme de cet hymne est particulière, car l’invocation des dieux au début est répétée à la fin.
Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants
Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.
Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.
Rendez la course de mon existence radieuse, chargée de biens; chasse de mes membres les funestes maladies, et mon âme perdue de folie pour le séjour terrestre, tirez-la, après l’avoir purifiée par les mystères qui éveillent l’intellect.
Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, montrez-moi, c’est mon désir, les chemins indiqués par les dieux ; et que je voie la très précieuse lumière, qui permet de fuir la misère du monde de la génération sombre comme la mer.
Oui, je vous en supplie, donnez-moi la main, et pour me faire aborder, recru de fatigues, dans le port de la piété, pousse-moi par vos venst.
Salut, Mère des dieux aux noms multiples, aux beaux enfants
Salut, Hécate, gardienne des portes, à l’immense force.
Mais, à toi aussi, salut, Janus, premier Aïeul, Zeus impérissable, salut, Zeus, Dieu Suprême.
Bibliographie:
- Proclus, Hymnes et prières. Traduction Henri D. Saffrey. Arfuyen, Paris, 1994.
- Trois dévots païens. Traduction A.J. Festugière. Arfuyen, Paris, 1994.
Source : Traduction d’un texte paru dans Traditie, Jaarboek voor traditionele erfgoedbeleving in de lage landen, Brasschaat 2025. ISBN 9789491436260
18:14 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, néo-platoniciens, antiquité grecque, antiquité romaine, philosophie grecque, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 juin 2025
La philosophie d'Héraclite, penseur politique et mystique
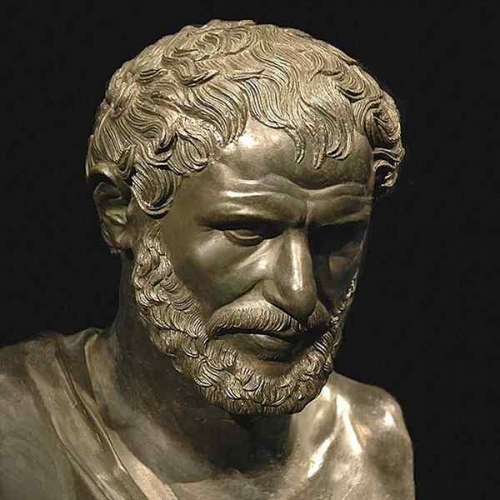
La philosophie d'Héraclite, penseur politique et mystique
À propos d'un essai de Filippo Venturini « Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique » (il Cerchio)
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/121777-il-pensiero-di-eraclito-...
Filippo Venturini « Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique » (il Cerchio)
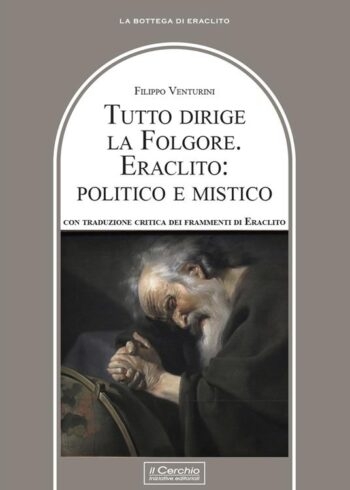 Filippo Venturini est connu pour plusieurs publications importantes sur le thème de l'archéologie. Chercheur depuis toujours intéressé par la pensée antique, en particulier la philosophie présocratique, il vient de publier une étude intéressante sur Héraclite, Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique, disponible en librairie aux éditions il Cerchio (pour commander : info@ilcerchio.it.
Filippo Venturini est connu pour plusieurs publications importantes sur le thème de l'archéologie. Chercheur depuis toujours intéressé par la pensée antique, en particulier la philosophie présocratique, il vient de publier une étude intéressante sur Héraclite, Tout dirige la foudre. Héraclite : politicien et mystique, disponible en librairie aux éditions il Cerchio (pour commander : info@ilcerchio.it.
L'essai se termine par un recueil de fragments du penseur d'Éphèse dans l'édition Diels-Kranz, dont l'auteur fournit, dans plusieurs cas, une traduction critique et alternative, accompagnée de commentaires tout à fait pertinents et partageables sur les paroles d'Héraclite.
Dès les premières pages, l'ouvrage montre clairement que Venturini a acquis une connaissance hors du commun, tant des textes du philosophe «obscur» que de la littérature exégétique la plus reconnue sur le sujet. Le livre est divisé en trois chapitres: dans le premier, l'essayiste traite de l'inspiration politique qui caractérise la vision du monde de l'aristocrate grec; dans le deuxième, il aborde les complexes théoriques les plus significatifs de la spéculation du philosophe; enfin, dans la troisième partie, il présente la fin tragique d'Héraclite, l'interprétant comme la conséquence inévitable de l'inactualité politique des thèses du grand présocratique.
Au début du texte, Venturini, s'appuyant sur l'enseignement de Nietzsche, souligne que les Grecs, dans leur tradition, ont également accueilli des visions exotiques venues d'Orient, les ré-élaborant de manière originale, à la lumière de l'ethos hellénique. Il soutient en particulier que « Héraclite est un penseur [...] politique, au sens le plus large et le plus complet du terme [...] un penseur de la polis, un penseur communautaire » (p. 8). Sa philosophie est liée, compte tenu de son héritage noble, au contexte mythique de la culture religieuse polyadique. Dans sa vie et dans ses fragments, on voit clairement émerger les deux tendances fondamentales qui, selon Colli, ont donné naissance à la culture hellénique: la propension mystico-dionysiaque et la tension apollinienne-politique, cette dernière visant à donner une « forme » au chaos conflictuel de la vie.

Il fut personnellement impliqué dans la vie d'Éphèse, soutenant la tentative politique d'Hermodore. Sa conception anti-dualiste et relationnelle des opposés, selon l'enseignement de Théognis, l'amena à interpréter le polemos qui régnait dans la polis comme un symptôme de ce qui se passe dans la physis. Venturini, avec Gadamer, estime que les références constantes à la phronesis, « vertu, raisonnabilité de l'action », présentes dans les fragments, attestent clairement le caractère éminemment pratique de la pensée de l'Éphésien. Héraclite pensait, comme les autres sages helléniques, que la physis était en harmonie avec la politeia, la «constitution». La dimension « démocratique », au sens grec du terme, relevée chez Héraclite par Preve, ne contredit pas l'esprit aristocratique du penseur: suite à l'échec du projet d'Hermodore, sa nature noble l'amena à mépriser les masses, désormais insensibles à toute politique anagogique.
L'intégrité du cosmos et de la polis était, à ce moment historique, menacée: « par les forces contraires et centrifuges de l'égoïsme des individus et des factions, générées par la soif de richesse » (p. 10). L'irruption de la monnaie dans le monde grec avait produit l'eris, corrompant une partie importante de l'aristocratie elle-même. À l'atomisme social dont étaient porteurs les nouvelles classes ploutocratiques émergentes, Héraclite opposa, avec une puissance théorique inhabituelle, la structure organique du cosmos, compris comme un espace ordonné par des lois.

Il aurait voulu, par cette référence à la vision aurorale hellénique, « réveiller » les inconscients, les « endormis ». Les hommes sont un moment de l'harmonie cosmique dont parle le fr. 30 : « dont l'essence est le scintillement perpétuel de la lumière (physis) dans l'obscurité qui l'entoure » (p. 11). La lumière met en évidence les « éléments » qui constituent le réel, à travers les metra, l'espace et le temps. À cette progression naturelle, l'homme correspond par la vue, le « voir », qui dévoile l'aphanes, l'harmonie de toutes choses, dont parle le fr. 54. Heidegger a souligné que cette harmonie «discrète» est «quelque chose que l'on a constamment sous les yeux, mais dont on n'est pas conscient» (p. 11). Celui qui saisit cette conscience atteint l'origine, le principe, la coincidentia oppositorum, au-delà de la logique diairetique de l'identité. Pour y parvenir, il faut « se connaître soi-même », contrôler les pulsions catagogiques qui nous constituent pourtant. Héraclite et les Grecs ne connaissaient pas la « métaphysique », ils savaient que l'un ne se donne que dans le multiple et que « l'au-delà », si l'on veut utiliser ce terme, vit dans l'«ici et le maintenant» de l'éternel présent, dans la conjonction du kairos et de l'aion, dans la mémoire communautaire de la polis. Colli soutenait que cette instance cognitive est une «expérience vécue» non communicable, en tant que contact avec le fond abyssal de la vie, à la fois merveilleux et tragique.

Politique et mystique coïncident chez Héraclite: la polis témoigne de l'unité du fini et de l'infini, elle permet de voir « l'unité du tout et la compétition entre les opposés » ( p. 14), comme le montre le fragment 53. En raison de la déception subie à la suite de l'échec du projet d'Hermodore, Héraclite s'est plongé dans la nature sauvage, s'est adonné au « vagabondage ». Ce n'était pas, commente Venturini, un choix anti-politique, mais un témoignage extrême de la vocation mystico-politique, qui est authentiquement hellénique. Dans les forêts, Héraclite « vécut », comme le savait Bruno, le sens ultime du mythe d'Actéon, il saisit l'unité du sujet et de l'objet: tout est dynamis, possibilité-puissance-liberté. Le cliché scolaire qui présente Héraclite « pleurant » doit donc être renversé pour en faire un Heraclitus ridens. Héraclite est le philosophe du seuil qui unit le temps et l'éternité, c'est pourquoi les Éphésiens vénéraient ses restes mortels. Le philosophe s'est dépensé sans compter pour enseigner à ses concitoyens que la vie nue ne peut être aimée et vécue que dans la polis ordonnée, transcription des rythmes de la physis.
Filippo Venturini, Tutto dirige la folgore. Eraclito: politico e mistico, il Cerchio, pp. 187, 24,00 euros
13:10 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : héraclite, philosophie, ephèse, antiquité grecque, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 juin 2025
Entretien avec Christopher Gérard sur La Source pérenne
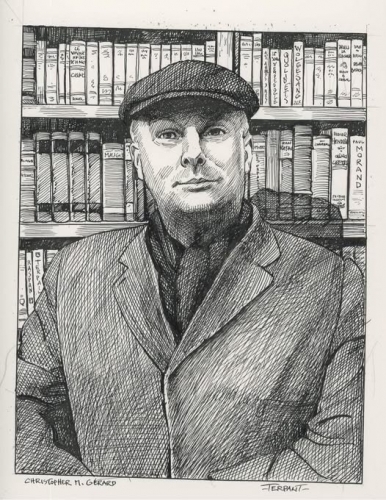
Entretien avec Christopher Gérard sur La Source pérenne
Propos recueillis par Robert Steuckers
En 25 ans, en un quart de siècle, votre dernier ouvrage, avec ses trois éditions successives, est bel et bien inscrit dans la durée. Doit-on attribuer cette résilience à la mission que s’était assignée jadis un jeune philologue classique qui refusait que sa discipline reste confinée aux musées, à une vulgate ad usum Delphini ou subisse les moqueries des utilitaristes claironnant que l’étude des langues anciennes « est une perte de temps » ? Quid de l’enseignement des humanités gréco-latines aujourd’hui, véhicules théoriques, avec d’autres, de la transmission des sources (pérennes) ? Leur défense n’est-elle pas un combat parallèle tout aussi essentiel que l’évocation littéraire et poétique des traditions vernaculaires partout en Europe ?
En effet, lors de mes études, j’ai perçu une double menace sur les langues anciennes : celle de leur disparition annoncée au nom de fariboles à prétentions égalitaristes (« privilège bourgeois », donc à supprimer d’office au lieu de le proposer à tous) ; celle de leur muséification qui pouvait aboutir à la neutralisation de notre héritage plurimillénaire par le biais d’une forme de relativisme, illustrée par la déclaration d’un celtisant qui, affolé par la puissance des mythes qu’il étudiait, m’affirma piteusement : « J’aurais tout aussi bien pu dédier ma vie à l’étude de l’Islam ».
Si l’on réfléchit bien, tout a été dit par les Anciens : Thucydide et Marc Aurèle, Tacite et Cicéron, tant d’autres, ont donné de l’expérience humaine un tableau exhaustif. La force d’un Platon ou d’un Sénèque pulvérise d’emblée les discours convenus, les propagandes les plus insidieuses, que les études gréco-latines, qui forment à la connaissance approfondie de la rhétorique, permettent de décoder, ou, pour parler post-moderne, de « déconstruire ». Défendre cet accès direct à l’héritage, cette formation de l’esprit dès le plus jeune âge relève du combat culturel au sens le plus noble du terme. Pas de plus puissant vaccin contre le virus de l’idéologie, quelle qu’elle soit. Pas de meilleure potion contre les ravages de l’amnésie collective. L’effondrement de la lecture, les mutations à marche forcée de l’enseignement vers un nivellement toujours plus intégriste, le triomphe de l’image (authentique ou non) et des écrans (avec la chute dramatique de la capacité de concentration) constituent de fameux défis pour les tenants d’une culture traditionnelle. Mais, pour paraphraser certain poète provençal, le désespoir en métapolitique est une sottise absolue, tant les cerveaux, notamment européens, possèdent une capacité d’adaptation, une créativité qui nous étonneront.
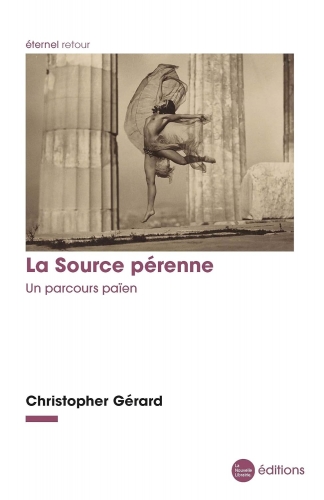
Pour toute commande: https://nouvelle-librairie.com/boutique/editions-la-nouve...
Quel est l’impact d’une œuvre comme celle de Walter Otto, que vous avez souvent cité mais qui reste trop peu connu, à mon sens, quand on aborde les thématiques de la « source pérenne » ?
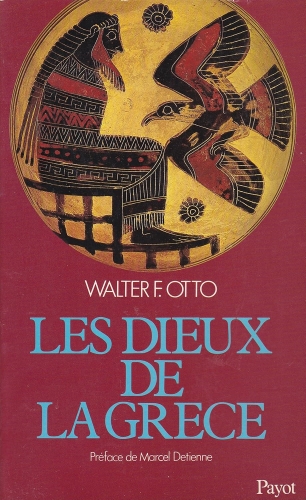 En effet, vous avez raison, W. F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.
En effet, vous avez raison, W. F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons. C’est grâce à Marcel Detienne, anthropologue et historien des religions d’origine belge, que j’ai découvert Otto à l’âge de dix-neuf ans, en première candi ! Il s’agissait de sa magistrale préface à la traduction française de Les Dieux de la Grèce, chez Payot, où Detienne soulignait que ce professeur de grec, muté en 1934 à l’université de Königsberg par le nouveau pouvoir, professait « sa foi en Zeus l’Olympien ». L’apport d’Otto, outre une désespérante connaissance des sources dans la plus pure tradition de la Quellenforschung , est sa volonté, étayée avec rigueur, de comprendre le monde ancien avec les yeux d’un Grec. D’où ses portraits saisissants d’Apollon ou d’Hermès. Le même Otto avait aussi étudié le conflit entre monde antique et chrétienté, et l’obstacle épistémologique que constitue l’habitus judéo-chrétien, qui empêche de « voir » ces dieux grecs. Mon travail de dilettante s’inscrit dans cette prestigieuse lignée.
Votre démarche est-elle forcément plus héraclitéenne que parménidienne voire socratique ?
Je suis plus sensible à Héraclite qu’à Parménide, qui me reste encore hermétique. Je n’abandonne pas la partie ; j’attends la retraite pour retravailler tout ce pan de la pensée grecque. Le polémos héraclitéen, sa vision cosmique d’un univers éternel obéissant à des cycles cadencés est d’une totale poésie, et relève de l’inspiration pure, quasi divine. Socrate, lui, reste le père de la maïeutique et le maître de l’ironie, découvertes extraordinaires de la pensée européenne.
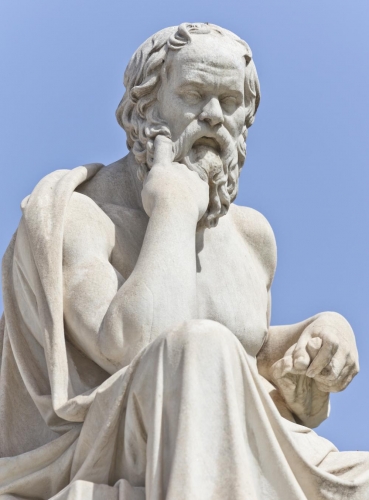
Sans Socrate, nous ne serions pas aussi libres que nous ne le sommes (potentiellement). Et sans les Grecs, nous n’existerions pas. Imagine-t-on l’Europe, ne fût-ce que sans le théâtre, la tragédie et la comédie ? Socrate nous exhorte à la recherche de la vérité par-delà les faux-semblants ; il nous pousse à vouloir nous perfectionner sans cesse - le propre d’un maître.
Le récit de sa mort volontaire par Platon est saisissant ; il a marqué en profondeur tous les Bons Européens depuis vingt-cinq siècles. Avec Antigone, avec Ulysse et Hector, Socrate demeure l’une des figures les plus lumineuses de notre tradition.
Qu’en est-il de la tradition platonicienne. Peut-on oser vous placer dans les habits d’un nouveau Pléthon ?
Que serait l’Europe sans les grands mythes platoniciens, comme le mythe de la caverne, que le philosophe Jean-François Mattéi a étudié de manière magistrale ? Et la théorie de la connaissance, l’image de la montée du char ailé ? Le détachement des réalités sensibles pour découvrir le Monde des Idées ? Que dire de l’influence dans toute l’Europe d’un livre comme Le Banquet ? Et des visions cosmiques du Timée, qui inspirèrent sa théorie des atomes à Heisenberg ? Certes, Nietzsche s’oppose à Platon, de manière frontale… mais le défi n’est-il pas de penser Platon et Nietzsche de concert ?

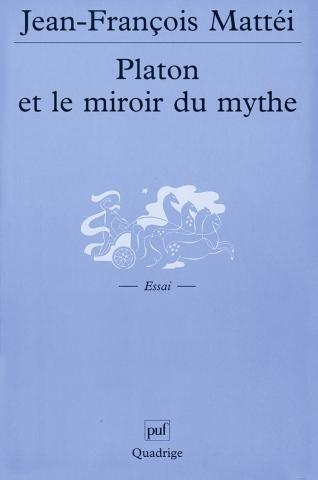

Si je puis me permettre un conseil de lecture platonicienne, outre les textes du philosophe lui-même, il y a l’excellent roman du Roumain Vintila Horia, La Septième Lettre.
Lors de mes études à l’ULB, j’ai découvert chez un grand libraire de Bruxelles que vous avez aussi connu, Alain Ferraton, la biographie monumentale du philosophe byzantin Georges Gémiste Pléthon par François Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra (Belles Lettres, 1956), dont la lecture me transporta.
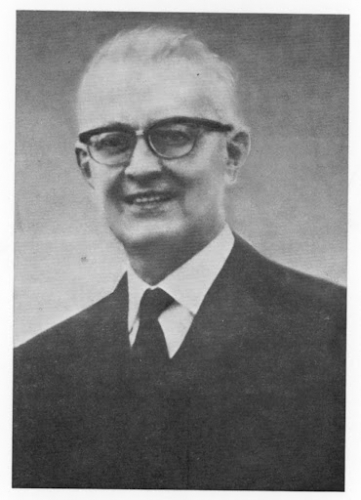
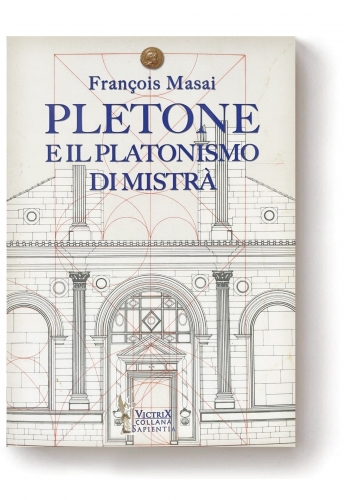
L’auteur était un dominicain défroqué qui avait enseigné dans mon université et dirigé un département à la Bibliothèque royale. Il avait côtoyé de grands savants belges qui avaient chacun étudié l’ancien paganisme : Joseph Bidez, le biographe et l’éditeur de l’empereur Julien ; Franz Cumont, le spécialiste du culte de Mithra ; le byzantinologue Henri Grégoire… La Belgique de la première moitié du XXème siècle a été un carrefour des recherches sur le paganisme, par exemple à l’Université de Liège pour ce qui est du courant pythagoricien. Toute une génération libérée des carcans catholiques a pu s’épanouir et creuser un sillon très profond dans une zone sensible du savoir.
Plusieurs de mes professeurs avaient bien connu Masai ; l’homme détonnait par son immense érudition et aussi, comme plusieurs anciens ecclésiastiques qui avaient quitté les ordres, par son platonisme clairement paganisant - qui heurtait ces positivistes pur sucre (dont je ne fus jamais).
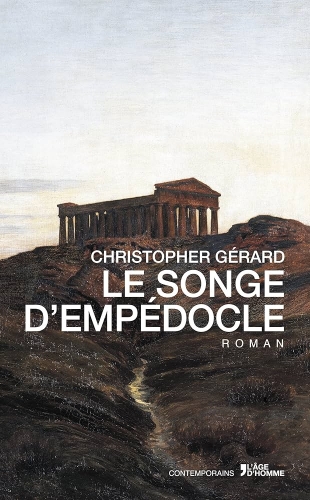
Vous comprenez donc que, dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle, j’ai tenu à célébrer Pléthon et ses disciples, réunis dans la société secrète qu’il avait créée pour défendre l’hellénisme menacé par les Ottomans, La Phratrie des Hellènes. Un chercheur français, Claude Bourrinet, qui a écrit sur Jünger et Stendhal (ce qui est bon signe), vient de livrer une étude sur Pléthon, Zoroastre et Sparte, à laquelle je renvoie.
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/04/29/plethon-sparte-et-zarathoustra.html
Rappelez-nous les raisons de votre engouement pour la figure d’Empédocle ?
Empédocle d’Agrigente, penseur à la vie mystérieuse, devin errant, a exercé sur la pensée européenne une influence énorme, notamment par sa théorie des Quatre Eléments. Nietzsche disait de lui qu’il était « la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne » et qu’il définissait comme « l’homme agonal ».

Le Zarathoustra de Nietzsche doit beaucoup à cette figure fascinante qu’il décrit comme « le philosophe tragique par excellence », dont il loue « le pessimisme actif et non quiétiste ». Empédocle a aussi influencé Platon, Aristote, Lucrèce et Plotin, avant de laisser une empreinte sur l’hermétisme arabe et persan. Enfin, Hölderlin et Schopenhauer, Freud et Bachelard ont cheminé à ses côtés. Empédocle préférait créer des énigmes que dicter des solutions ; il a été mal compris pendant des siècles, déformé même, et ce au nom du principe du tiers exclu, qui exige qu’un philosophe ne peut en aucun cas se doubler d’un mystique. Or, chez Empédocle mythe et raison s’harmonisent dans une quête tant intérieure qu’extérieure. Mieux : un courant empédocléen se mêle au pythagorisme pour survivre bien plus tard que prévu dans le soufisme et chez nos alchimistes. Vous voyez qu’il s’agit d’une de ces figures souterraines de la culture européenne, dans l’ombre mais essentielle.
Votre position de philologue classique, qui parle de plein droit du paganisme grec, vous immunise contre tout un kitsch pseudo-païen, de la Wicca américaine aux druidismes de pacotille. Quel message adressez-vous à ceux qui risquent de tomber dans ce piège ?
Si je n’ai guère d’intérêt pour la Wicca, qui se développe surtout en terre anglo-saxonne et protestante, où la tradition du carnaval est moins enracinée que chez nous, catholiques (je parle en païen post-catholique ; je serais né protestant ou orthodoxe, mon discours varierait sans doute), le druidisme, lui, mérite plus d’attention car il a beaucoup évolué depuis trente ans. De loin, je suis l’un ou l’autre nouveau druide et je dois avouer que cela se décante et que leur travail me semble sérieux. Il y a bien sûr dans nombre de groupes un kitsch wiccan ou néo-celtique, avec tatouages et tutti quanti, qui m’horrifie à cause de leur mauvais goût, et de leur confusionnisme qui n’évite pas les génuflexions « correctes ».
Le message ? Retour aux textes, lecture rigoureuse, rejet de toute dérive mercantile, de tout délire confusionniste.

Aujourd’hui, en ce jour de mai 2025, quelles pistes explorez-vous ou quelles pistes suggérez-vous d’emprunter à vos lecteurs ?
Une piste me vient à l’esprit, à développer dans le cadre d’un monde multipolaire : le filon taoïste, en pleine renaissance dans la Chine contemporaine, future puissance hégémonique. Un mode de pensée païen, polythéiste et non dualiste, me paraît une façon de nouer un dialogue avec les taoïstes et aussi les confucéens, dont nous avons beaucoup à apprendre en termes de longue mémoire. Idem avec les Indiens et les Japonais, chez qui le fait de ne pas se présenter comme chrétien ou « occidental » (donc « supérieur ») facilite le dialogue. Il y a là un capital de sympathie, une possibilité d’entrer dans d’autres logiques qui me paraissent importantes dans le cadre d’une stratégie globale.
Christopher Gérard
Ixelles, Calendes de juin MMXXV.
Lectures complémentaires:
D'un auteur francophone à un autre auteur francophone et à une langue inconnue en Europe:
"Maugis" de Christopher Gérard: plus vrai que le vrai:
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/02/11/m...
Maugis ou l'autre armée des ombres
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2020/09/30/m...
Entretien avec Christopher Gérard
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/03/15/e...
Entretien sur "Le Prince d'Aquitaine": trois questions à Christopher Gérard
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2019/01/08/e...
"Le Songe d'Empédocle" de Christopher Gérard
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2015/05/09/l...
12:03 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, christopher gérard, hellénisme, antiquité grecque, lettres, lettres belges, littérature, littérature belge, humanités gréco-latines, philologie classique, paganisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 mai 2025
Orthodoxie et hérésie durant l’Antiquité tardive

Orthodoxie et hérésie durant l’Antiquité tardive
Claude Bourrinet
La période qui s’étend du IIIe siècle de l’ère chrétienne au 6ème, ce qu’il est convenu d’appeler, depuis les débuts de l’Âge moderne, le passage de l’Antiquité gréco-romaine au Moyen Âge (ou Âges gothiques), fait l’objet, depuis quelques années, d’un intérêt de plus en plus marqué de la part de spécialistes, mais aussi d’amateurs animés par la curiosité des choses rares, ou poussés par des besoins plus impérieux. De nombreux ouvrages ont contribué à jeter des lueurs instructives sur un moment de notre histoire qui avait été négligée, voire méprisée par les historiens. Ainsi avons-nous pu bénéficier, à la suite des travaux d’un Henri-Irénée Marrou, qui avait en son temps réhabilité cette époque prétendument « décadente », des analyses érudites et perspicaces de Pierre Hadot, de Lucien Jerphagnon, de Ramsay MacMullen, de Christopher Gérard et d’autres, tandis que les ouvrages indispensable, sur la résistance païenne, de Pierre de Labriolle et d’Alain de Benosit étaient réédités. Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, a publié, en 2006, aux éditions Les Belles Lettres, une recherche très instructive, La Lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif, que je vais essayer de commenter.
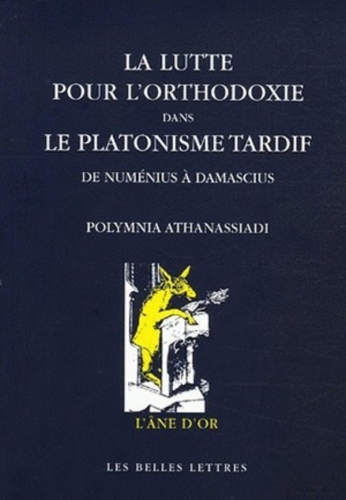
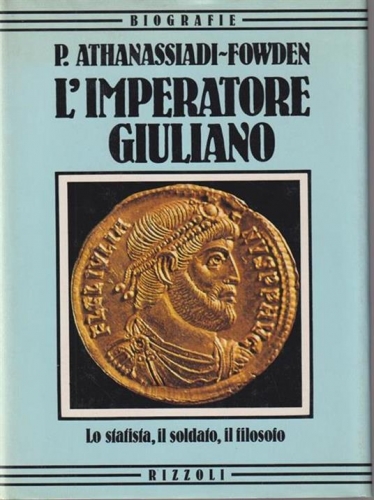
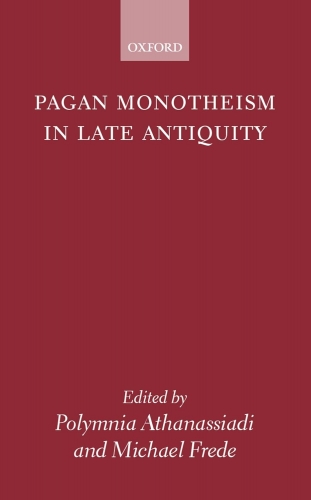
Avant tout, il est indispensable de s’interroger sur l’occultation, ou plutôt l’aveuglement (parce que l’acte de voiler supposerait une volonté assumée de cacher, ce qui n’est pas le cas), qu’ont manifesté les savants envers cette période qui s’étend sur plusieurs siècles. L’érudition classique, puis romantique (laquelle a accentué l’erreur de perspective) préféraient se pencher sur celle, plus valorisante, du 5ème siècle athénien, ou de l’âge d’or de l’Empire, d’Auguste aux Antonins. Pourquoi donc ce dédain, voire ce quasi déni ? On s’aperçoit alors que, bien qu’aboutissant à des présupposés laïques, la science historique a été débitrice de la vision chrétienne de l’Histoire. On a soit dénigré ce qu’on appela le « Bas Empire », en montrant qu’il annonçait l’obscurantisme, ou bien on l’a survalorisé, en dirigeant l’attention sur l’Église en train de se déployer, et sur le christianisme, censé être supérieur moralement. On a ainsi souligné dans le déclin, puis l’effondrement de la civilisation romaine, l’avènement de la barbarie, aggravée, aux yeux d’un Voltaire, par un despotisme asiatique, que Byzance incarna pour le malheur d’une civilisation figée dans de louches et imbéciles expressions de la torpeur spirituelle, dans le même temps qu’on saluait les progrès d’une vision supposée supérieure de l’homme et du monde.

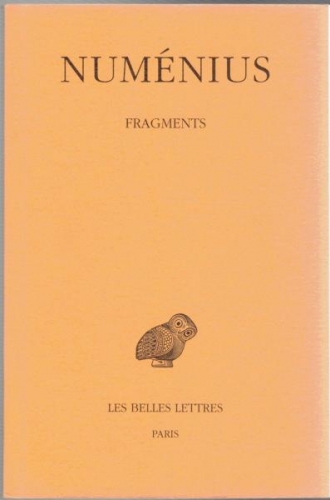
Plus pernicieuse fut la réécriture d’un processus qui ne laissa guère de chances aux vaincus, lesquels faillirent bien disparaître totalement de la mémoire. À cela, il y eut plusieurs causes. D’abord, la destruction programmée, volontaire ou non, des écrits païens par les chrétiens. Certains ont pu être victimes d’une condamnation formelle, comme des ouvrages de Porphyre, de Julien l’Empereur, de Numénius, d’autres ont disparu parce qu’ils étaient rares et difficiles d’accès, comme ceux de Jamblique, ou bien n’avaient pas la chance d’appartenir au corpus technique et rhétorique utile à la propédeutique et à la méthodologie allégorique utilisées par l’exégèse chrétienne. C’est ainsi que les Ennéades de Plotin ont survécu, contrairement à d’autres monuments, considérables, comme l’œuvre d’Origène, pourtant chrétien, mais plongé dans les ténèbres de l’hérésie, qu’on ne connaît que de seconde main, dans les productions à des fins polémiques d’un Eusèbe.
La philosophie, à partir du 2ème siècle, subit une transformation profonde, et se « platonise » en absorbant les écoles concurrentes comme l’aristotélisme et le stoïcisme, ou en les rejetant, comme l’académisme ou l’épicurisme, en s’appuyant aussi sur un corpus mystique, plus ou moins refondé, comme l’hermétisme, le pythagorisme ou les oracles chaldaïques. De Platon, on ne retient que le théologien. Le terme « néoplatonisme » est peu satisfaisant, car il est un néologisme qui ne rend pas compte de la conscience qu’avaient les penseurs d’être les maillons d’une « chaîne d’or », et qui avaient hautement conscience d’être des disciples de Platon, des platoniciens, des platonici, élite considérée comme une « race sacrée ». Ils clamaient haut et fort qu’il n’y avait rien de nouveau dans ce qu’ils avançaient. Cela n’empêchait pas des conflits violents (en gros, les partisans d’une approche « intellectualisante » du divin, de l’autre ceux qui mettent l’accent sur le rituel et le culte, bien que les deux camps ne fussent pas exclusifs l’un de l’autre). Le piège herméneutique dont fut victime l’appréhension de ces débats qui éclosent au seuil du Moyen Âge, et dont les enjeux furent considérables, tient à ce que le corpus utilisé (en un premier temps, les écrits de Platon) et les méthodes exégétiques, préparent et innervent les pratiques méthodologiques chrétiennes. Le « néoplatonisme » constituerait alors le barreau inférieur d’une échelle qui monterait jusqu’à la théologie chrétienne, sommet du parcours, et achèvement d’une démarche métaphysique dont Platon et ses exégètes seraient le balbutiement ou la substance qui n’aurait pas encore emprunté sa forme véritable.
Or, non seulement la pensée « païenne » s’inséra difficilement dans un schéma dont la cohérence n’apparaît qu’à l’aide d’un récit rétrospectif peu fidèle à la réalité, mais elle dut batailler longuement et violemment contre les gnostiques, puis contre les chrétiens, quand ces derniers devinrent aussi dangereux que les premiers, quitte à ne s’avouer vaincue que sous la menace du bras séculier.
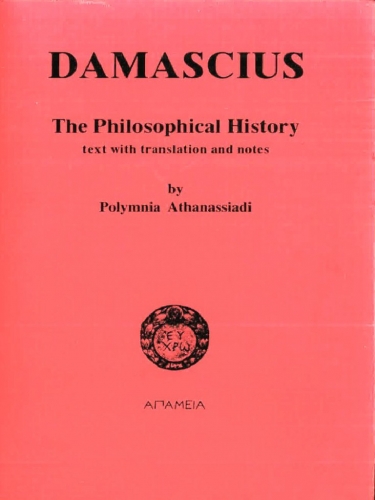
Cette résistance, cette lutte, Polymnia Athanassiadi nous la décrit très bien, avec l’exigence d’une érudite maîtrisant avec talent la technique philologique et les finesses philosophiques d’un âge qui en avait la passion. Mais ce qui donne encore plus d’intérêt à cette recherche, c’est la situation (pour parler comme les existentialistes) adoptée pour en rendre compte. Car le point de vue platonicien est suivi des commencements à la fin, de Numénius à Damascius, ce qui bascule complètement la compréhension de cette époque, et octroie une légitimité à des penseurs qui avaient été dédaignés par la philosophie universitaire. Ce n’est d’ailleurs pas une moindre gageure que d’avoir reconsidéré l’importance de la théurgie, notamment celle qu’a conçue et réalisée Jamblique, dont on perçoit la noblesse de la tâche, lui qui a souvent fort mauvaise presse parmi les historiens de la pensée.
Pendant ces temps très troublés, où l’Empire accuse les assauts des Barbares, s’engage dans un combat sans merci avec l’ennemi héréditaire parthe, où le centre du pouvoir est maintes fois disloqué, amenant des guerres civiles permanentes, où la religiosité orientale mine l’adhésion aux dieux ancestraux, l’hellénisme (qui est la pensée de ce que Paul Veyne nomme l’Empire gréco-romain) est sur la défensive. Il lui faut trouver une formule, une clé, pour sauver l’essentiel, la terre et le ciel de toujours. Nous savons maintenant que c’était un combat vain (en apparence), en tout cas voué à l’échec, dès lors que l’État allait, par un véritable putsch religieux, imposer le culte galiléen. Durant trois ou quatre siècles, la bataille se déroulerait, et le paganisme perdrait insensiblement du terrain. Puis on se réveillerait avec un autre ciel, une autre terre. Comme le montre bien Polymnia Athanassiadi, cette « révolution » se manifeste spectaculairement dans la relation qu’on cultive avec les morts : de la souillure, on passe à l’adulation, au culte, voire à l’idolâtrie des cadavres.

À travers cette transformation des cœurs, et de la représentation des corps, c’est une nouvelle conception de la vérité qui vient au jour. Mais, comme cela advient souvent dans l’étreinte à laquelle se livrent les pires ennemis, un rapport spéculaire s’établit, où se mêlent attraction et répugnance. Récusant la notion de Zeitgeist, trop vague, Polymnia Athanassiadi préfère celui d’« osmose » pour expliquer ce phénomène universel qui poussa les philosophes à définir, dans le champ de leurs corpus, une « orthodoxie », tendance complètement inconnue de leurs prédécesseurs. Il s’agit là probablement de la marque la plus impressionnante d’un âge qui, par ailleurs, achèvera la logique de concentration extrême des pouvoirs politique et religieux qui était contenu dans le projet impérial. C’est dire l’importance d’un tel retournement des critères de jugement intellectuel et religieux pour le destin de l’Europe.
Il serait présomptueux de restituer ici toutes les composantes d’un processus historique qui a mis des siècles pour réaliser toutes ses virtualités. On s’en tiendra à quelques axes majeurs, représentatifs de la vision antique de la quête de vérité, et généralement dynamisés par des antithèses récurrentes.
L’hellénisme, qui a irrigué culturellement l’Empire romain et lui a octroyé une armature idéologique, sans perdre pour autant sa spécificité, notamment linguistique (la plupart des ouvrages philosophiques ou mystiques sont en grec) est, à partir du 2ème siècle, sur une position défensive. Il est obligé de faire face à plusieurs dangers, internes et externes. D’abord, un scepticisme dissolvant s’empare des élites, tandis que, paradoxalement, une angoisse diffuse se répand au moment même où l’Empire semble devoir prospérer dans la quiétude et la paix. D’autre part, les écoles philosophiques se sont pour ainsi dire scolarisées, et apparaissent souvent comme des recettes, plutôt que comme des solutions existentielles. Enfin, de puissants courants religieux, à forte teneur mystique, parviennent d’Orient, sémitique, mais pas seulement, et font le siège des âmes et des cœurs. Le christianisme est l’un d’eux, passablement hellénisé, mais dont le noyau est profondément judaïque.
Plusieurs innovations, matérielles et comportementales, vont se conjuguer pour soutenir l’assaut contre le vieux monde. Le remplacement du volume de papyrus par le Codex, le livre que nous connaissons, compact, maniable, d’une économie extraordinaire, outil propice à la pérégrination, à la clandestinité, sera déterminant dans l’émergence de cette autre figure insolite qu’est le missionnaire, le militant. Les païens, par conformisme traditionaliste, étaient attachés à l’antique mode de transmission de l’écriture, et l’idée de convertir autrui n’appartenait pas à la Weltanschauung gréco-romaine. Nul doute qu’on ait là l’un des facteurs les plus assurés de leur défaite finale.

Le livre possède aussi une qualité intrinsèque, c’est que la disposition de ses pages reliées et consultables à loisir sur le recto et le verso, ainsi que la continuité de lecture que sa facture induit, le rendent apte à produire un programme didactique divisé en parties cohérentes, en une taxinomie. Il est par excellence porteur de dogme. Le canon, la règle, l’orthodoxie sont impliqués dans sa présentation ramassée d’un bloc, laissant libre cours à la condamnation de l’hérésie, terme qui, de positif qu’il était (c’était d’abord un choix de pensée et de vie) devient péjoratif, dans la mesure même où il désigne l’écart, l’exclu. Très vite, il sera l’objet précieux, qu’on parera précieusement, et qu’on vénérera. Les religions du Livre vont succéder à celles de la parole, le commentaire et l’exégèse du texte figé à la recherche libre et à l’accueil « sauvage » du divin.
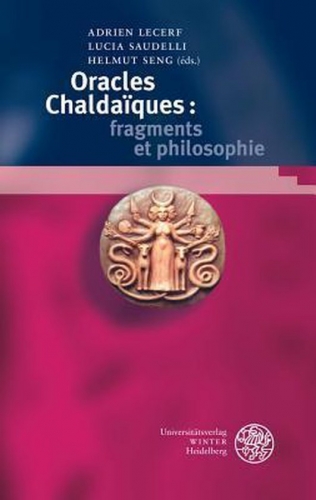
Pour les Anciens, la parole, « créature ailée », selon Homère, symbolise la vie, la plasticité de la conscience, la possibilité de recevoir une pluralité de messages divins. Rien de moins étrange pour un Grec que la théophanie. Le vecteur oraculaire est au centre de la culture hellénique. C’est pourquoi les Oracles chaldaïques, création du fascinant Julien le théurge, originaire de la cité sacrée d’Apamée, seront reçus avec tant de faveur. En revanche la théophanie chrétienne est un événement unique: le Logos s’est historiquement révélé aux hommes. Cependant, sa venue s’est faite par étapes, chez les Juifs et les Grecs d’abord, puis sous le règne d’Auguste. L’incarnation du Verbe est conçue comme un progrès, et s’inscrit dans un temps linéaire. Tandis que le Logos, dans la vision païenne, intervient par intermittence. En outre, il révèle une vérité qui n’est cernée ni par le temps, ni par l’espace. La Sophia appartient à tous les peuples, d’Occident et d’Orient, et non à un « peuple élu ». C’est ainsi que l’origine de Jamblique, de Porphyre, de Damascius, de Plotin, les trois premiers Syriens, le dernier Alexandrin, n’a pas été jugé comme inconvenante. Il existait, sous l’Empire, une koïnè théologique et mystique.
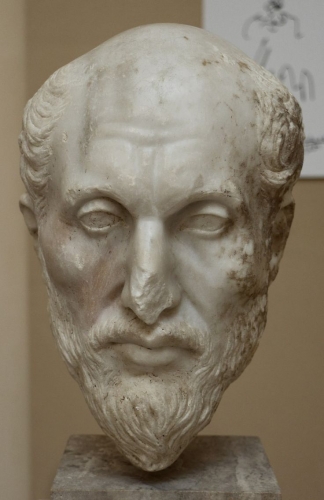
Que le monothéisme sémitique ait agi sur ce recentrement du divin sur lui-même, à sa plus simple unicité, cela est plus que probable, surtout dans cette Asie qui accueillait tous les brassages de populations et de doctrines, pour les déverser dans l’Empire. Néanmoins, il est faux de prétendre que le néoplatonisme fût une variante juive du platonisme. Il est au contraire l’aboutissement suprême de l’hellénisme mystique. Comme les Indiens, que Plotin ambitionnait de rejoindre en accompagnant en 238 l’expédition malheureuse de Gordien II contre le roi perse Chahpour, l’Un peut se concilier avec la pluralité. Jamblique place les dieux tout à côté de Dieu. Plus tard, au 5ème siècle, Damascius, reprenant la théurgie de Jamblique et l’intellectualité de Plotin (3ème siècle), concevra une voie populaire, rituelle et cultuelle, nécessairement plurielle, et une voie intellective, conçue pour une élite, quêtant l’union avec l’Un. Le pèlerinage, comme sur le mode chrétien, sera aussi pratiqué par les païens, dans certaines villes « saintes », pour chercher auprès des dieux le salut.

Les temps imposaient donc un changement dans la religiosité, sous peine de disparaître rapidement. Cette adaptation fut le fait de Numénius qui, en valorisant Platon le théologien, Platon le bacchant, comme dira Damascius, et en éliminant du corpus sacré les sceptiques et les épicuriens, parviendra à déterminer la première orthodoxie païenne, bien avant la chrétienne, qui fut le fruit des travaux de Marcion le gnostique, et des chrétien plus ou moins bien-pensants, Origène, Valentin, Justin martyr, d’Irénée et de Tertullien. La notion centrale de cette tâche novatrice est l’homodoxie, c’est-à-dire la cohérence verticale, dans le temps, de la doctrine, unité garantie par le mythe de la « chaîne d’or », de la transmission continue de la sagesse pérenne. Le premier maillon est la figure mythique de Pythagore, mais aussi Hermès Trismégiste et Orphée. Nous avons-là une nouvelle religiosité qui relie engagement et pensée. Jamblique sera celui qui tentera de jeter les fondations d’une Église, que Julien essaiera d’organiser à l’échelle de l’Empire, en concurrence avec l’Église chrétienne.

Quand les persécutions anti-païennes prendront vraiment consistance, aux 4ème, 5ème et 6ème siècles, de la destruction du temple de Sérapis, à Alexandrie, en 391, jusqu’à l’édit impérial de 529 qui interdit l’École platonicienne d’Athènes, le combat se fit plus âpre et austère. Sa dernière figure fut probablement la plus attachante. La vie de Damascius fut une sorte de roman philosophique. À soixante-dix ans, il décide, avec sept de ses condisciples, de fuir la persécution et de se rendre en Perse, sous le coup du mirage oriental. Là, il fut déçu, et revint dans l’Empire finir ses jours, à la suite d’un accord entre l’Empereur et le Roi des Rois.
De Damascius, il ne reste qu’une partie d’une œuvre magnifique, écrite dans un style déchiré et profondément poétique. Il a redonné des lettres de noblesse au platonisme, mais ses élans mystiques étaient contrecarrés par les apories de l’expression, déchirée comme le jeune Dionysos par les Titans, dans l’impossibilité qu’il était de dire le divin, seulement entrevu. La voie apophatique qui fut la sienne annonçait le soufisme et une lignée de mystiques postérieure, souvent en rupture avec l’Église officielle.
Nous ne faisons que tracer brièvement les grands traits d’une épopée intellectuelle que Polymnia Athanassiadi conte avec vie et talent. Il est probable que la défaite des païens provient surtout de facteurs sociaux et politiques. La puissance de leur pensée surpassait celle des chrétiens qui cherchaient en boitant une voie rationnelle à une religion qui fondamentalement la niait, folie pour les uns, sagesse pour les autres. L’État ne pouvait rester indifférent à la propagation d’une secte qui, à la longue, devait devenir une puissance redoutable. L’aristocratisme platonicien a isolé des penseurs irrémédiablement perdus dans une société du ressentiment qui se massifiait, au moins dans les cœurs et les esprits, et la tentative de susciter une hiérarchie sacrée a échoué pitoyablement lors du bref règne de Julien.
Or, maintenant que l’Église disparaît en Europe, il est grand temps de redécouvrir un pan de notre histoire, un fragment de nos racines susceptible de nous faire recouvrer une part de notre identité. Car ce qui frappe dans l’ouvrage de Polymnia Athanassiadi, c’est la chaleur qui s’en dégage, la passion. Cela nous rappelle la leçon du regretté Pierre Hadot, récemment décédé, qui n’avait de cesse de répéter que, pour les Anciens, c’est-à-dire finalement pour nous, le choix philosophique était un engagement existentiel.
18:27 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie grecque, christianisme, gnosticisme, antiquité tardive, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 31 mars 2025
La lecture, une aliénation , ou une libération ?

La lecture, une aliénation, ou une libération?
Claude Bourrinet
Comment expliquer la sensation d’être « pris » par un livre comme dans le filet de Circé, l’impression d’échapper au temps vernaculaire, de ne plus penser que par truchement, d’être quasiment manipulé, voire conditionné ? Comment comprendre le rapport érotique assez fréquent entre l’auteur et le lecteur (très souvent la lectrice) instaurant entre eux, parfois, une démarche de séduction et des rapports amoureux très concrets ? Cela s’est vu avec les plus grands, et je ne citerai que Chateaubriand et ses nombreuses conquêtes, ou bien, pour faire bonne mesure, Gide et ses gitons lettrés. La « possession » générée par la lecture présente aussi de belles incarnations, fussent-elles nées de l’imagination romanesque, comme Don Quichotte et Emma Bovarysme.
Pourquoi les Grecs et les Romains se faisaient-ils lire les « rouleaux » de papyrus (les « volumen ») par des esclaves ? Pourquoi, d’ailleurs, lorsqu’ils étaient « auctores », comme Cicéron, dictaient-ils leurs textes ? Il faut bien que l’acte de lecture ait quelque chose à voir avec la conception de la liberté, qui ne pouvait être que civique, dans l’Antiquité.
Il faut donc, pour comprendre ce phénomène qui tient de la magie et de la manipulation (mais on sait que les deux domaines d’action sont parents) revenir à l’origine (du moins dans l’aire de notre civilisation).
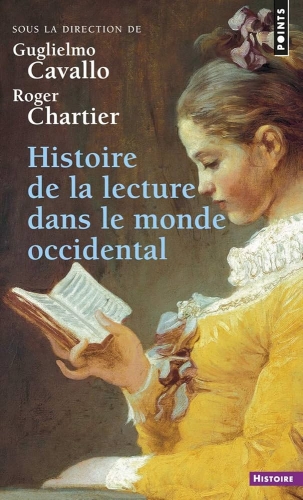
En grec, il y a plusieurs manières de dire « lire ». Nous ne les passerons pas toutes en revue, mais nous retiendrons ce qui concerne les questions ci-dessus. Je me suis servi du livre incroyablement érudit, et collectif – sous la direction de Guglielmo Cavallo et de Roger Chartier : Histoire de la lecture dans le monde occidental, aux Éditions du Seuil.
En Grèce antique, la « voix » est première. Le héros quête le « kléos », le renom, par lequel il deviendra immortel, puisqu’il est « impérissable », autrement dit la « gloire » (en langue germanique, on a un mot de même racine, le « Laut » – peut-être ce mot a-t-il la même racine que "Laudes" (louanges à Dieu), mais je n’en suis pas sûr). Homère utilise le terme pour désigner sa poésie épique, qui fut longtemps une « performance » orale, avant d’être écrite. C’est par le kleos que le héros existe, donc, aussi, son monde. La voix est créatrice de monde, et elle est intimement dépendante de la mémoire. On devine bien que l’écrit rendra, à terme, vaine, cette mémoire, et étouffera la « voix ».
De même, sur les inscriptions lapidaires funéraires, le long des chemins, par exemple, le passant est invité à proférer ce qui y est inscrit, et à haute voix, pour donner corps (ou plutôt son) à la mémoire. C’est assurer un semblant d’immortalité au mort.
L’un des mots utilisés pour désigner l’acte de « lire » est « ananémesthai ». C’est un terme en dialecte ionien, à la forme moyenne, datant, en l’occurrence, ici, du 5ème siècle, trouvé sur une stèle funéraire d’un certain Mnésithéos, en Eubée. L’épitaphe commence ainsi : « Salut, ô passants ! Moi, je repose mort en dessous. Toi qui t’approches, lis (verbe : ananémesthai) qui est l’homme enterré ici : un étranger d’Egine, du nom de Mnésithéos »
Le verbe epinémein, à la forme active, qui signifie aussi « lire », a un sens de « distribuer », qui suppose un auditoire. Mais la forme moyenne ananémesthao signifie aussi « distribuer en s’incluant dans la distribution ».
L’écriture de la stèle est évidemment en scriptio continua, comme c’est le cas de tous les écrits de l’époque, jusqu’à la fin du Moyen Âge, du reste, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’intervalles entre les mots. Il faut lire à haute voix pour comprendre. L’« orateur » sert d’intermédiaire, et « traduit » en son ce qui lui est dicté par des signes graphiques. Il a un rôle passif-actif : il reçoit, mais doit restituer. Un autre mot pour « lire » est epilégesthai », qui signifie « ajouter un dire à ». Autrement dit, le « lecteur » ajoute sa voix à l’écrit, incomplet en lui-même.
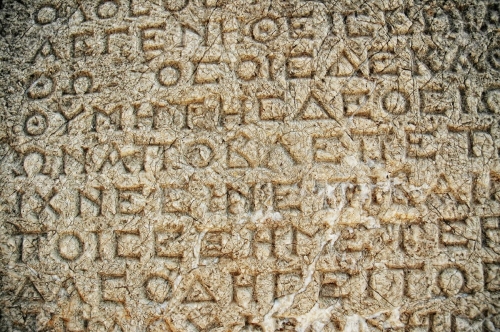
Il s’agit bien sûr d’épeler les mots inscrits (d’où le verbe anagignoskein, qui veut dire « reconnaître », mais il ne s’agit pas simplement d’ânonner des mots, de décrypter parfois péniblement (en effet, les hommes libres de l’Antiquité se faisaient une vertu de ne connaître que les rudiments de la lecture, rougissant d’en savoir davantage, et laissant le soin d’en savoir davantage aux esclaves intelligents et aux philosophes – qui étaient parfois les mêmes). Mais « reconnaissance » signifie bien davantage. On peut « connaître ses lettres », tà grammata espistasthai » sans lire vraiment, c’est-à-dire sans souder les segments de la phrase ou du texte en un sens compréhensible par le lecteur et/ou l’auditoire. Il faut que le son se transforme en langage. Ainsi les signes alphabétiques se transforment-ils en stoikheia, en « éléments constitutifs du langage ».
On voit par là que la lecture (à voix haute) FAIT PARTIE DU TEXTE (sans elle, il n’existe pas). On peut dire la même chose de la lecture silencieuse. Le texte est un « tissu » (étymologie de « texte ») qui mêle intimement graphie et son (même intériorisé).
Or, on lit, sur une inscription dorienne : « Celui qui écrit ces mots enculera (pugixei) celui qui en fait la lecture. » Le lecteur est perçu comme un partenaire passif, comme le jeune garçon est l’instrument de plaisir de l’Éraste.
A Athènes, l’homme libre qui se prostituait, d’une façon ou d’une autre, s’il mettait les pieds dans l’agora, était immédiatement mis à mort. Le jeune garçon - à qui il était bienséant de ne manifester aucun penchant excessif à son rôle de partenaire, sexuel, au contraire : il se devait d'être "chaste", comme Socrate le conseillait à Alcibiade, dans Le Banquet - cessait d’être un instrument érotique lorsqu’il devenait un homme mûr, un guerrier et un citoyen.
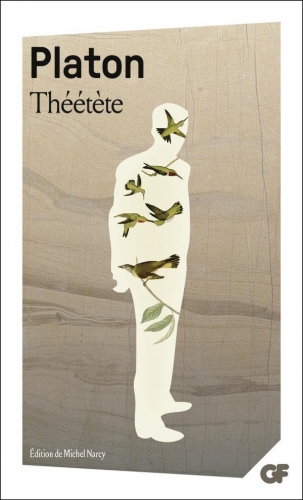
Mais on voit bien avec quel mépris est considéré le lecteur. Sa fonction est de servir, de se soumettre, d'être un jouet. Dans le Théétète, Platon se sert d’un esclave « doué de voix » pour lire un texte. C’était un esclave d’Euclide. Savoir lire savamment et abondamment fait courir le risque – dans l’état d’alors de la lecture, nécessairement orale et publique – d’être assimilé à un esclave, dont la soumission est de nature.
D’autant plus que le texte est le maître, et que son instrument ne doit manifester qu’une vertu, la fidélité. La syntaxe, la grammaire ordonnent. Cette réflexion peut nous permettre, du reste, de comprendre ce que Barthes voulait dire, lorsqu’il proclamais, vers 1970, que la grammaire était « fasciste ». (En vérité, il a dit que la langue était fasciste, mais la grammaire est une vision structurée de la langue).
On a ainsi répondu, en partie peut-être, à la série de questions posées au début de ce texte.
Mais, bien évidemment, pour nous, grands lecteurs, membres d’une civilisation qui a présenté la lecture comme une qualité essentielle de l’« honnête homme » (ou femme), comme l’un des sommets de l’excellence humaine, la lecture nous paraît plutôt comme une voie de libération (sans pour cela que la dimension originelle, de soumission érotisante, ait disparu, on le sait bien).
Il me semble que cette vocation à la liberté vient de la Bible, Livre saint, dont la lecture traduit en mots humain le Verbe de Dieu. A ce titre, tout acte de lecture met au jour les arcanes du monde, et par elle souffle l’Esprit, où Il veut, et est le germe de la Vérité, le levain qui nous fait renaître à la vraie vie.
17:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lecture, grèce antique, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 mars 2025
Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue
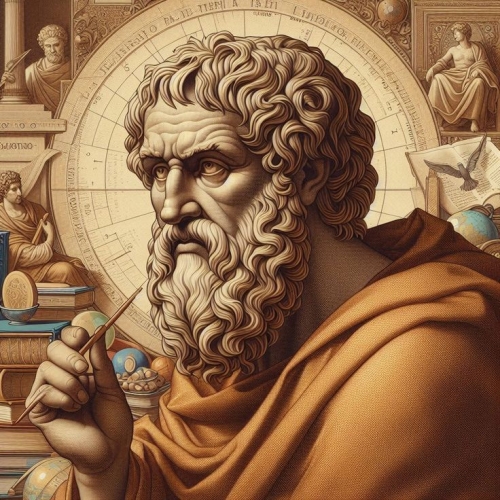
Le Paradoxe de Platon: l’extrême contemporain et le super-mythologue
François Mannaz
« Et si Platon revenait… » se demande Roger-Pol Droit. Olivier Battistini de lui répondre que Platon ne se sera jamais absenté. Il est notre « extrême contemporain ».
Cette proposition est la phrase-clé de l’ouvrage d'Olivier Battistini, consacré à Platon. Ce put en être le titre; ce sera la thèse du livre: « Platon Le philosophe-roi », bellement préfacé par Michel Maffesoli.
La biographie de Platon est courte. On sait peu de choses de lui. « Il est né » en 428 ou 427; « il est mort » en 347 ou 346. Mais il est le seul penseur grec dont l’œuvre complète nous est parvenue. (Etrange: pourquoi pas les autres? Désamour, mal-pensance, censure?)
Donc Platon tient la corde du théologiquement correct depuis deux millénaires et demi.
On saluera la judicieuse initiative de l’auteur de contextualiser son travail. Le livre contient en effet une imposante galerie des portraits: des interlocuteurs, adversaires, amis, clients, ou gitons de Platon. Cet utile catalogue fixe « les protagonistes » et « antagonistes », (ensemble leurs « caractères », statut, camp, rôle, pedigree) qui défilent sous la plume de l’auteur et constituent le paysage de « la scène à Athènes » sous Platon, Socrate et consorts.

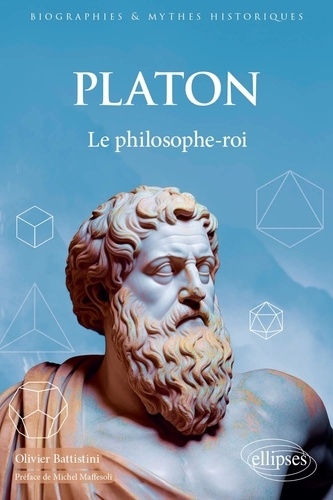
Platon « extrême contemporain », cela veut dire l’hypermoderne qui fonde et structure la modernité, ouvre et habite « l’âge axial » (Karl Jaspers) vieux de 2500 ans. Es klang so neu und war doch so alt…..
Curieusement Platon n’aura jamais été pris au sérieux de son vivant. Il n’a d’ailleurs inventé ni doctrine ni théorie, et se bornera à mettre en forme ce qui fut pensé avant lui (Battistini s’essaye à dire « système apparent »). Reste que sa griffe ne laisse de fasciner. Son savoir caché accouchera en mythe une causalité d’exception appelée à se fixer en horizon absolu de science.
Divers auteurs opinent que Platon aurait créé la « philosophie », comme si on n’avait pas pensé avant lui. Ce qui revient à faire peu de cas des millénaires de sagesse dite primordiale, des innombrables sages amants de la Sophia, et surtout des ennemis irréductibles de Platon qu’il racise en « Sophistes ». À preuve sont les écrits de bagarre de Platon lui-même. Comme Cicéron, il fait des livres de ses pugilats et les titre du nom de ses cibles. Il cogne et éborgne les porteurs de la Sophia. Parce qu’en eux le mythos honni brille de mille feux. Michel Maffesoli indique que ce mythos, c’est notre « Tradition ». Tandis qu’en face mugit leur déconstruction.
Platon n’aura de cesse que de provoquer à l’adultère philosophique. Il cancelle et wokise les mythèmes et les hérauts de la Sophia (Calliclès, Gorgias, Critias ou Protagoras). Il culpabilise ses adversaires à la faute d’impiété à l’encontre de son snobisme de clerc mercenaire. En toute occurrence, il fait « pliure » et excite au « devenir minoritaire -majoritaire » de conformation à son modèle (G. Deleuze).
Platon éclipse la « philosophie », invente le concept, la catégorie, le genre de la misosophie (doctrine accusatoire de détestation) et l’installe en tout théologique de négation de la négation, de l’en-même-temps de la théologie spéculative et de la théologie expérimentale.
Platon inaugure la figure, la fonction et l’impact de l’intellectuel, activiste, propagandiste. Un « possédé » insiste Battistini. Un « prédicateur contre l’ennemi » (Hermann Lübbe) qui excelle à faire la guerre avec les idées, les valeurs et les fétiches de la théologie expérimentale.
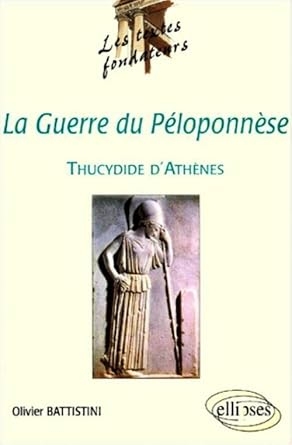
Platon est assurément un polémiste de la réaction théologique. Il n’a de cesse d’accumuler, d’activer et d’exciter à la controverse. Partout, il est à l’attraction – répulsion – scandale. Discourir toujours pour provoquer un effet théologico-matriciel. Son entreprise est toute d’agitation religieuse et politique. Platon pousse sans relâche au degré ultime d’association et de dissociation dans la cité. Il se fait bélier de la pressure policy. Sa stratégie est au choc contre la physique politique et le primat de l’autochtonie: la cité grecque n’est pour lui qu’une « hypothèse ». Platon est le mécanicien du basculement de l’état politique à l’état cosmopolitique. Il s’impose en chiffre d’une triplice particulière de métaphysique, de métapolitique et de métacognition (où meta s’entend en mise à distance du point de vue tiers). Cela donne un anti-système, une métathéologie, une épi-théologie patriarcale de la plus forte nuisance, médisance, fraudulence, modulant à la chute.
De la sorte Platon se retrouvera à la tête d’un mouvement de contestation théologique qui perdure à ce jour (Osons dire que le climat est permaplatonique). Son énergie mentale se déchaîne contre le mythe politique de la polis et du peuple politique. Son idéologie est à l’inversion; sa (mytho)graphie est à la misosophie; sa misosophie est commissionnaire et commissaire: elle charrie l’en-soph-ie ! Emblématiquement, Léo Strauss proclamera qu’avec Platon l’activité de penser revient à s’aligner, se soumettre, se conformer à l’instance supérieure du théologique. Désormais, misosopher est décision et méthode ad hoc de technique sociale (scripsit K. R. Popper).
Platon demeure la star de l’esprit néolithique qui s’étale en « dialogue » inquisitorial, en « maieutique » engagée et en « dialectique » ravageuse.
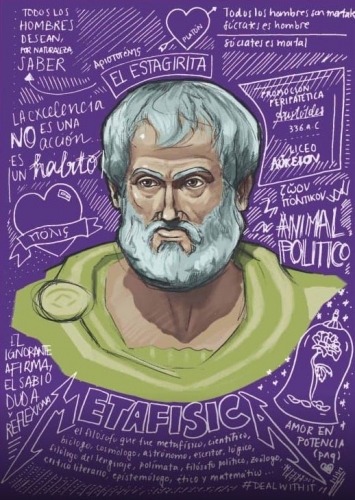
Sa rhétorique est fractale. La mise en état du monde est jeu d’attaques. La plus-value doit aller à l’insolence, à l’effronterie, à la cacologie. Il en va de « réduire l’adversaire à quia », de lui ôter toute légitimité, de le déposséder de son humanité !
Comme l’on voit, le terrorisme théologique est d’une antique actualité. Walter Benjamin précisera que « l’esprit est la capacité même à exercer la dictature » ! Pour forcer à lui obéir, ajoutera Léon Chestov !!
Le combat des idées est donc travail théologique: « Idée, c’est Dieu ». Le monde des idées c’est la pensée du dieu jaloux. C’est théâtralité de l’absence de « liberté des présupposés » (Julien Freund) et de la technologie téléologique du miraculisme . C’est surtout violence théologique qui motorise l’« image inversée », « opposé absolu », schème d’alter-culte à effet direct d’application immédiate. Qui métabolise l’excès, l’exception, l’abstraction. Qui est lavé de la Haine (Empédocle).
Et Platon sait hair: la cité, ses héros, les femmes, la mer, ses opposants, les dieux, les déesses, les poètes, les arts, les Muses,... jusqu’à « la démocratie » ! L’auteur de reproduire le brevet de M. I. Finley: « le plus puissant et le plus radical penseur antidémocratique que le monde ait jamais connu » ! Ergo, Platon roule pour l’élite. Un théologien, ça pense cybernétiquement, et politiquement ça veut » l’hégémonie ! « Les civilisations meurent »; les théologiens restent. Est-ce là « ce que penser veut dire » ?
La parole théologique est vendue comme logos Le « logos platonicien » est l’arme des armes, » l’outil politique par excellence », « theoria » en marche. Logos est toujours assaut contre ce qui est dit a-logique, c’est à dire a-causal, ir-rationnel, impie (Georg Lukacs a tout dit sur le sujet). Il mathétise la prise. Il ingéniérise la culbute de la Thèse en antithèse, de la physis en cosmos, du Nomos (ou habitus d’ordre) en « nomos » (complot, décision ou loi au sens de lex dei), du peuple (laos) en parti (demos), des dèmes en classes, de la politeia en république, de la politeia en ressentimentalité, de ressentiment en croisade de conversion, etc. Il met tout à l’envers et ostracise ceux qui sont déclarés incompatibles. Logos devient raison, grammaire, discours divin dévoilé… en égologie. Bien sûr, ce logos est proclamé « roi », totem, grenier à « valeurs ». Socrate expérimentera qu’on meure pour lui.
Dans son écrit le plus célèbre, La République, Platon déchaine sa théologie « naturelle » contre les possibles biologiques du politique mais se déploie en technocrate théocratique indexé à la loi du plus fort. Or le gars s’y connait en la matière: saches lecteur que « Platon » c’est un surnom, un nom de scène, une marque. « Platon » veut dire le balaise, le barraqué, le prolixe (la grande gueule?). Son vrai nom est Aristoclès et çà déplait à ses péripatéticiens camarades de lutte pour la dictature du socratisme (et que Saul de Tarse traitera de « chiens »).
Il convient dès lors de calibrer Platon en théologien et porteur des valises de la théologie (nous savons depuis Hans-Günther Adler qu’elle s’entend de la mentalité arrimée au désir insatiable d’expérimenter le grand remplacement du réel par une réalité nouvelle enchainée à sa causalité irrépressible). Il lui importe de déconstruire la dimension polaire de la cité, de dézinguer la physis (de l’incréé) et de mettre en déchéance théologique tout mythe alternatif au récit unique. Son but est de créer une « cité seconde « dans laquelle logos est théos », « la divinité mesure de toutes choses » (non l’hominidé… parce que homo est le jouet du dieu-dieu...), où machine quelque sombre « loi générale de l’humanité ».
Telle est la face 1 du disque Platon, celle du théologien commissionnaire des premières années.
Il est une face 2 de doxanalyse que nous offre avec brio l’auteur, celle de l’homme mûr , revenu de ses emportements pour compte d’autrui, l’homme du Mythe.

Olivier Battistini souligne la metanoia de l’homme et le tour « dans le sens opposé » de son œuvre. Il présente un Platon en sage révulsé par la « théonose », défroquant la fraude, marri de son avocature, qui fait anamnèse vers le plus lointain passé. S’agaçant d’évidence sur le tard de l’absurdité de l’idée théologique et la remisant en thèse déontologique, Platon renordisera ses réflexions. Il quêtera sur les terres inaugurales des peuples premiers en osant penser l’avant de la création confessionnelle, et donc « l’avant du mythe politique », l’hyper-alterité alternative. Il se consacrera désormais à Thulé, à l’Atlantide ou à la course fâcheuse du nomos-basileus.
Platon de nous décrire Thulé (Tula), l’ile fabuleuse de l’extrème-Nord, la matrie des Hyperboréens, « la grande aurore », par le menu. Il gagnera des renseignements de première main auprès de son marin-reporter, le navigateur Pytheas au soutien de son offre d’avoir à penser l’hyper-alternation primordialice. C’est donc fait historique avéré que Thulé aura été la terre du primordial. Celui-là même que la théologie jalousera au point d’y originer sa diatribe vengeresse contre toute fragrance et mémoire de certain passé à l’Infraction de « péché originel »qui n’en finit pas d’empester la planète. Au rebours, Platon en fait donnée qui appelle à « réminiscence », à la purge des vices, au soleil du Pôle. Ce faisant il nous offre de penser l’origine, le Nord, le paradis magnétique, loin de tout péché, hors la chute, à l’abri du sabir théomaniaque et pirate. Platon d’inviter in fine à l’hyper-sécession d’avec la modernité et de ses « ombres ».
Bien plus tard, Pierre-Simon Ballanche se résoudra à acter cette alternative de palingénésie. En deçà de la bifurcation, il y a re-départ, altercroisement, autre commencement. Inverser l’inversion est le programme. « Callipolis » ou l’architectonie à l’angle droit est le projet. Castoriadis parlera pertinemment de « contre-révolution platonicienne ».
Battistini renchérit. Il nous incite à penser Platon contre Platon, nous convoque à penser la technique de Platon contre la technologie de Platon, nous provoque à renverser la table et à nover l’espace-temps au devenir de l’extraordinaire !

Michel Maffesoli l’a bien compris, lui qui dans sa préface salue la « belle œuvre » valant « chemin initiatique » vers la Vérité. Là est le fil d’Ariane vers la vraie sagesse ayant origine et dévoilement propres; là est le socle des « potentialités » du « ce que penser veut dire » fondamentalement, fondativement, sophialogiquement; là est le travail de fixation et de concrétion à mythe contre mythe (théologie n’est d’ailleurs qu’un mythe parmi d’autres, contre tous les autres,avec une enseigne autre). La conflagration des mythes prend le nom maffésolique de « complexio oppositorum ».
Le Paradoxe de Platon signe la victoire oblique, rétroactive et sophistiquée des Sophistes et de la Sophia. Il culmine en schème de décolonisation, de désintoxication, de résonnance parfaites. Loin de toute interdiction de penser l’autre provenance-appartenance ou Denkverbot de l’épi-théologie (S. Freud). « Le réel est sophique » et nullement théologique, souligne Jean Vioulac avec force .
Olivier Battistini fait bien d’élever Platon à « génie », « maitre de la métapolitique » et réinitialisateur du devenir. C’est judicieuse offre télesmatique à la clôture de l’interrègne de la modernité. C-ar-thage n’a-t-elle pas vaincu Rome obliquement in fine ?
Après tout, Peter Sloterdijk ne conte-t-il pas que la terre est sphère, ronde, boule où tout peut rouler dans tous les sens? Dès lors, tout vient et revient, au point que l’on pourra se baigner à nouveau dans la polyversité de ses eaux… et de ses fleuves.
Lecteur, bon voyage en sophialogie.
13:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : olivier battistini, platon, philosophie, antiquité grecque, hellénisme, platonisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 août 2024
Il est déplacé de se moquer de la religion, les Jeux olympiques étaient jadis un événement sacré

Il est déplacé de se moquer de la religion, les Jeux olympiques étaient jadis un événement sacré
par Vito Mancuso
Source : La Stampa & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/sbagliato-irridere-la-religiosita-le-olimpiadi-erano-un-evento-sacro
Il fut un temps où les Jeux olympiques commençaient par une consécration, mais aujourd'hui ils ont commencé par une profanation. En fait, la profanation de la tradition chrétienne et occidentale commise lors de l'inauguration des Jeux à Paris dit quelque chose de nous : elle représente la fatuité de notre pauvre époque, elle photographie la misère culturelle et spirituelle qui les caractérise, elle est l'emblème de l'hostilité toujours plus intense à l'égard de notre histoire. Une plante sans racines se dessèche, une civilisation sans racines de même : et notre civilisation, post-chrétienne, post-occidentale, post-humaine, est depuis longtemps déracinée.

Il n'est guère d'événement culturel de masse qui ne nous le rappelle. Les mouvements langoureux des corps des soi-disant Drag Queens à Paris, récemment, dans leur parodie queer de la Cène de Léonard de Vinci (c'est-à-dire l'image picturale universellement la plus connue de la Cène de Jésus-Christ) représentaient, à ce moment-là dans le monde, l'emblème des affres dans lesquelles l'âme occidentale, hostile à elle-même et à sa propre tradition, se tord, suivant la même tendance que celle manifestée par la "cancel culture", le "wokisme" et les orientations culturelles du même genre. S'il ne faut pas béatifier le passé, selon cette vision très immature qui place tout le bien dans le passé et ne voit que le mal dans le présent, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. L'histoire, c'est nous, chantait Francesco De Gregori, ce qui signifie que nous, aujourd'hui, sommes aussi l'histoire d'hier, elle est en nous, elle nous donne les mots avec lesquels nous parlons et les idées avec lesquelles nous pensons, et toute opération qui entend "effacer", et non pas, à juste titre et de manière kantienne, "critiquer", est nécessairement destinée à ne pas comprendre et donc à faire du mal. L'ignorance, c'est mathématique, produit toujours le mal, a fortiori lorsqu'elle se présente comme "culture".

Les Jeux olympiques tirent leur nom d'Olympie, ville sanctuaire de la Grèce antique où se trouvait le grand temple dédié à Zeus Olympius, à l'intérieur duquel se trouvait l'énorme statue du dieu suprême, classée parmi les sept merveilles du monde antique, œuvre de Phidias, représentant Zeus tenant une Nike d'or dans sa main droite. À l'époque, Nike se prononçait ainsi, nikè, et non, comme aujourd'hui, *naik, et il s'agissait d'une divinité classique, pas d'un logo commercial américain. On regardait Zeus et Nike à l'époque et on leur vouait un culte sincère, contrairement à aujourd'hui où l'on regarde un nike au sens de *naik et où l'on se demande combien il coûte.
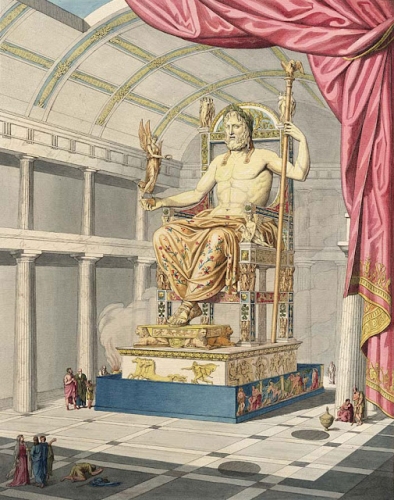
Tous les quatre ans, les célèbres compétitions athlétiques qui sont entrées dans l'histoire sous le nom de Jeux olympiques se tenaient à Olympie. L'empereur Théodose, qui avait fait du christianisme la religion d'État et déclaré illégale la religion classique, c'est-à-dire l'âme de la civilisation gréco-romaine, a également interdit les Jeux olympiques en raison des racines religieuses païennes auxquelles ils se référaient encore. Il s'agit là d'un des premiers exemples néfastes d'annulation des cultures, de cancel culture avant la lettre.. Un autre cas est celui de l'empereur Justinien qui a fermé l'école d'Athènes, le plus illustre siège de la philosophie classique, parce qu'elle était païenne et non chrétienne.

Mais revenons aux Jeux olympiques de l'Antiquité. Leur durée normale était de cinq jours : au premier, les athlètes et les juges prononçaient un serment solennel de loyauté et de respect des règles ; au troisième, devant l'autel de Zeus, avait lieu le grand sacrifice de cent taureaux, connu sous le nom d'hécatombe ; au cinquième, c'était le défilé final. C'est dans ce cadre sacré que se déroulaient les compétitions sportives : courses, luttes, sauts, courses de chars et équitation. Les prix pour les vainqueurs ? Non pas des médailles d'or, mais des couronnes de feuilles d'olivier.
Dans la Grèce antique, il existait trois autres jeux panhelléniques : les jeux pythiques, qui se déroulaient à Delphes et n'étaient à l'origine que des compétitions musicales et littéraires avant de devenir des compétitions sportives ; les jeux isthmiques, qui se déroulaient sur l'isthme de Corinthe ; et enfin les jeux néméens, parce qu'ils se déroulaient dans le sanctuaire de Zeus Néméen, dans la vallée de Némée, une ville située dans le nord du Péloponnèse. Les prix ? Des couronnes de laurier, de pin sauvage et de plantes aromatiques.
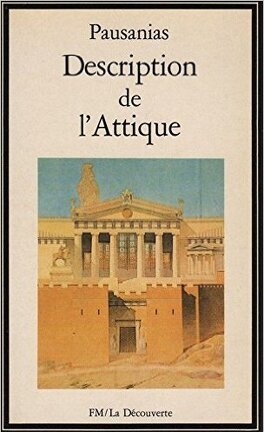 On peut lire dans le célèbre guide de la Grèce antique écrit par Pausanias à l'époque des Jeux olympiques: "Les spectacles merveilleux qu'offre la Grèce sont nombreux, et certains d'entre eux suscitent l'émerveillement de ceux qui en entendent seulement parler ; mais dans les cérémonies des mystères d'Eleusis et les jeux d'Olympie, on perçoit la présence d'un soin particulier pour le ciel". Un soin particulier des cieux, écrit Pausanias. Pour les Grecs de l'Antiquité (c'est-à-dire pour les pères de notre civilisation, auxquels nous devons encore aujourd'hui une grande partie de notre culture), prendre soin des cieux et honorer les dieux signifiait prendre soin de leur humanité et l'honorer. Aujourd'hui, cette désacralisation habituelle du divin et cette moquerie de la religion ne sont-elles pas la porte ouverte à la désacralisation de l'humain ?
On peut lire dans le célèbre guide de la Grèce antique écrit par Pausanias à l'époque des Jeux olympiques: "Les spectacles merveilleux qu'offre la Grèce sont nombreux, et certains d'entre eux suscitent l'émerveillement de ceux qui en entendent seulement parler ; mais dans les cérémonies des mystères d'Eleusis et les jeux d'Olympie, on perçoit la présence d'un soin particulier pour le ciel". Un soin particulier des cieux, écrit Pausanias. Pour les Grecs de l'Antiquité (c'est-à-dire pour les pères de notre civilisation, auxquels nous devons encore aujourd'hui une grande partie de notre culture), prendre soin des cieux et honorer les dieux signifiait prendre soin de leur humanité et l'honorer. Aujourd'hui, cette désacralisation habituelle du divin et cette moquerie de la religion ne sont-elles pas la porte ouverte à la désacralisation de l'humain ?
C'est là que le discours se complique et que l'espace dont je dispose pour cet article s'épuise. Les Grecs de l'Antiquité avaient des esclaves, ce qui n'est plus le cas, du moins officiellement. Ils étaient extrêmement machistes et les femmes ne comptaient pas ; les choses sont très différentes chez nous aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de mythifier le passé, mais, comme je l'ai déjà dit, d'en tirer des leçons, de comprendre que nous venons de là. Lorsque le christianisme s'est imposé, il a procédé à une vaste et formidable opération d'annulation culturelle de ses racines classiques en matière de spiritualité. Il serait sage pour nous aujourd'hui, postmodernes et postchrétiens, de ne pas répéter la même erreur avec un christianisme de plus en plus affaibli, mais d'honorer son héritage. C'est la manière la plus sage et la plus mature de progresser et d'évoluer tout en préservant notre humanité.

11:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, jeux olympiques, grèce antique, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 juillet 2023
Nietzsche, Solon et la dialectique du commandement et de l'obéissance

Nietzsche, Solon et la dialectique du commandement et de l'obéissance
Par Chad Crowley
Source: https://arktos.com/2023/07/14/nietzsche-solon-and-the-dialectic-of-command-and-obedience/
Chad Crowley explore l'interaction entre la philosophie de la maîtrise de soi de Nietzsche et l'accent mis par Solon sur la responsabilité communautaire, mettant en lumière la dynamique complexe de l'autorité, de l'obéissance et de la poursuite de l'excellence.
La dialectique de l'autorité, de l'obéissance et du commandement a captivé les philosophes pendant des siècles. Deux citations, l'une de Friedrich Nietzsche, "Celui qui ne peut s'obéir à lui-même sera commandé", et l'autre de Solon, législateur athénien du 6ème siècle avant J.-C., "Celui qui a appris à obéir saura commander", fournissent un cadre intrigant pour explorer cette dialectique. Malgré l'abîme temporel, ces philosophes s'engagent dans un dialogue qui éclaire notre compréhension de l'identité, de l'autorité et de la dynamique du pouvoir.
L'interaction profonde entre la philosophie de Nietzsche et la tradition intellectuelle grecque fournit un contexte riche pour interpréter ces déclarations. Nietzsche, d'abord philologue classique, vouait une profonde vénération à la philosophie et à la culture grecques. Il considérait les Grecs, notamment les philosophes présocratiques, comme les incarnations de la créativité, de la force et de la sagesse humaines.
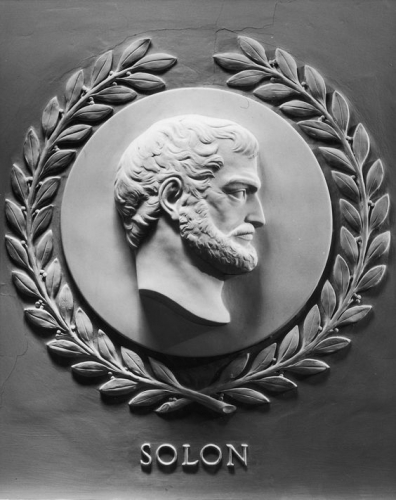
Nietzsche vouait une profonde admiration au concept grec d'arète, généralement traduit par excellence, qui signifie la réalisation de son plein potentiel. Cette quête de l'excellence résonne fortement avec la philosophie de Nietzsche, qui prône le dépassement et la création de soi, comme le montre son concept de l'Übermensch. L'Übermensch nietzschéen représente un homme qui conquiert ses propres limites, se maîtrise lui-même et affirme ainsi sa volonté sur le monde extérieur. Cette incarnation du triomphe personnel et de la réalisation de soi symbolise la réalisation ultime de l'arète.

L'idéal aristocratique grec, qui valorise des vertus telles que le courage, l'honneur et les prouesses intellectuelles, trouve un écho chez Nietzsche. Cette noblesse d'esprit est liée au concept grec d'agon, la lutte concurrentielle qui pousse à l'excellence. La philosophie de Nietzsche, bien que profondément inspirée par la tradition grecque, dépasse la simple imitation, créant une réinterprétation nuancée imprégnée de ses idées sur la volonté, le pouvoir et la nature de l'être et du devenir.
L'affirmation de Nietzsche, "Celui qui ne peut s'obéir à lui-même sera commandé", résume sa philosophie de la volonté de puissance. Elle met en avant l'acte d'auto-obéissance comme une manifestation de force, une affirmation de soi qui équivaut à l'exercice d'un pouvoir. Pour Nietzsche, le moi qui commande et le moi qui obéit sont les facettes d'une même entité, incarnant une dynamique interne complexe de pouvoir. Cette dynamique de pouvoir est fondamentalement une question de maîtrise et de force: la capacité à se contrôler soi-même est une affirmation de sa force personnelle, un testament de son pouvoir individuel. À l'inverse, ne pas s'affirmer, ne pas s'obéir, c'est se soumettre à des ordres et à des valeurs extérieurs - un abandon du pouvoir personnel et un affront à la volonté de puissance inhérente à la vie, dans la perspective de Nietzsche.
Un autre concept nietzschéen essentiel à considérer est le pathos de la distance. Cette notion fait référence à la séparation émotionnelle que Nietzsche juge nécessaire entre le haut et le bas, le noble et le commun, une séparation née de valeurs et de réalisations supérieures. Fortement influencé par l'éthique de l'aristocratie grecque, Nietzsche considérait cette distance émotionnelle comme une composante intégrale du voyage vers le dépassement de soi et l'établissement de l'Übermensch. Cette séparation est également un élément essentiel de la dialectique commandement-obéissance : ceux qui se conquièrent eux-mêmes et résistent aux normes extérieures créent une distance émotionnelle qui non seulement les distingue du troupeau, mais leur confère également l'autorité de commander, ce qui éclaire davantage la dynamique complexe de la dialectique.

En revanche, la citation de Solon, "Celui qui a appris à obéir saura commander", introduit une dimension communautaire dans la dialectique autorité-obéissance. Solon envisage la société comme une entité vivante et harmonieuse où l'homme doit adhérer à des traditions ancestrales établies afin de favoriser un monde équilibré. Apprendre à obéir n'est pas une capitulation de l'individualité, mais un acte de responsabilité sociale. De plus, par l'obéissance, on comprend la trame éthique du commandement et on devient capable de commander aux autres.
Malgré leurs différences, les perspectives de Nietzsche et de Solon ne s'excluent pas mutuellement, mais s'engagent dans une interaction dialectique. Elles reflètent différentes facettes de la condition humaine : l'accent mis sur le moi et la dynamique du pouvoir intérieur (Nietzsche) par rapport à la concentration sur la responsabilité sociale et l'harmonie communautaire (Solon). Les deux perspectives soulignent le rôle de l'obéissance dans la compréhension et l'exercice du commandement.
En bref, la philosophie de Nietzsche encourage un voyage vers la maîtrise de soi et la poursuite de l'idéal grec de l'arête, qui se manifeste dans l'Übermensch. La sagesse de Solon met l'accent sur la vertu sociétale de l'obéissance aux normes communautaires, essentielle pour un leadership efficace. Ces perspectives, malgré leurs disparités, créent une dialectique complexe entre l'autorité et l'obéissance, prônant un équilibre entre l'affirmation de soi et la responsabilité collective. Cet équilibre reflète une interprétation moderne du noble esprit grec incarné par l'Übermensch. Ainsi, le dialogue permanent entre Nietzsche et Solon, ancré dans la philosophie grecque, continue d'éclairer notre compréhension de l'identité, de l'autorité et de l'excellence.
En soutenant Arktos, vous défendez des points de vue alternatifs et contribuez à préserver le riche patrimoine ethnoculturel de l'Europe.
Qui est Chad Crowley?
Chad Crowley est un homme polyvalent qui a travaillé à la fois dans le monde universitaire et dans celui des affaires. Il vit au Canada, adhère aux principes de la Nouvelle Droite et s'intéresse profondément à l'histoire, à la culture et aux arts.
19:31 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : commandement, obéissance, grèce antique, antiquité grecque, humanités gréco-latines, solon, nietzsche, friedrich nietzsche, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 mai 2023
Fils d'Homère
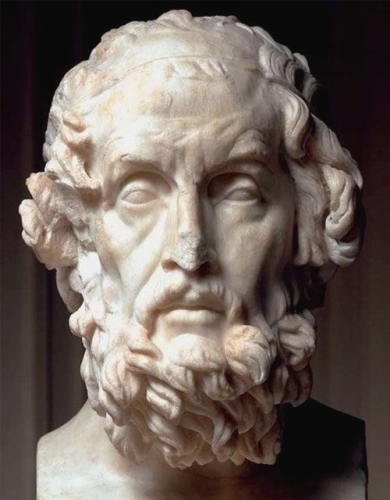
Fils d'Homère
Recension: Hijos de Homero. Un viaje personal por el alba de Occidente, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
Carlos X. Blanco
Bernardo Souvirón nous a laissé une belle introduction au monde grec, écrite avec clarté, affection et élégance. A aucun moment ce philologue ne nous accable de citations et de notes de bas de page. Il ne nous en offre que pour éclaircir ou étendre l'information. J'ai tendance à penser qu'étant professeur de lycée, le désir de se faire comprendre clairement à un public non spécialiste transparait du début à la fin du livre.

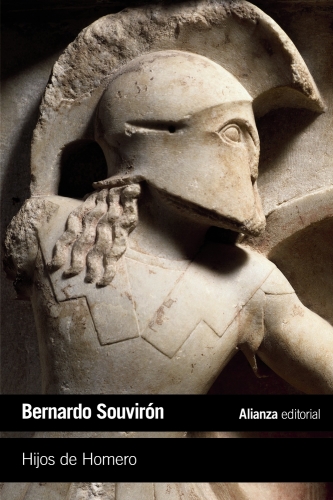
Souvirón nous raconte l'origine même de l'Europe, l'aube d'une culture, la nôtre. Une culture qui, littéralement, a son propre nom: Homère. Ce personnage, "l'éducateur de la Grèce", continue d'être aujourd'hui le symbole du poète dont le moi se cache dans les ténèbres, ne parlant jamais de lui-même, mais qui veut raconter quelle mémoire orale est passée de bouche en bouche pour former un Peuple. Homère est à la charnière entre un passé épique, purement oral, légendaire, et une Histoire déjà écrite. Une Histoire dans laquelle il a été le premier à mettre en caractères alphabétiques ce qu'il a peut-être lui-même chanté (aedo) ou récité (rhapsode). Mais Homère, le mystérieux père de l'Europe, fut aussi un créateur, un « humanisateur » de ces histoires si lointaines de héros et de dieux, et aussi d'hommes qui souffrent et meurent à la guerre, dans un monde cruel, dur et violent comme était le monde mycénien. Un monde pas si différent de celui d'aujourd'hui, aussi cruel, dur et violent. De ce sol pousse la plante de la Poésie, mais une Poésie qui est aussi Histoire (Homère est assez exact dans son récit des événements, selon l'auteur) et même le teint spirituel de l'homme européen.
Ces Mycéniens dont parle Homère étaient des peuples indo-européens qui, dans la partie la plus substantielle, ont façonné l'Europe que nous avons aujourd'hui et, à partir d'elle, le monde dans son ensemble. Les traits que l'auteur met le plus en évidence sont a) la mort légale des femmes et leur accaparement social dans tous les domaines, repris par l'homme comme machine de reproduction et b) la guerre comme mode de vie répandu dans certaines peuples qui ont besoin de butin, des esclaves et du sang pour survivre. Il n'est pas difficile d'observer ces traits essentiels dans le monde d'aujourd'hui, même si l'auteur ne pointe pas la dévirilisation actuelle de l'Européen et sa chute dans la bestialité. Au fil des siècles, au-delà de l'héritage hellénique, et surtout à la fin du Moyen Âge, grâce à l'esprit chevaleresque et aux influences celto-germaniques, les femmes européennes prennent le devant de la scène et parviennent à une réelle égalité avec les hommes. L'islamisation actuelle de l'Europe, jointe à l'inertie « lunaire » du sous-sol méditerranéen, va tout changer : la dignité spécifiquement européenne des femmes est mise en péril.
L'autre trait qui nous vient du fond indo-européen, avec lequel nous restons essentiellement mycéniens, est le bellicisme. La guerre n'a pas disparu comme moyen de résoudre les conflits. L'usage de la guerre pour transformer les peuples et les nations en animaux de proie, en bêtes qui vivent de leur proie, n'a nullement disparu et son abandon semble aujourd'hui bien plus éloigné que le premier trait, la culture patriarcale.

Il y a dans Los Hijos de Homero une série de thèses audacieuses, plutôt des hypothèses qui ont besoin d'être corroborées, qui attendent que l'Histoire, l'Archéologie et la Philologie les approuvent dans les années à venir. L'auteur propose d'effacer d'un trait de plume 300 ou 400 ans de la Chronologie standard, qui correspondent à ce qu'on appelle l'Age des Ténèbres, qui du XIIe au VIIIe siècle av. C. continue de nous présenter des énigmes. Nous ne savons rien de ces siècles, si ce n'est qu'il y a une continuité culturelle et qu'il n'y a pas de témoignages de catastrophes, d'invasions violentes, etc. Ce Dark Age s'achève avec un Homère, peut-être un Mycénien du VIIIe siècle, qui connaît presque parfaitement les événements de la guerre à Troie, malgré quelques anachronismes présents dans ses chansons. Peut-être, dit Souvirón, il y a des erreurs dans la datation chronologique dans l'établissement des synchronies. Nous laissons ici cette question, qui concerne le débat entre spécialistes, à l'avenir pour en décider.

En lisant l'excellent livre de Souvirón, nous pouvons nous souvenir de la situation dans laquelle les études classiques étaient enseignées dans l'État espagnol. Didactiquement, nous avons tous subi la difficulté actuelle de présenter la Philosophie comme une institution aux racines helléniques, et de montrer aux jeunes que la Civilisation dans laquelle nous vivons est fille de la Grèce. Enseigner le passage "du Mythe au Logos", la naissance de la Philosophie en Ionie, la prédisposition hellénique à la pensée rationnelle est une tâche énorme aujourd'hui compte tenu de l'analphabétisme en latin, en grec et, en général, dans la culture classique de la plupart de nos étudiants. Et ils ne sont pas coupables, ce sont nos législateurs, ministres et "comités d'experts" qui, par calcul politique, ont soutenu ces politiques démissionnaires. Des gens comme le professeur Adrados et bien d'autres dans la presse et dans tous les autres forums publics ont réclamé en vain contre cette déchéance. Pour certains intérêts fallacieux, il a semblé plus commode pour les politiciens et leurs "experts" (à mon avis, eux aussi des politiciens), d'inculquer aux jeunes esprits des matières supposées "pratiques", telles que l'économie, la numérisation (sic) et l'administration des entreprises, au détriment de la formation classique, clé de voûte de la compréhension de la Philosophie, des Sciences et, in fine, de l'identité des Européens. J'ose dire qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans ces matières économiques et financières au lycée et à l'université en Espagne et en Europe, et la situation économique n'a jamais été aussi mauvaise, justement.
Ils voulaient faire de nos élèves de nouveaux barbares. Ces programmes y sont parvenu de manière profonde et irréversible. Ne rien savoir d'Homère, c'est ne rien savoir de sa propre culture, de la culture européenne. Il sera très difficile de saisir le message que nous ont transmis les Présocratiques, Platon ou Aristote sans connaître les piliers sur lesquels repose notre civilisation. Ce n'est qu'avec cet analphabétisme planifié depuis la soumission de nos gouvernants à l'UNESCO et à l'Agenda 2030, et perpétué avec la loi actuelle, qu'il peut être qu'incompris dans le relativisme et le multiculturalisme crus d'aujourd'hui. Toute tradition, respectable en soi mais étrangère à notre substance culturelle, est placée dans l'esprit de nos concitoyens sur un pied d'égalité avec la tradition hellénique, et très peu d'étudiants sont aujourd'hui capables de reconnaître la leur, la nôtre, dans cette tradition hellénique. Cette situation malheureuse permet d'ouvrir toutes grandes les portes à la colonisation de l'Europe, à son aliénation aux mains d'une technocratie, qui idolâtre le nouveau ou lebizarre. Ne pas connaître les Grecs va supposer, pour l'Europe, un oubli d'elle-même. L'Europe s'africanise, s'américanise, devient une salade de traditions, mais coupe -avec elle- ses racines.
Des livres aussi instructifs, aussi bien écrits que celui de Bernardo Souvirón, servent à comprendre le bien et le moins bien de notre propre patrimoine culturel. Un conglomérat historique qui comprend la guerre et le patriarcat, oui, mais aussi la démocratie et la rationalité. Si nous ne sommes pas capables de comprendre ces racines, nous ne pourrons pas grandir ou continuer à avoir une nouvelle sève.
11:36 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : homère, grèce antique, livre, hellénisme, antiquité grecque, antiquité gréco-latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 mai 2023
L'ailleurs de la tragédie grecque: un essai de l'helléniste Davide Susanetti

L'ailleurs de la tragédie grecque: un essai de l'helléniste Davide Susanetti
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/laltrove-della-tragedia-greca-un-saggio-del-grecista-davide-susanetti-giovanni-sessa/
Un nouvel essai de Davide Susanetti, spécialiste de la Grèce antique à l'université de Padoue, dans lequel il remet en question les théories actuelles sur la tragédie attique, est désormais en librairie. Il s'agit du volume L'altrove della tragedia greca. Scene, parole e immagini (= Scènes, mots et images, publié par Carocci (pp. 187, 20,00 euros). Il ne s'agit pas de l'habituelle reconstruction historique et hérétique du théâtre tragique : "mais [...] la rencontre méditative avec une série d'images et de mots qui résonnent à partir des scènes tragiques" (p. 10) et dont l'écho dissonant parvient jusqu'à nous. Susanetti introduit le lecteur dans les moments les plus importants que le théâtre, par excellence la "pièce de Dionysos", a produits en Grèce. Il s'attarde, entre autres, sur les thèmes de l'identité, de la douleur, de la polis, du corps, de l'homme et de la femme, et de la tradition. La lecture du texte est engageante et agréable par la fluidité de la prose, qui correspond bien au métamorphisme dionysiaque mis en scène par le tragédien. L'incipit du volume nous transporte dans le proscenium des Bacchantes d'Euripide, d'où émerge avec force la figure de Penthée, roi de Thèbes. Dionysos est arrivé dans la ville : les femmes l'ont suivi dans la montagne, enivrées par sa présence troublante.
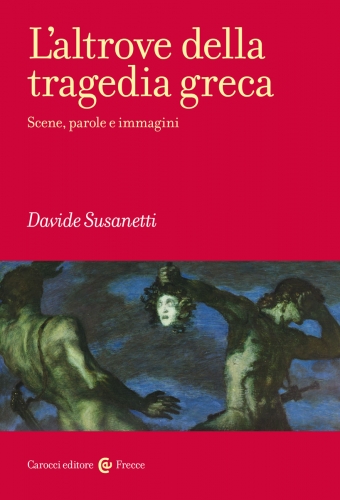

Le roi ordonne la capture du dieu, qui est ainsi conduit au palais. Aux paroles de Dionysos, qui déstabilisent le faux savoir et les certitudes apodictiques de Penthée, celui-ci ne sait que répondre tout en réaffirmant fièrement sa propre identité et sa noble naissance. Dionysos surprend: il secoue soudain le palais en lui impulsant un mouvement sismique. Le roi perd le contrôle, devient en quelque sorte le serviteur du dieu qui mène le jeu, visant à montrer l'inanité de toute identité. Il pousse Penthée sur "un chemin où, pas à pas, chaque attribut de cette identité si évidente [...] se brise, se transformant en son exact contraire" (p. 13). D'homme d'ordre, il se transforme en bacchante effrénée et est finalement mis en pièces par ses congénères, dont sa mère. Son corps est mis en pièces. Ce n'est qu'à ce moment-là que Penthée prend conscience de la signification profonde de son nom, dont l'étymologie renvoie à la "douleur". La phrase-fouet du dieu indique l'état dans lequel se trouve son deutéragoniste : "Tu ne sais pas ce que tu vis, tu ne sais pas ce que tu vois, tu ne sais même pas qui tu es" (p. 15). La potestas divine remet en question les distinctions fallacieuses produites par l'approche purement conceptuelle du réel, les indications épistémiques du lógos et toutes les opinions et les choix qui découlent de cette identité : elle indique, dans la tragédie, comme Nietzsche en avait eu l'intuition, un "au-delà" dont la plupart n'ont pas connaissance, une "unité essentielle" (Ur-eine) de la physis, qui se dit dans le multiple.
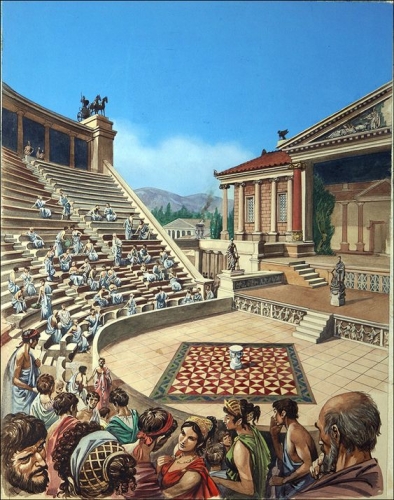
La représentation tragique montre que Dionysos dissout les liens, les identités faussement ossifiées, renouvelant le regard sur le monde. La catharsis tragique est : "la purification de l'entêtement du moi propre à chacun" (p. 18). Dans la tragédie, note Susanetti, la descente aux enfers, contrairement aux Mystères, ne se transmue pas en vita nova. L'adage tragique est traversée de la douleur, qui suggère au spectateur, même contemporain, le "surplus d'un ailleurs qui reste à compléter et à parcourir" (p. 19). Le surplus indiqué dans le chœur des Anciens d'Argos dans l'Agamemnon d'Eschyle, qui en appellent à la Sagesse qui, selon la leçon d'Héraclite : "accepte et en même temps refuse de s'envelopper dans un seul nom. L'unité de tous les contraires [...] est tó sophón : principe de toutes les déterminations, dont chacune se réfère à elle et la nomme, sans coïncider avec elle" (p. 27). La tragédie est la transcription scénique de la première locution d'Anaximandre et du trait polémologique du réel, lu comme somme de "déterminés" : "chaque chose s'affirme en exerçant son droit d'être contre le droit d'une autre [...] d'où découle dans le contraste réciproque "l'injustice" dont elles doivent payer le prix" (p. 30). Il faut, d'autre part, ne pas se croire indépendant du tout, ne pas s'enfermer dans la "pensée privée" héraclitéenne, mais propitier en soi l'intuition de l'Un-Tout, dont les entités sont l'"expression" (pour reprendre un mot de Colli).
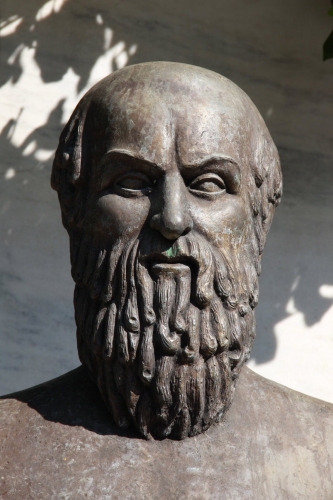
Les Supplices d'Eschyle nous placent, nous rappelle l'auteur, devant le thème du salut "possible". Le doute qui saisit le roi Pélasges, face à la demande des cinquante filles de Danaos d'être sauvées de leurs persécuteurs, est résolu par le recours au peithó (persuasion) et au túche (destin) : "les deux seules ressources sur lesquelles compter, non pas pour trouver le salut, mais pour être unis et d'accord dans ce qu'il faut faire" (p. 40). C'est la dimension communautaire et politique qui émerge, grâce à la découverte de : "La mémoire commune qui touche un temps absolu au-delà des différences que l'on saisit dans le présent" (p. 35). Nous nous référons, dans ce cas, aux événements du mythe fondateur de Io, qui unit les Danaïdes aux Argives. En conclusion : "C'est la justice de Zeus qui veille sur les suppliants, c'est la justice de la cité qui prend leur défense et celle du dieu" (p. 41). La même situation se retrouve dans le lien qui unit Coephorus et Euménides d'Eschyle. À travers la narration des événements tragiques d'Oreste, les deux pièces d'Eschyle montrent clairement comment la pólis, pour sauvegarder la "mesure" olympienne-apollinienne, doit réintégrer le tó deinón, le terrible, l'ombre du mythe, symbolisé par le pouvoir des Erinyes. La tragédie met en œuvre une "reconfiguration dans laquelle le passé est accepté et préservé au fond du présent [...] qui correspond [...] à l'idée même de tradition" (p. 51).
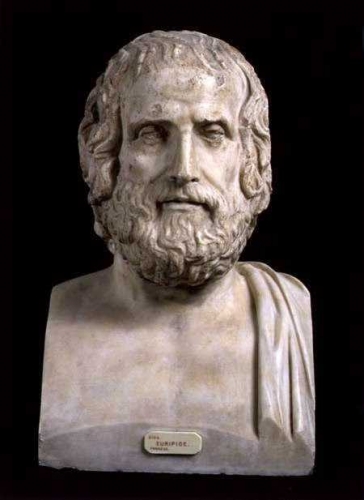
Dans les Troyennes d'Euripide, c'est le corps d'Hécube qui joue un rôle de premier plan. Un corps humilié, offensé, catatonique, symbole de l'humiliation de la cité de Priam. La douleur fait taire le corps : "La tragédie consiste [...] dans ce mouvement contraire qui suspend l'élision mortelle de la parole, qui saisit l'humain juste avant qu'il ne se précipite dans la condition de [...] "chose muette"" (p. 92). Le corps devient pur phoné, voix de la douleur pure qui s'élève à la dimension du chant. Un corps-voix dépourvu de lógos, accompagnant rythmiquement la torsion des membres fouettés par la douleur. Pas de mesure, pas d'espoir de gloire future comme dans l'épos homérique, mais le témoignage de la "vie nue" : "Poésie des corps ravagés par le malheur. Poésie qui transfigure la douleur et rappelle en même temps ce seuil de l'"invisible" auquel le mortel est destiné" (p. 99).
Face à cela, Susanetti note que Hellas lit psuché non seulement comme "vie", mais aussi comme "âme" (orphique et pythagoricienne) : "qui transmigre d'une existence à l'autre [...] la fin n'est qu'un passage" (p. 165). Cela devrait induire un certain détachement de la dimension "lourde", purement "causale" de l'être antérieur, de notre "être-au-dehors" : nous devrions ressentir cet éleos, cette pietas, dont nous faisons l'expérience lors des représentations du théâtre tragique, placés en présence des événements dans lesquels les héros sont impliqués. C'est ce même état intérieur que, selon Platon (mythe d'Er), Ulysse a ressenti au moment de choisir la "bonne" vie.
Telles sont quelques-unes des questions que Susanetti "se remémore" en ce qui concerne le tragique. Nous lui en sommes reconnaissants.
18:39 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tragédie grecque, hellénisme, antiquité grecque, grèce antique, humanités gréco-latines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 05 septembre 2022
Existe-t-il une philosophie politique dans la tradition néo-platonicienne?
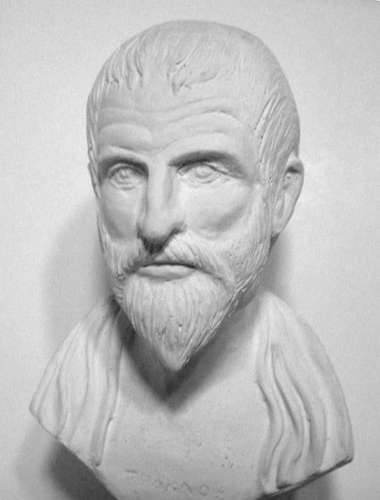
Existe-t-il une philosophie politique dans la tradition néo-platonicienne?
par Darya Platonova Dugina
Source: https://www.ideeazione.com/esiste-una-filosofia-politica-nella-tradizione-neoplatonica/?fbclid=IwAR2YJrkwCl_PayjJWpLnLQkvGQWMTXaIrBQF6C5qgdYDz0XSecdHu-xi8tQ
"Car l'État est l'homme en grand format et l'homme est l'État en petit format".
F. Nietzsche
Friedrich Nietzsche, dans ses conférences sur la philosophie grecque, a qualifié Platon de révolutionnaire radical. Platon, dans l'interprétation de Nietzsche, est celui qui dépasse la notion grecque classique du citoyen idéal: le philosophe de Platon se place au-dessus de la religiosité, contemplant directement l'idée du Bien, contrairement aux deux autres catégories (guerriers et artisans).
Cela fait plutôt écho au modèle de théologie platonique du néo-platonicien Proclus, où les dieux occupent la position la plus basse dans la hiérarchie du monde. Rappelons que dans la systématisation de Festugier, la hiérarchie des mondes de Proclus est la suivante :
- Le supra-substantiel (dans lequel il y a deux commencements : la limite et l'infini),
- le mental (être, vie, esprit),
- l'intermédiaire (esprit-pensée : au-delà, céleste, en-deçà),
- la pensée (Chronos, Rhéa, Zeus),
- Déité (têtes divines, détachées, intra-cosmiques).
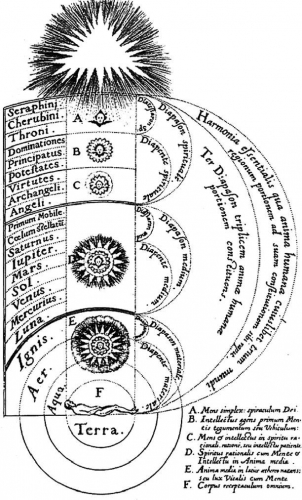
Plotin place les formes au-dessus des dieux. Les dieux ne sont que des contemplateurs de formes absolument idéales.
"Amené sur son rivage par la vague de l'esprit, s'élevant vers le monde spirituel sur la crête de la vague, on commence immédiatement à voir, sans comprendre comment ; mais la vue, s'approchant de la lumière, ne permet pas de discerner dans la lumière un objet qui n'est pas lumière. Non, alors seule la lumière elle-même est visible. L'objet accessible à la vue et la lumière qui permet de le voir n'existent pas séparément, tout comme l'esprit et l'objet-pensée n'existent pas séparément. Mais il y a la lumière pure elle-même, dont découlent ensuite ces opposés".
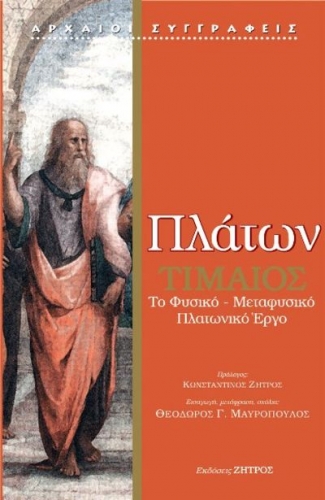
Le Dieu-Démiurge du Timée crée le monde selon les modèles du monde des idées, occupe une position intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible - tout comme le philosophe, qui établit la justice dans l'État. Il s'agit d'un concept plutôt révolutionnaire pour la société grecque antique. Elle place une autre essence au-dessus des dieux, une pensée supra-religieuse et philosophique.
La République, dialogue de Platon, construit une philosophie psychologique et politique non classique. Les types d'âme sont comparés aux types de structure étatique, dont découlent différentes conceptions du bonheur. L'objectif de chaque personne, dirigeant et subordonné, est de construire un état juste et cohérent avec la hiérarchie ontologique du monde. C'est ce concept d'interprétation de la politique et de l'âme en tant que manifestation de l'axe ontologique que Proclus Diadochos développe dans son commentaire des dialogues de Platon.

S'il est facile de parler de la philosophie politique de Platon, il est beaucoup plus difficile de parler de la philosophie politique de la tradition néo-platonicienne. Le néo-platonisme était généralement perçu comme une métaphysique visant à la déification de l'homme ("l'assimiler à une divinité"), considérée séparément de la sphère politique. Toutefois, cette vision de la philosophie néo-platonicienne est incomplète. Le processus d'"assimilation à la divinité" de Proclus, qui découle de la fonction métaphysique du philosophe chez Platon, implique également l'inclusion du politique. La déification se produit également à travers la sphère politique. Dans le livre VII du dialogue intitulé République, dans le mythe de la caverne, Platon décrit un philosophe qui s'échappe du monde des lances et s'élève dans le monde des idées, pour ensuite retourner à nouveau dans la caverne. Ainsi, le processus de "ressemblance avec une divinité" va dans les deux sens : le philosophe tourne son regard vers les idées, dépasse le monde de l'illusion et s'élève au niveau de la contemplation des idées et, donc, de l'idée du Bien. Toutefois, ce processus ne s'achève pas avec la contemplation de l'idée du Bien comme étape finale - le philosophe retourne à la caverne.
Quelle est cette descente du philosophe, qui a atteint le niveau de la contemplation des idées, dans le monde mensonger des ombres, des copies, du devenir ? N'est-ce pas un sacrifice du philosophe-réalisateur pour le peuple, pour son peuple ? Cette descente a-t-elle une apologie ontologique ?
Georgia Murutsu, spécialiste de l'État chez Platon, suggère que la descente a un double sens (un appel à la lecture du platonisme par Schleiermacher) :
1) l'interprétation exotérique explique la descente dans la grotte par le fait que c'est la loi qui oblige le philosophe, qui a touché le Bien par le pouvoir de la contemplation, à rendre la justice dans l'État, à éclairer les citoyens (le philosophe se sacrifie pour le peuple) ;
2) Le sens exotérique de la descente du philosophe dans le monde inférieur (dans le domaine du devenir) correspond à celui du démiurge, reflétant l'émanation de l'esprit du monde.
Cette dernière interprétation est très répandue dans la tradition néo-platonicienne. Le rôle du philosophe est de traduire ce qu'il contemple de manière éidétique dans la vie sociale, les structures de l'État, les règles de la vie sociale, les normes de l'éducation (paideia). Dans le Timée, la création du monde est expliquée par le fait que le Bien (transsubstantiant "sa bonté") partage son contenu avec le monde. De même, le philosophe qui contemple l'idée du Bien, en tant que ce Bien lui-même, répand la bonté sur le monde et, dans cet acte d'émanation, crée l'ordre et la justice dans l'âme et dans l'État.
"L'ascension et la contemplation des choses supérieures est l'ascension de l'âme dans le domaine de l'intelligible. Si vous admettez cela, vous comprendrez ma chère pensée - si vous aspirez bientôt à la connaître - et Dieu sait qu'elle est vraie. Voici ce que je vois : dans ce qui est perceptible, l'idée de bien est la limite et est à peine perceptible, mais dès qu'elle y est perceptible, il s'ensuit qu'elle est la cause de tout ce qui est juste et beau. Dans le domaine du visible, elle donne naissance à la lumière et à sa règle, mais dans le domaine du concevable, elle est elle-même la règle dont dépendent la vérité et la raison, et c'est vers elle que doivent se tourner ceux qui veulent agir consciemment dans la vie privée et publique".
Il convient de noter que le retour, la descente dans la grotte, n'est pas un processus unique, mais un processus qui se répète constamment (royaume). C'est l'émanation infinie du Bien dans l'autre, de l'un dans le multiple. Et cette manifestation du Bien est définie par la création de lois, l'éducation des citoyens. C'est pourquoi, dans le mythe de la grotte, il est très important de mettre l'accent sur le moment où le souverain descend au fond de la grotte - la "cathode". La vision des ombres après la contemplation de l'idée du Bien sera différente de leur perception par les prisonniers, qui sont restés toute leur vie dans l'horizon inférieur de la caverne (au niveau de l'ignorance).
L'idée que c'est la déification et la mission kénotique particulière du philosophe dans l'État de Platon, dans son interprétation néo-platonicienne, qui constitue le paradigme de la philosophie politique de Proclus et d'autres néo-platoniciens ultérieurs, a été exprimée pour la première fois par Dominic O'Meara. Il reconnaît l'existence d'un "point de vue conventionnel" dans la littérature critique sur le platonisme, selon lequel "les néo-platoniciens n'ont pas de philosophie politique", mais exprime sa conviction que cette position est erronée. Au lieu d'opposer l'idéal de la théosis, la théurgie et la philosophie politique, comme le font souvent les universitaires, il suggère que la "théosis" doit être interprétée politiquement.
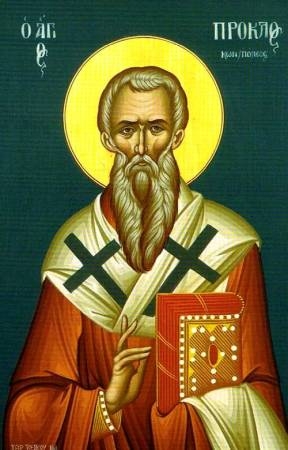
La clé de la philosophie implicite de la politique de Proclus est donc la "descente du philosophe", κάθοδος, sa descente, qui répète, d'une part, le geste démiurgique et, d'autre part, est le processus d'émanation de l'Élément, πρόοδος. Le philosophe descendant des hauteurs de la contemplation est la source des réformes juridiques, religieuses, historiques et politiques. Et ce qui lui donne une légitimité dans le domaine du Politique, c'est précisément la " ressemblance avec la divinité ", la contemplation, le "lever" et le "retour" (ὲπιστροφή) qu'il effectue dans la phase précédente. Le philosophe, dont l'âme est devenue divine, reçoit la source de l'idéal politique de sa propre source et est obligé de porter cette connaissance et sa lumière au reste de l'humanité.
Le philosophe-roi chez les néo-platoniciens n'est pas spécifique au sexe. Une femme philosophe peut également se trouver dans cette position. O'Meara considère les figures hellénistiques tardives d'Hypatie, d'Asclepigenia, de Sosipatra, de Marcellus ou d'Edesia comme des prototypes de ces souverains philosophes loués par les néo-platoniciens. Sosipatra, porteuse du charisme théurgique, en tant que chef de l'école de Pergame, apparaît comme une telle reine. Son enseignement est un prototype de l'ascension de ses disciples sur l'échelle des vertus vers l'Unique.
Hypatie d'Alexandrie, reine de l'astronomie, présente une image similaire dans son école d'Alexandrie. Hypatie est également connue pour avoir donné aux dirigeants de la ville des conseils sur la meilleure façon de gouverner. Cette condescendance dans la caverne des gens du haut de la contemplation est ce qui lui a coûté sa mort tragique. Mais Platon lui-même - voyant l'exemple de l'exécution de Socrate - prévoyait clairement la possibilité d'une telle issue pour un philosophe qui était descendu dans le Politique. Il est intéressant de noter que les platoniciens chrétiens y ont vu un prototype de l'exécution tragique du Christ lui-même.

Platon s'est préparé une descente similaire, en se lançant dans la création d'un État idéal pour le souverain de Syracuse, Dionysius, et en étant traîtreusement vendu comme esclave par le tyran adultère. L'image néo-platonicienne de la reine-philosophe, fondée sur l'égalité des femmes supposée dans la République de Platon, est une particularité dans l'idée générale du lien entre la théurgie et le domaine du Politique. Il est important pour nous que l'image de Platon de la montée/descente du philosophe de la caverne et de son retour à la caverne ait une interprétation étroitement parallèle dans le domaine du Politique et du Théurgique. Ce point est au cœur de la philosophie politique de Platon et ne pouvait être manqué et développé par les néo-platoniciens. Une autre question est que Proclus, se trouvant dans les conditions de la société chrétienne, n'a pas pu développer pleinement et ouvertement ce thème, ou alors ses traités purement politiques ne nous sont pas parvenus. L'exemple d'Hypatie montre que la mise en garde de Proclus n'était pas superflue. Cependant, en étant conscient que l'ascension/descension était initialement interprétée à la fois métaphysiquement, épistémologiquement et politiquement, nous pouvons considérer tout ce que Proclus a dit sur la théurgie dans une perspective politique. La déification de l'âme du contemplatif et du théurge fait de lui un véritable homme politique. La société peut l'accepter ou non. Ici, le destin de Socrate, les problèmes de Platon avec le tyran Dionysius, et la mort tragique du Christ, sur la croix duquel était écrit "INRI - Jésus le Nazaréen, roi des Juifs". Il est le Roi qui est descendu du ciel et qui est monté au ciel pour les hommes. Dans le contexte du néo-platonisme païen de Proclus, cette idée d'un pouvoir politique véritablement légitime aurait dû être présente et construite sur exactement le même principe : seul celui qui est "descendu" a le droit de gouverner. Mais pour descendre, il faut d'abord monter. Par conséquent, la théurgie et le fait de "ressembler à une divinité", bien que n'étant pas des procédures politiques en soi, contiennent implicitement la politique et, de plus, la politique ne devient platoniquement légitime qu'à travers elles.
La "ressemblance avec une divinité" et la théurgie des néo-platoniciens contiennent en elles une dimension politique, qui s'incarne au maximum au moment de la "descente" du philosophe dans la caverne.
20:42 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, proclus, platon, grèce antique, antiquité grecque, daria douguina, néoplatonisme, platonisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 juillet 2022
Thucydide, Athènes et notre empire anglo-américain

Thucydide, Athènes et notre empire anglo-américain
Nicolas Bonnal (2019)
Après beaucoup d’autres, la Turquie membre de l’OTAN et deuxième armée du vieux débris n’obéit plus à l’empire sémiotique et thalassocratique anglo-saxon, et elle se réunit au grand projet eurasien. Petit cap de l’Asie occupé depuis 1945, l’Europe libérale poursuivra peut-être sa voie dans l’anéantissement.
Mais voyons Thucydide.
Rien ne ressemble à nos Etats-Unis bien-aimés comme l’Athènes de Thucydide, si enjolivée par les historiens, et qui dévasta et terrorisa la Grèce pendant presque un siècle après les trop célébrées « guerres médiques » (cf. la victoire en solo contre l’Allemagne ou le « jour du débarquement »). Aucun tribut, aucune brutalité ne furent épargnés aux habitants de Mytilène, de Chio ou de Mélos, par nos démocrates devenus fous, et qui ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin, même après la raclée de Syracuse.
L’arrogance messianique américaine (« la nation indispensable ») trouve aussi un original dans le discours de Périclès : « nous sommes la nation modèle, nous sommes la seule démocratie, vous n’êtes rien ou pas grand-chose », etc. Périclès innove aussi en imposant à ses auditeurs rétribués (le peuple se fait payer en effet pour accomplir sa tâche démocratique) la guerre préventive contre Sparte, et il montrera aux malheureux hellènes que les démocrates n’ont rien à envier aux barbares pour les raffinements de cruauté. Périclès déclare même (livre I, CXLIII.) : « Ne laissez pas subsister en vous le remords d'avoir fait la guerre pour un motif futile. Car c'est de cette affaire soi-disant sans importance que dépendent l'affirmation et la preuve de votre caractère… »
Et d’ajouter avant nos anglo-américains : « La maîtrise de la mer (thalasses kratos ) est fondamentale (mega gar) »

Mais on reprendra les discours des athéniens et des méléiens, sommet de Thucydide et sans doute de l’histoire-matière ; c’est La Fontaine expliqué enfin aux grandes personnes.
Livre V de la Guerre du Péloponnèse :
LXXXIX. - Les Athéniens. De notre côté, nous n'emploierons pas de belles phrases ; nous ne soutiendrons pas que notre domination est juste, parce que nous avons défait les Mèdes ; que notre expédition contre vous a pour but de venger les torts que vous nous avez fait subir. Fi de ces longs discours qui n'éveillent que la méfiance ! Mais de votre côté, ne vous imaginez pas nous convaincre, en soutenant que c'est en qualité de colons de Lacédémone que vous avez refusé de faire campagne avec nous et que vous n'avez aucun tort envers Athènes. »
Nietzsche admirait la dimension sophiste de Thucydide. Je ne suis pas d’accord. Thucydide n’aimait pas Cléon, qui était leur disciple. Thucydide comprend surtout que les Athéniens deviennent des gangsters comme l’empire finissant américain, gangsters qui ont la bombe, que n’avaient pas les Grecs, je ne l’oublie pas. Les Athéniens se sentent protégés et invincibles :
XCI. - Les Athéniens. En admettant que notre domination doive cesser, nous n'en appréhendons pas la fin. Ce ne sont pas les peuples qui ont un empire, comme les Lacédémoniens, qui sont redoutables aux vaincus (d'ailleurs, ce n'est pas contre les Lacédémoniens qu'ici nous luttons), mais ce sont les sujets, lorsqu'ils attaquent leurs anciens maîtres et réussissent à les vaincre. Si du reste nous sommes en danger de ce côté, cela nous regarde ! Nous sommes ici, comme nous allons vous le prouver, pour consolider notre empire et pour sauver votre ville. Nous voulons établir notre domination sur vous sans qu'il nous en coûte de peine et, dans notre intérêt commun, assurer votre salut. »
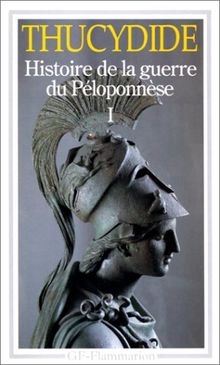
On menace méchamment comme Bolton :
XCII. - Les Méliens. Et comment pourrons-nous avoir le même intérêt, nous à devenir esclaves, vous à être les maîtres ?
XCIII. - Les Athéniens. Vous auriez tout intérêt à vous soumettre avant de subir les pires malheurs et nous, nous aurions avantage à ne pas vous faire périr.
XCIV. - Les Méliens. Si nous restions tranquilles en paix avec vous et non en guerre sans prendre parti, vous n'admettriez pas cette attitude ?
XCV. - Les Athéniens.Non, votre hostilité nous fait moins de tort que votre neutralité ; celle-ci est aux yeux de nos sujets une preuve de notre faiblesse ; celle-là un témoignage de notre puissance. »
Retenez-la celle-là : votre hostilité nous fait moins de tort que votre neutralité. Jusqu’où faudra-t-il se soumettre ?
Emmanuel Todd a rappelé que l’empire s’attaque à des petits pays périphériques. Idem pour Athènes :
XCIX. - Les Athéniens. Nullement ; les peuples les plus redoutables, à notre avis, ne sont pas ceux du continent ; libres encore, il leur faudra beaucoup de temps pour se mettre en garde contre nous. Ceux que nous craignons, ce sont les insulaires indépendants comme vous l'êtes et ceux qui déjà regimbent contre une domination nécessaire.Ce sont eux qui, en se livrant sans réserve à des espérances irréfléchies, risquent de nous précipiter avec eux dans des dangers trop visibles. »
Le discours est superbe et les athéniens presque généreux. Evitez le martyre, vous afghans, irakiens, libyens, iraniens, yéménites :
CIII. - Les Athéniens. L'espérance stimule dans le danger ; on peut, quand on a la supériorité, se confier à elle ; elle est alors susceptible de nuire, mais sans causer notre perte. Mais ceux qui confient à un coup de dés tout leur avoir - car l'espérance est naturellement prodigue - n'en reconnaissent la vanité que par les revers qu'elle leur suscite et, quand on l'a découverte, elle ne laisse plus aucun moyen de se garantir contre ses traîtrises. Vous êtes faibles, vous n'avez qu'une chance à courir ; ne tombez pas dans cette erreur ; ne faites pas comme tant d'autres qui, tout en pouvant encore se sauver par des moyens humains, se sentent sous le poids du malheur trahis par des espérances fondées sur des réalités visibles et recherchent des secours invisibles, prédictions, oracles et toutes autres pratiques, qui en entretenant leurs espérances causent finalement leur perte. »
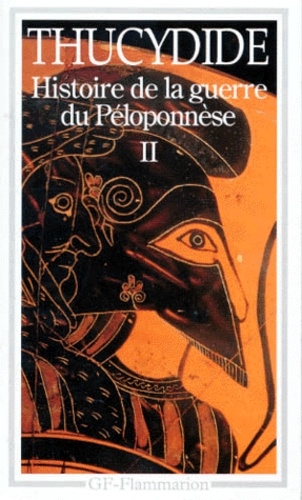
Rassurons les bourgeois du Monde, du Figaro et de BFM. Dieu est bourgeois, et il est aussi américain qu’athénien. On en veut pour preuve cette envolée suivante :
CV. - Les Athéniens. Nous ne craignons pas non plus que la bienveillance divine nous fasse défaut. Nous ne souhaitons ni n'accomplissons rien qui ne s'accorde avec l'idée que les hommes se font de la divinité, rien qui ne cadre avec les prétentions humaines. Les dieux, d'après notre opinion, et les hommes, d'après notre connaissance des réalités, tendent, selon une nécessité de leur nature, à la domination partout où leurs forces prévalent.Ce n'est pas nous qui avons établi cette loi et nous ne sommes pas non plus les premiers à l'appliquer. Elle était en pratique avant nous ; elle subsistera à jamais après nous. Nous en profitons, bien convaincus que vous, comme les autres, si vous aviez notre puissance, vous ne vous comporteriez pas autrement. Du côté de la divinité, selon toute probabilité, nous ne craignons pas d'être mis en état d'infériorité. »
Dans la tyrannie un seul homme se prend pour Dieu. Dans la démocratie, tout le système politique.
Les Méléiens finissent martyrs :
Vers la même époque les Méliens enlevèrent une autre partie de la circonvallation, où les Athéniens n'avaient que peu de troupes. Puis arriva d'Athènes une seconde expédition commandée par Philokratès fils de Déméas. Dès lors le siège fut mené avec vigueur ; la trahison s'en mêlant, les Méliens se rendirent à discrétion aux Athéniens. Ceux-ci massacrèrent tous les adultes et réduisirent en esclavage les femmes et les enfants. Dès lors, ils occupèrent l'île où ils envoyèrent ensuite cinq cents colons. »
Athènes est tellement insupportable qu’on se range autour de Sparte et qu’on rappelle même les Perses. Note du traducteur Talbot :
« Sparte, soutenue par les Perses, confia le commandement de ses troupes à Lysandre. Elle fut d'abord vaincue à la bataille des îles Arginuses, mais Lysandre infligea aux Athéniens la défaite décisive d'Ægos-Potamos ; puis il s'empara du Pirée et d'Athènes. Athènes dut signer la paix. Son empire fut entièrement détruit (404). Le récit de ces événements se trouve dans les Helléniques de Xénophon, dont l'œuvre était considérée dans l'antiquité comme un supplément à celle de Thucydide. »
Justement on va vous le citer Xénophon toujours grâce à Wikisource (ou à Remacle.org). C’est dans les Helléniques, livre 2 :
6. Toute la Grèce aussi, immédiatement après le combat naval, avait abandonné le parti des Athéniens, à l'exception des Sauriens, qui, après avoir massacré les notables, se maintinrent maîtres de la ville.
7. Après cela, Lysandre envoya des messagers à Agis, à Décélie, et à Lacédémone, pour annoncer qu'il revenait avec deux cents navires. Alors les Lacédémoniens sortirent en masse avec les autres Péloponnésiens, sauf les Argiens, sur l'ordre de Pausanias, l'autre roi de Sparte.
8. Quand ils furent tous réunis, Pausanias les conduisit contre Athènes et campa dans le gymnase appelé Académie.
9. Lysandre étant venu à Égine, rendit la ville aux Éginètes, après en avoir assemblé le plus qu'il put. Il en fit autant pour les Mèliens et pour tous les autres qui avaient été chassés de leur patrie. Ensuite, ayant ravagé Salamine, il vint mouiller près du Pirée avec cent cinquante vaisseaux et il empêcha les transports d'y entrer.
10. Les Athéniens, assiégés par terre et par mer, ne savaient que faire, n'ayant ni vaisseaux, ni alliés, ni blé. Ils ne voyaient pas d'autre moyen de salut que de se résigner à subir ce qu'ils avaient fait, non par vengeance, mais par une arrogance criminelle, aux citoyens des petits États, sans autre grief que leur alliance avec Lacédémone. »

Mais les Spartiates seront moins cruels que les Athéniens. Toujours Xénophon :
« 20. Mais les Lacédémoniens déclarèrent qu'ils ne réduiraient pas en servitude une ville grecque qui avait rendu un grand service à la Grèce, quand elle était menacée des plus grands dangers, et ils firent la paix à condition que les Athéniens abattraient les Longs Murs et les fortifications du Pirée, qu'ils livreraient leurs vaisseaux, sauf douze, rappelleraient les exilés, reconnaîtraient pour ennemis et pour amis ceux de Lacédémone et suivraient les Lacédémoniens sur terre et sur mer partout où ils les conduiraient.
21. Théramène et ses collègues rapportèrent ces conditions à Athènes. À leur entrée, ils se virent entourés d'une foule immense, qui craignait de les voir revenir sans avoir rien conclu; car il n'était plus possible de tenir, vu le nombre de ceux qui mouraient de faim.
22. Le lendemain, les ambassadeurs annoncèrent à quelles conditions les Lacédémoniens accordaient la paix. Théramène porta la parole et déclara qu'il fallait se soumettre aux Lacédémoniens et abattre les murs. Quelques-uns protestèrent; mais l'immense majorité l'approuva et l'on décida d'accepter la paix.
23. Après cela, Lysandre pénétra dans le Pirée, les exilés rentrèrent et l'on sapa les murs au son des flûtes avec un enthousiasme extrême, s'imaginant que ce jour inaugurait pour la Grèce une ère de liberté. »
La démocratie, cela finira par se savoir un jour, n’assure ni la liberté de sa population ni celle des pays lointains, surtout quand elle devient impérialiste : voyez l’Angleterre où la démocratie parlementaire fut toujours un self-service oligarchique, ploutocratique, impérial.
La suite à la prochaine croisade démocratique, et la conclusion à Périclès qui voyait la gaffe venir dans le discours cité plus haut : « Car je redoute nos propres fautes plus que les desseins de nos ennemis. »
Le monde libre peut se féliciter aujourd’hui que l’Amérique ait au pouvoir des zélotes tératologiques tels que Trump, Bolton et le pompeux Pompeo – si bien nommé. Encore un effort, camarades, et nous dormirons tranquilles...
Sources
Thucydide – La Guerre du Péloponnèse (Wikisource.org)
Xénophon – Helléniques (Remacle.org)
Emmanuel Todd – Après l’empire (Gallimard)
21:17 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : athènes, sparte, péricles, thucydide, histoire, antiquité grecque, hellénisme, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 avril 2022
La philosophie avant la philosophie: une étude innovante de Luca Grecchi

La philosophie avant la philosophie: une étude innovante de Luca Grecchi
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/la-filosofia-prima-della-filosofia-uno-studio-innovativo-di-luca-grecchi-giovanni-sessa/
Les historiens de l'antiquité et les philologues débattent des origines de la philosophie depuis des siècles. Par convention, la plupart des auteurs pensent que cette forme de pensée, qui a caractérisé le cours historique de l'homme européen jusqu'à aujourd'hui, est née avec les présocratiques au sixième siècle avant J.-C., dans les colonies ioniennes d'Asie mineure. À partir des années 1970, l'enseignement de Giorgio Colli s'est orienté vers des époques plus archaïques, puisque l'éminent spécialiste de la sagesse grecque affirmait que la philosophie était née en continuité avec le mythe, et non en opposition avec lui. Une étude de Luca Grecchi est récemment parue dans le catalogue de la maison d'édition Scholé, productrice d'une innovation importante à ce sujet. Nous nous référons à La filosofia prima della filosofia. Creta, XX secolo a.C., Magna Grecia, VIII secolo a.C. (pp. 198, euro 22.00). Le volume est précédé d'une introduction de l'archéologue Daniela Lefèvre-Novaro. L'auteur, maître de conférences à l'Université de Milan-Bicocca, a déjà publié plusieurs ouvrages sur le sujet.

Dans ces pages, il part de l'hypothèse aristotélicienne selon laquelle ce qui est en acte doit avoir été préalablement en puissance. Or, si tous les exégètes s'accordent à rapporter qu'il est possible de parler d'actualisation de la philosophie, à partir du sixième siècle avant J.-C., il est nécessaire de pousser l'investigation jusqu'aux siècles précédents pour identifier le terrain "potentiel" d'où aurait surgi la philosophie. Grecchi pose cette définition de la philosophie comme fil rouge de son propre travail exégétique : "une connaissance visant à la recherche de la vérité du tout, caractérisée par la méthode dialectique, ayant comme fondement de sens et de valeur l'homme compris dans son universalité" (p. 13). La philosophie traite de deux contenus, négligés par les sciences, la vérité et le bien : c'est une discipline qui exige une praxis capable de renverser dans une action vertueuse les acquisitions du niveau théorique. Telle était donc la philosophie dans le monde antique : "Il ne peut être accidentel [...] que la philosophia se soit formée dans la Grèce antique" (p. 17) et non en Orient, où le prérequis politique et social d'un tel développement, la polis, faisait défaut.
En utilisant une approche multidisciplinaire, dans laquelle un rôle important est attribué aux données archéologiques, Grecchi s'emploie à démontrer que le processus d'incubation de la graine philosophique peut être daté d'une époque très ancienne "et dans un lieu inattendu, à savoir au vingtième siècle avant J.-C. en Crète. Cet enracinement a influencé, de manière décisive, l'ensemble de la culture grecque jusqu'à l'époque classique" (p. 16). Et si la polis était le milieu qui permettait à la fleur philosophique de se manifester dans toute sa luxuriance, c'est encore en Crète que l'on peut retrouver l'origine de la cité-état, notamment à la lumière des études historico-archéologiques de Doro Levi et Henri Van Effenterre.

La philosophie est déjà en gestation dans les fragments des Présocratiques et c'est la connaissance qui est en quelque sorte présente, avant que le terme lui-même ne devienne communément utilisé avec Platon. Homère et Hésiode la connaissaient, mais elle avait son antécédent dans la "Crète des premiers palais, qui constitue, sur le sol hellénique, la plus ancienne expérience politique et culturelle dont nous ayons la trace" (p. 24). L'auteur rejette la lecture habituelle de l'époque minoenne, qui tend à voir l'île comme le site d'un système monarchique rigide à ce moment de l'histoire. Au contraire : "La civilisation palatiale [...] constituait [...] l'une des expériences politiques et culturelles les plus communautaires qui aient jamais existé dans tout le monde antique" (p. 25).
Dans les Palais, pour la première fois en Grèce, une réflexion a été menée sur l'ensemble compris dans ses trois éléments constitutifs : la nature, le divin et l'humain. Les gens de cette époque ont décidé comment vivre, sur quelles valeurs fonder leur coexistence civile, ils se sont interrogés sur les relations à entretenir avec les dieux et avec la nature et, surtout, ils ont remis en question la répartition des ressources, de l'espace et des biens. Ils sont arrivés à : "une 'planification communautaire' élaborée [...] Elle était [...] organisée de telle sorte que tous contribuent, de manière coopérative, au meilleur développement de la vie sociale" (p. 29). Le système palatial crétois est devenu un paradigme pour toute la civilisation hellénique. L'auteur retrace les signes de continuité entre les civilisations minoenne et mycénienne et les preuves tout aussi pertinentes de la relation entre cette dernière et l'ère classique. L'expérience sociopolitique de la Crète "avec ses palais, qui servaient de centre de coordination politique, économique, social, culturel et religieux, constituait [...] le modèle pour les siècles à venir" (p. 31), le modèle du poleis classique, dans le climat spirituel duquel se sont épanouies les écoles philosophiques fondées sur la co-philosophie et la dimension dialogique.
Sur l'île, il était entendu que le processus économique devait être confié à la planification communautaire, et non laissé à la merci du jeu des intérêts particuliers. La philosophie n'est pas seulement née face à l'émerveillement induit par la rencontre avec la physis, mais elle a été une tentative de faire taire l'angoisse existentielle qui naît chez l'homme de la conscience que notre vie est exposée au danger et à la mort. Grecchi, avec une argumentation pertinente, décrit les aspects les plus pertinents de la civilisation minoenne, en partant de la période néolithique et en soulignant les apports qu'elle a su tirer de l'Orient, il fait l'éloge de son harmonie sociale et dresse un tableau clair de l'origine de l'écriture. Il traverse les siècles que l'historiographie officielle s'obstine à définir comme "obscurs", pour pénétrer au cœur de l'œuvre d'Homère. Enfin, il montre le lien étroit entre les dynamiques sociales et culturelles dans les poleis qui ont surgi au 8e siècle avant J.-C. en Grande-Grèce et en Sicile, où la philosophie a trouvé le terrain propice pour s'épanouir définitivement.

Le livre a le mérite de montrer clairement que l'époque contemporaine est structurellement antithétique à l'épanouissement de la philosophie, tant sur le plan économique et social qu'existentiel. Cette connaissance, si elle était réellement pratiquée, comme une recherche de la vie bonne, produirait un écho dissonant par rapport au système techno-scientifique, par rapport auquel, au contraire, les "philosophies" de la rue jouent un rôle accessoire. L'analyse de Grecchi, bien que novatrice, semble négliger la pertinence du mythe dans la naissance de la philosophie. Pour remonter aux origines de la Sagesse, c'est dans cette direction qu'il faut retourner pour regarder : alors, derrière l'harmonie sociale crétoise, se révélera le visage conflictuel, chaotique de la vie. Le visage de Dionysos, le dieu né dans une caverne du mont Ida.
Giovanni Sessa.
17:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, philosophie grecque, antiquité grecque, crète, crète antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 février 2022
L'hédonisme autarcique de l'école cyrénaïque
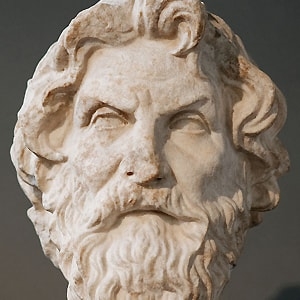
L'hédonisme autarcique de l'école cyrénaïque
Écrit par "Noorglo"
Ex: https://www.liberecomunita.org/index.php/filosofia/243-l-edonismo-autarchico-della-scuola-cirenaica
L'école cyrénaïque s'est développée à Cyrène, une ville grecque d'Afrique du Nord, dans la première moitié du IVe siècle av. J.C. L'école s'est formée quelques décennies après la mort de son initiateur Aristippe, un Cyrénéen qui avait émigré à Athènes, étudié avec Socrate et Protagoras, puis était retourné dans sa patrie pour diffuser sa pensée. Plus qu'une véritable école, on devrait parler d'une direction philosophique variée et non unique.

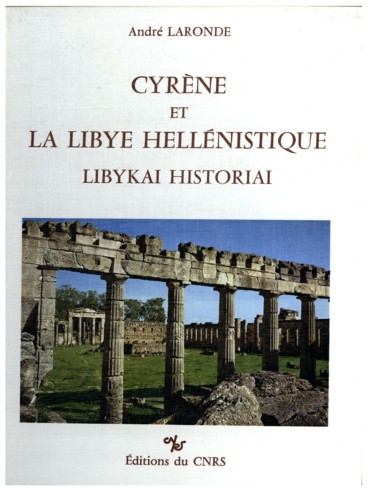
L'histoire de l'école cyrénaïque commence avec Aristippe de Cyrène, né vers 435 av. Il est venu à Athènes à un jeune âge et est devenu un disciple de Socrate. Nous disposons de peu d'informations sur ses déplacements après l'exécution de son maître en 399 avant J.-C., bien qu'il ait vécu un certain temps à la cour de Dionysius Ier de Syracuse. On ne sait pas exactement quelles doctrines philosophiques attribuées à l'école cyrénéenne ont été formulées par Aristippe. Diogène Laertius, à la suite de Diction le Péripatéticien et de Panetios, propose une longue liste de livres attribués à Aristippe, bien qu'il rapporte également que Sosicrate a déclaré qu'il n'avait rien écrit.
Parmi ses élèves, il y avait sa fille Arete, qui a transmis ses enseignements à son fils, Aristippe le Jeune. C'est lui, selon Aristocle de Messène, qui transforma les enseignements de son grand-père en un système complet, bien qu'il soit encore possible de dire que les bases de la philosophie cyrénaïque furent posées par Aristippe l'Ancien.
Plus tard, l'école se scinde en différentes factions, représentées par Annicéris de Cyrène, Hégésias de Cyrène, Théodore l'athée, qui développent des interprétations opposées de la philosophie cyrénaïque, dont beaucoup sont une réponse au nouveau système hédoniste posé par Épicure. Au milieu du IIIe siècle avant J.-C., l'école cyrénaïque était devenue obsolète ; l'épicurisme avait dépassé ses rivaux cyrénaïques en offrant un système plus sophistiqué.
L'école de philosophie cyrénaïque a donc été fondée par Aristippe, qui a fait du plaisir le but premier de l'existence. École non homogène, l'école cyrénaïque devait s'articuler intérieurement en diverses nuances éthiques et ne se retrouver que plus tard et en partie dans l'épicurisme. Épicure, en effet, a doté sa doctrine hédoniste d'un fondement ontologique et gnoséologique absent chez les Cyrénaïques, développant leur pensée exclusivement sur le terrain d'une éthique de la vie quotidienne, pragmatique et loin des principes théoriques. Aristippe caractérise cette orientation philosophique sur la base de l'anthropocentrisme, du sensualisme absolu, de la recherche du plaisir corporel et de l'autosuffisance individualiste.
Ce dernier point, qui caractérise l'hédonisme d'Aristippe, se traduit par l'énonciation d'un individualisme extrême et d'une autosuffisance non loin du cynisme, avec un certain mépris des conventions sociales et de toute tradition. Le plaisir immédiat et dynamique va de pair avec l'individualisme de la recherche du plaisir, embrassant chaque moment de l'existence qui peut l'offrir et sous quelque forme que ce soit. Seuls les faits humains sont dignes d'intérêt et les phénomènes naturels ne sont dignes d'intérêt que s'ils produisent du plaisir.
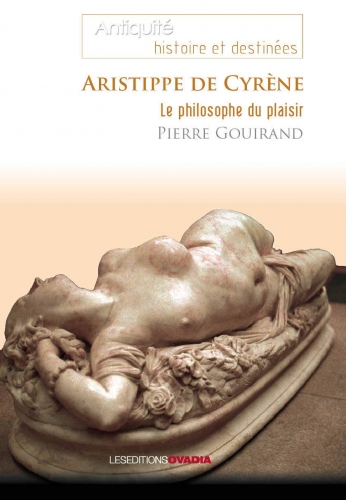
Mais l'autosuffisance, cet important principe aristippéen, concerne aussi le plaisir, qu'il faut poursuivre sans en devenir dépendant, car s'il est toujours bon, donc à poursuivre en toute situation et circonstance, s'il devient possédé, il doit être abandonné car l'autosuffisance et l'autonomie individuelle sont au-dessus de tout.
Le vrai plaisir est toujours et dans tous les cas dynamique (et non pas l'aponeia épicurienne = "absence de douleur") et constitue le véritable moteur positif de l'existence d'une personne, qui est une succession discontinue d'instants et qui doit être vécue uniquement dans le présent, en ignorant le passé et le futur : c'est une formulation ante litteram du soi-disant carpe diem, un message qui trouvera des adeptes et des interprètes surtout parmi de nombreux intellectuels du monde latin. Enfin, le phénoménalisme d'Aristippe est absolu, puisqu'il soutient que seul ce qui est perçu est réel: ce réductionnisme sensoriel et individualiste révèle également chez Aristippe des références indubitables à la philosophie sophistique.

Plusieurs chercheurs ont tendance à déplacer la théorisation de l'hédonisme cyrénaïque d'Aristippe (l'Ancien) à son petit-fils Aristippe le Métrodacte (également appelé Aristippe le Jeune) par l'intermédiaire de sa fille Arete (buste, ci-dessus), qui était une femme cultivée et sensible à la philosophie de son père. En d'autres termes, Aristippe l'Ancien se serait limité à orienter son comportement dans une direction hédoniste (mais tout de même avec une certaine mesure) et vers un certain détachement ironique aristocratique qui favorisait plutôt les éléments d'autonomie existentielle et d'autosuffisance. Selon cette interprétation, il se serait tenu à l'écart de l'hédonisme grossier dont l'école cyrénaïque fut souvent accusée par la suite.
Il serait resté fondamentalement un socratique, qui aurait conservé un certain détachement du plaisir, non sans réserves, exprimé dans l'aphorisme bien connu : "posséder le plaisir, mais ne pas être possédé par lui" (traduit en latin par habere non haberi). Il semble qu'il s'agissait d'une réponse à une critique concernant sa fréquentation d'une hétérosexuelle appelée Laide: "Je la possède, je ne suis pas possédé par elle" était sa réponse, ainsi que "il vaut mieux gagner et ne pas être esclave des plaisirs que de ne pas en profiter du tout".
Bien que, par conséquent, il ne recherchait pas seulement le plaisir catastématique "négatif" comme les épicuriens, mais surtout le plaisir cinétique et actif, Aristippe proposait la "mesure", contrairement à certains de ses élèves qui ont été définis comme proto-Libertins pour cette raison.
Après la mort du fondateur, l'école a d'abord été dirigée par sa fille Arete et son petit-fils Aristippe le Jeune. Les disciples d'Aristippe, comme nous l'avons déjà mentionné, ne constitueront jamais une école véritablement homogène, mais développent son hédonisme dans différentes directions. Cela peut être considéré comme une confirmation du manque de théorisation de sa philosophie, puisqu'il s'est limité à indiquer une direction éthique, qui à son tour peut être interprétée de diverses manières.
En dehors d'Aristippe le Jeune, dont nous avons parlé et auquel certains attribuent une intention de radicalisation dans le même cadre hédoniste, émergent comme successeurs ultérieurs trois personnages d'une profondeur notable, même s'ils ne sont pas très bien documentés, tous trois vivant entre la seconde moitié du IVe et la première moitié du IIIe siècle avant J.-C. (donc contemporains ou légèrement plus jeunes que le IIIe siècle avant J.-C.). (donc contemporains ou légèrement plus jeunes qu'Épicure) : Hégésippe, Annicéris (ou Annicerides) et Théodore l'athée.
Vision philosophique
Les Cyrénaïques étaient des hédonistes et croyaient que le plaisir, surtout le plaisir physique, était le bien suprême de la vie. Ils considéraient le type de plaisir physique comme plus intense et plus désirable que les plaisirs mentaux. Le plaisir était pour les Cyrénaïques le seul bien de la vie et la douleur le seul mal. Socrate avait considéré la vertu comme le seul bien humain, mais il avait également accepté un rôle limité pour son côté utilitaire, permettant au bonheur d'être un objectif secondaire de l'action morale. Aristippe et ses partisans en ont tiré parti et ont élevé le bonheur au rang de facteur primordial de l'existence, niant que la vertu ait une quelconque valeur intrinsèque.

Épistémologie
Les Cyrénaïques étaient connus pour leur théorie sceptique de la connaissance. Ils ont réduit la logique à une doctrine concernant le critère de la vérité. Selon eux, nous pouvons connaître avec certitude nos expériences sensorielles immédiates, mais nous ne pouvons rien savoir de la nature des objets qui provoquent ces sensations.
Toute connaissance est une sensation immédiate. Ces sensations sont des mouvements purement subjectifs, et sont douloureuses, indifférentes ou agréables, selon qu'elles sont violentes, tranquilles ou douces. En outre, elles sont entièrement individuelles et ne peuvent en aucun cas être décrites comme quelque chose qui constitue une connaissance objective absolue. La sensation est donc le seul critère possible de connaissance et de conduite. Les manières dont nous sommes affectés sont les seules que l'on puisse connaître, donc le seul but pour chacun doit être le plaisir.
Éthique
L'école cyrénaïque déduit un but unique et universel pour tous les hommes, à savoir le plaisir. Il s'ensuit que les plaisirs passés et futurs n'ont pas d'existence réelle pour nous, et que parmi les plaisirs présents il n'y a pas de distinction de genre. Socrate avait parlé des plaisirs supérieurs de l'intellect ; les cyrénaïques niaient la validité de cette distinction et affirmaient que les plaisirs du corps, plus simples et plus intenses, devaient être préférés. Le plaisir momentané, de préférence physique, est donc le seul bien pour les hommes.

Selon les Cyrénaïques, le sage doit avoir le contrôle des plaisirs plutôt que d'en être l'esclave, sinon il éprouvera de la douleur ; cela exige du jugement pour évaluer les différents plaisirs de la vie. Selon la doctrine cyrénaïque, les lois et les coutumes doivent être prises en compte, car bien qu'elles n'aient aucune valeur intrinsèque, leur violation entraînera des sanctions désagréables imposées par d'autres. De même, l'amitié et la justice sont utiles pour le plaisir qu'elles procurent.
Les derniers Cyrénaïques
Les cyrénaïques postérieurs, Annicéris de Cyrène, Hégésias de Cyrène, Théodore l'athée, ont tous développé des variantes de la doctrine cyrénaïque. Selon Annicéris, le plaisir est obtenu par des actes individuels de gratification, recherchés pour le plaisir qu'ils produisent ; Annicéris a beaucoup insisté sur l'amour de la famille, de la patrie, de l'amitié et de la gratitude, qui procurent du plaisir même lorsqu'ils exigent des sacrifices.

Hégésippide pense que le bonheur est impossible à atteindre et que, par conséquent, le but de la vie est d'échapper à la douleur et à la tristesse. Les valeurs traditionnelles telles que la richesse, la pauvreté, la liberté et l'esclavage sont toutes indifférentes et ne produisent pas plus de plaisir que de douleur. Selon le philosophe, l'hédonisme cyrénaïque était la façon la moins irrationnelle de gérer les peines de la vie.
Pour Théodore, en revanche, le but de la vie est le plaisir mental, et non le plaisir physique, et il s'attarde davantage sur la nécessité de la modération et de la justice. Dans une certaine mesure, tous ces philosophes tentaient de répondre au défi posé par l'épicurisme.
14:37 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie grecque, antiquité grecque, hellénisme, hellénité, cyrénaïques, cyrène, épicuriens, épicure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 janvier 2022
La pensée biopolitique des Grecs – entretien avec Guillaume Durocher
14:14 Publié dans Entretiens, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce antique, antiquité grecque, eugénisme, biopolitique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 janvier 2022
Luc-Olivier d'Algange: Digression néoplatonicienne

Digression néoplatonicienne
par Luc-Olivier d'Algange
« Mais que, s’ils reconnaissent dans le sensible
l’imitation de quelque chose qui se trouve dans la pensée,
ils sont comme frappés de stupeur
et sont conduits à se ressouvenir de la réalité véritable –
et certes à partir de cette émotion s’éveillent aussi les amours »
« Ainsi l’âme ne s’encombre pas de beaucoup de choses,
mais elle est légère, elle n’est qu’elle-même »
Plotin
Chaque philosophe qui parle d’un autre est livré à deux tentations égotistes. L’une consiste à montrer en quoi l’œuvre de son prédécesseur est dépassée ; l’autre, plus subtile, cède à la prétention d’apporter sur l’œuvre du passé un « éclairage nouveau ». Ces deux tentations témoignent de la farouche « néolâtrie » qui est le propre des Modernes. Seul le « nouveau » trouve grâce à leurs yeux. La déclaration d’intention novatrice se trouve être cependant, dans bien des cas, un peu vaine – d’autant plus que répétée de générations en générations, elle psittacise et cède, au moins autant que l’humilité traditionnelle, et souvent bien plus, à la redite.
Nietzsche lui-même, le plus radical et le plus prophétique des « novateurs » ne cesse d’engager avec ses prédécesseurs des joutes nuptiales dont le perpétuel recommencement montre assez que l’idée d’un « dépassement » des philosophies antérieures demeure à tout le moins problématique.
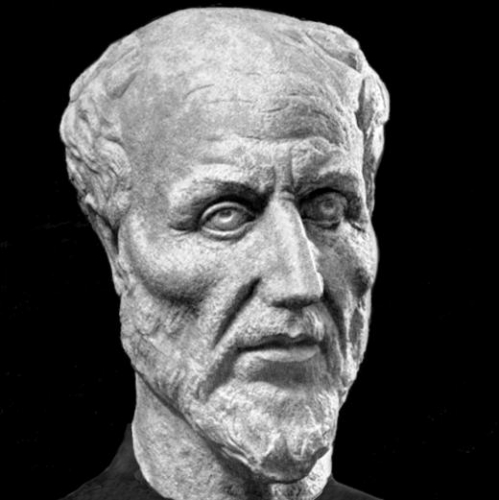
L’œuvre de Plotin se distingue des œuvres philosophiques modernes en ce que la notion de nouveauté n’y tient aucune place. Plotin ne se soucie point d’être nouveau, mais d’être vrai. Quand bien même il invente, innove, et souvent de façon décisive, sa pensée se veut celle d’un disciple, et ses plus grandes audaces se réclament encore de l’autorité de ses maîtres. Pour Plotin, il ne s’agit point d’imposer sa vérité, sa vue du monde, mais de laisser transparaître, par la fidélité au Logos, une vérité qui n’appartient à personne et dont la « transparition », en sa bouleversante luminosité, demeure hors de toute atteinte. Loin de se limiter à l’exposé didactique, au jeu du concept, voire à la morale ou à la politique, la philosophie pour Plotin est un mode de vie, une expérience métaphysique, autant qu’un savoir méditant sur lui-même.
La spéculation et l’oraison, l’aventure intellectuelle et l’aventure visionnaire, la raison et la prière participent d’une même ascèse. Pierre Hadot, dans son livre, Plotin ou la simplicité du regard, montre bien qu’il faut, dans le cheminement plotinien, donner au mot ascèse un sens sensiblement différent de celui qui prévaut communément de nos jours où ce que l’on nomme « l’idéal ascétique », généralement décrié, est perçu comme une austérité abusive, une contrition, voire comme une « auto-punition », pour user de la terminologie psychanalytique.
Rien de tel dans l’œuvre ni dans la vie de Plotin où le don de soi à une vérité et à une beauté qui nous dépassent, certes dispose à certaines épreuves, mais sans pathos outrancier, rhétorique ou théâtralité. Ce dont il s’agit, dans l’œuvre de Plotin, c’est d’aller vers Dieu, tant et si bien que ce voyage vers Dieu devient un voyage en Dieu. Or, voyager en Dieu, ce n’est point s’arracher à la nature ou à la terre, mais reconnaître en la nature le signe de la surnature et dans la terre une terre céleste.
La sempiternelle accusation formulée contre les néoplatoniciens de dévaloriser le monde sensible, d’exécrer la chair et de ne vénérer que d’immobiles idées détachées du monde ne résiste pas à la simple lecture des textes. Certes, l’idée, pour Plotin comme pour tous les platoniciens, est supérieure à la matière, en ce qu’elle est plus proche de l’être et de l’Un, mais c’est ne rien comprendre à cette idée que de ne pas voir qu’elle est d’abord, et étymologiquement, la Forme, et c’est ne rien comprendre à la Forme que de la juger abstraite, détachée du monde.
La Forme est précisément ce qui s’offre à notre appréhension sensible. Le monde sensible est peuplé de formes et c’est la matière qui est abstraite, puisque nous ne pouvons l’appréhender, la percevoir que par l’entremise d’une Forme. La philosophie néoplatonicienne est ainsi, de toutes les philosophies qui jalonnent d’histoire humaine, celle qui est la moins encline à l’abstraction, la plus rétive à se fonder sur une expérience médiate, la moins portée à éloigner l’expérience de la présence pure dans une représentation. Le matérialiste, croyant réfuter le platonisme adore la Matière – qui devient pour lui l’autre nom du « tout » – comme une abstraction, car nous avons beau la chercher, cette matière qui serait en dehors de la Forme, elle nous échappe toujours, elle n’est jamais là et toujours se dérobe à l’expérience.

La matière ne se dérobe pas au langage, puisque nous la nommons, ni à l’adoration, le matérialisme moderne étant la forme sécularisée du culte de la Magna Mater, mais bien à l’expérience immédiate qui ne nous offre que des formes, qu’elles soient vivantes ou inanimées, êtres et choses qui n’existent, ne se distinguent, ne se reconnaissent, ne se nomment, ne se goûtent, ne s’éprouvent que par leurs formes. La pensée néoplatonicienne – et c’est en quoi elle peut, elle la négatrice de toute nouveauté, nous sembler nouvelle, est une tentative prodigieuse de nous arracher à l’abstraction, de nous restituer au monde divers, chatoyant des formes, à cette multiplicité qui est la manifestation de l’Un.
La multiplicité des formes témoigne de la souveraineté de l’Un. Si l’Un n’était point l’acte d’être de toutes les formes du monde, la dissemblance ne régnerait point, comme elle règne, bienheureusement, en ce monde. Là encore, l’expérience immédiate confirme la pertinence de la méditation plotinienne. Les formes sont le principe de la dissemblance. Non seulement il n’est aucun cheval qui se puisse confondre avec un chat ou avec un renard, mais il n’est aucun cheval qui ne soit exactement semblable à un autre cheval, fussent-ils de la même race, aucune rose exactement semblable à une autre rose, fussent-elles du même bouquet ou du même buisson.
L’œuvre de Plotin est une invitation à la luminosité. Cette invitation, il nous plaît de savoir que nous ne sommes pas les premiers à y répondre. Depuis l’édition des Ennéades établie par Porphyre, qui fera l’objet au XXème siècle, de contestations plus ou moins justifiées – portant d’ailleurs davantage sur l’ordre des traités que sur leur texte –, l’œuvre de Plotin exerça une influence considérable dont il n’est pas certain que nous mesurions encore l’ampleur.
Le plotinisme oriental, théologique et théophanique, en particulier celui de Sohravardî, des ismaéliens et des soufis, échappe encore en partie à nos investigations, un grand nombre de textes ismaéliens demeurant hors d’atteinte, protégés par leurs héritiers, par le « secret de l’arcane » si bien que les chercheurs ne les connaissent que par ouï-dire. Nous sommes informés de l’influence de la pensée de Plotin sur les philosophes, tels que Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole, mais nous sous-estimons encore son influence sur les poètes modernes, tels que Shelley, Wilde,, Rilke, Stefan George ou Saint-Pol-Roux. Il n’est pas impossible que les songeries héliaques du premier Camus, celui de Noces, aient été influencées par l’auteur des Ennéades auquel Camus, en ses jeunes années, consacra sa thèse de philosophie.
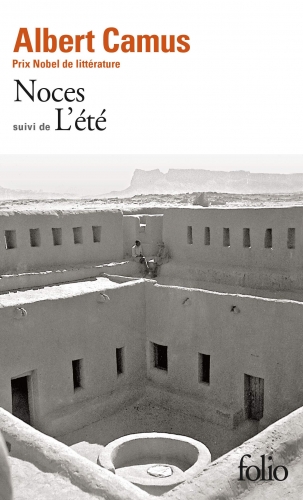
Dans le domaine de l’Art, hormis les Symbolistes et les Préraphaélites, largement influencés par le néoplatonisme, nous voyons un Kandinsky retrouver dans la définition qu’il donne du Beau une pure formulation plotinienne : « Est beau ce qui procède d’une nécessité intérieure de l’âme. Est beau ce qui est beau intérieurement. »
De tous les philosophes, Plotin est sans doute, avec Nietzsche, mais pour des raisons semble-t-il diamétralement opposées, celui qui s’accorde le plus immédiatement à une sensibilité artistique. L’idée, qui est cette « nécessité intérieure », n’est en effet nullement une abstraction. Le mot de « concret » lui convient parfaitement pour peu que notre audace herméneutique nous porte à imaginer un « supra-sensible » concret et à ne point limiter le « concret » aux objets qui s’offrent directement à nos sens. La distinction entre l’idée et l’abstraction est ici essentielle. La pensée de Plotin n’est pas seulement une pensée de la pensée ; elle n’est point « abstraite » des êtres et des choses. Elle hiérarchise, gradue, distingue, mais ne sépare point. Pour Plotin, philosopher, ce n’est point s’abstraire de la multiplicité, mais s’intégrer dans une unité supérieure. Il ne s’agit point de quitter un monde pour un autre, de se séparer des êtres et des choses, mais de s’élever et d’élever ces êtres et ces choses à une unificence divine qui les délivre de la fausseté et de l’inexistence pour les restituer à elles-mêmes, c’est-à-dire à leur réalité qui est vraie et à leur vérité qui est réelle. L’idée du beau n’est pas en dehors des beautés diverses, sensibles et intelligibles du monde, mais en elles. C’est à ce titre qu’il est légitime de dire, de l’idée plotinienne, qu’elle est une transcendance immanente, un supra-sensible concret qui échappe à nos seuls sens comme elle échappe à l’intelligence abstraite.
Schopenhauer, dans Le Monde comme Volonté et Représentation, souligne l’importance de cette distinction nécessaire et fondatrice entre l’Idée et le concept abstrait : « L’Idée, c’est l’unité qui se transforme en pluralité par le moyen de l’espace et du temps, formes de notre aperception intuitive ; le concept au contraire, c’est l’unité extraite de la pluralité au moyen de l’abstraction qui est un procédé de notre entendement ; le concept peut être appelé unitas post rem, l’Idée unitas ante rem. Indiquons enfin une comparaison qui exprime bien la différence entre concept et Idée ; le concept ressemble à un récipient inanimé ; ce qu’on y dépose reste bien placé dans le même ordre ; mais on n’en peut tirer, par des jugements analytiques, rien de plus que ce qu’on y a mis (par la réflexion synthétique) ; l’Idée, au contraire révèle à celui qui l’a conçue des représentations toutes nouvelles au point de vue du concept du même nom ; elle est comme un organisme vivant, croissant et prolifique capable en un mot de produire ce que l’on n’y avait pas introduit. »
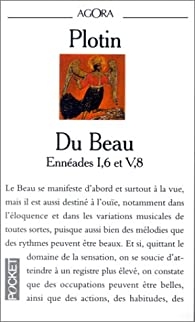 L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »
L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »
On ne philosophe jamais seul. Toute philosophie est une conversation. Est-il possible aujourd’hui de philosopher avec Plotin, de susciter, avec les Ennéades, un entretien dont les résonances s’approfondiraient de tout ce que nous éprouvons hic et nunc, de tout ce que cet « hic et nunc » nous donne à penser et à éprouver ? Notre dialogue intérieur, certes, sera différent de celui que Porphyre, Sohravardî ou Marsile Ficin eurent avec Plotin. Considérons alors l’espace-temps – incluant les différences historiques, religieuses et linguistiques – comme un prisme qui divise, en couleurs diverses, l’éclat d’une même clarté. Cette clarté nous ne pouvons l’atteindre d’emblée, nous ne pouvons en avoir la connaissance absolue dans l’immédiat. Notre lecture passe par le prisme de l’espace-temps tel qu’il se présente à nous. Est-ce à dire que cette clarté nous est plus lointaine qu’à Marsile Ficin ou Sohravardî et que, par cet éloignement, nous dussions nous contenter de considérer l’œuvre de Plotin comme un document concernant des temps définitivement révolus ? Ce serait ignorer, déjà, que le révolu est précisément ce qui revient ; ce serait surtout méconnaître ou refuser de voir ce que nous dit l’œuvre de Plotin, ce serait refuser le don de l’œuvre, ce qu’elle nous donne à penser et qui, explicite-ment, se donne par-delà les contingences de l’espace et du temps.
Lisons donc, tentons de lire à tout le moins, ces traités comme s’ils avaient été écrits ce jour même . Leur premier abord, ingénu, offre-t-il d’ailleurs de si grandes difficultés ? Les phrases de Plotin nous semblent-elles si obscures que nous dussions les traiter comme des documents anthropologiques et non comme une parole qui nous est adressée, comme un murmure au creux de l’oreille ? Combien d’œuvres de la littérature moderne ou contemporaine nous sont plus opaques, mieux défendues, plus rigoureusement barricadées dans leur idiome, dans leur singularité extrême ? Alors que les critiques sont loin encore d’avoir même une vague idée des références à l’œuvre dans le Finnegan’s Wake de Joyce ou dans les Cantos de Pound, les références de Plotin nous sont d’emblée presque toutes connues avant même que nous abordions l’œuvre pour peu que nous eussions été préalablement un lecteur de Platon. Ce dont il parle ne saurait nous être étranger puisqu’il s’agit du Bien, du Beau et du Vrai et que chacun d’entre nous ne cesse de considérer les actes, les œuvres, les sciences selon un rapport avec le bien, le beau et le vrai.
Enfin, la philosophie de Plotin étant un élan de dégagement de la contingence historique et sociale, celle-ci ne l’informe que par le biais et fort peu, si bien que notre relative méconnaissance de la société du temps de Plotin ne nous interdit nullement d’entendre ce qu’il nous dit. Disons : bien relative méconnaissance, car, à celui qui s’y attache, les données sont peut-être offertes en plus grand nombre, en l’occurrence, que sur d’autres régions, dont il est le contemporain et peut-être le voisin ; les différences de classe, de quartier induisent de nos jours des disparités de langage peut-être plus réelles et plus profondes que celles qui séparent un lettré moderne d’un lettré de la période hellénistique.
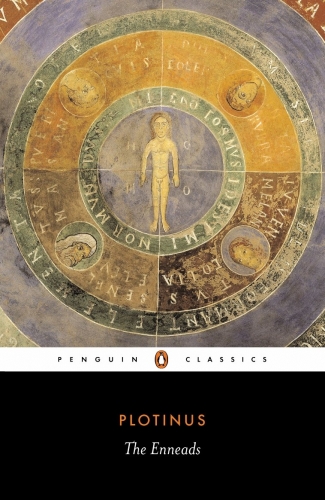
Ce qu’il y a de plus essentiel dans une œuvre se laisse comprendre à partir de ce qui semble être un paradoxe. En marge de la doxa, c’est-à-dire de la croyance commune, le paradoxe est l’antichambre ou le frontispice de la gnosis, de la connaissance. Il y a du point de vue des croyances et des philosophies modernes de nombreux paradoxes dans l’œuvre de Plotin. La grande erreur des Modernes est d’attribuer à l’Idée plotinienne les caractéristiques propres à leurs concepts. Cette abstraction figée, despotique, séparée du sensible, ce mépris de la diversité heureuse ou tragique du Réel, ce dualisme qui scinde en deux mondes séparés ce qui est perceptible et ce qui est compris, ce qui relève de l’émotion esthétique et ce qui s’ordonne à la raison, n’appartiennent nulle-ment à l’œuvre de Plotin, ni à celle de Platon. À ce titre, il n’est pas illégitime de retourner contre les « anti-platoniciens », leurs propres arguments.
Les « intellectuels » modernes, dont on ne sait s’ils s’arrogent cette appellation par prétention vaine, par antiphrase ou par défaut – leur croyance la plus commune consistant à nier l’existence même de l’Intellect – propagent volontiers l’idée que leur époque est celle de la diversité, du foisonnement, de l’éclatement « festif » et « jubilatoire », voire, lorsqu’ils se piquent de culture classique, d’un « rebroussement vers le dionysiaque » qui nous délivrerait enfin du carcan des époques classiques, médiévales ou antiques, si « normatives » et « dogmatiques ».
À celui qui dispose de la faculté rare de s’abstraire de son temps, à celui qui sait voir de haut et de loin les configurations historiques, religieuses ou morales et ne serait point dépourvu, par surcroît, de la faculté, propre aux oiseaux de proie, de fondre sur les paysages des temps contemporains ou révolus jusqu’à en éprouver la présence réelle, une réalité tout autre apparaît. Cette modernité, qu’on lui vante chatoyante, lui apparaîtra tristement uniforme et grisâtre, et ces temps anciens réputés sévères surgiront devant son regard comme des blasons ou des vitraux, ou mieux encore, comme des forêts blasonnées de soleils et de nuits dont les figures suscitent et soulignent les oppositions chromatiques. Les philosophies modernes, se révéleront à lui d’autant moins diverses que chacune d’elles, comme dressée sur ses ergots, n’aura cessé de prétendre à « l’originalité », à la « rupture », à la « nouveauté ».
En philosophie, non moins que dans nos mœurs, l’individualisme systématique devient un individualisme de masse et la prétention à la singularité ne tarde pas à donner l’impression d’une grande uniformité. Ce qui distingue Lucrèce de Pythagore, Héraclite de Parménide ou encore Saint Augustin de Maître Eckhart brille d’un éclat beaucoup plus certain, d’une force de différenciation beaucoup plus puissante que tous les discords et disparates que l’on souligne habituellement chez les Modernes. Dans l’outrecuidance des singularités et des jargons, les dialogues n’ont plus lieu, chacun s’en tient à son idiome et les disciples, lorsqu’il s’en présente, ne sont que les gardiens des mots, les vigiles du vocabulaire, les idolâtres de la lettre morte.
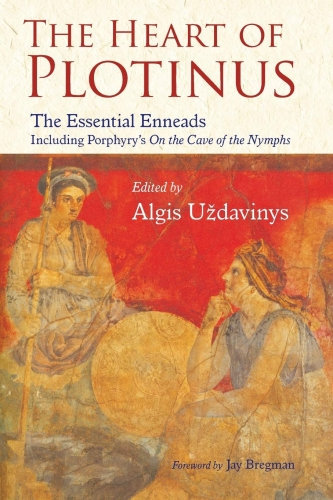
Il semblerait que les philosophes modernes soient d’autant plus soucieux de se distinguer par leur vocabulaire qu’ils se sont plus uniformément dévoués au même dessein, à savoir « renverser » ou « déconstruire » ce qu’ils nomment « le platonisme ». Chacun y va de sa méthode, de ses sophismes, de sa prétention, de ses ressentiments ou de ses approximations pour tenter d’en finir avec ce qu’il croit être la pensée ou le « système » platoniciens. Derrida traque les survivances platoniciennes dans la distinction du signifié et du signifiant. Deleuze, plus subtil et plus aventureux, propose le « rhizome » susceptible de déjouer la prétendue opposition de l’Un et du Multiple. Sartre croit vaincre la métaphysique, considérée comme une ennemie, en affirmant la précellence de l’existence sur l’être. Ces belles intelligences suscitèrent d’innombrables épigones, tous plus acharnés les uns que les autres à affirmer la « matérialité » du texte au détriment du Sens et la primauté du « corps » sur l’Esprit.
Cet unisson à la fois anti-platonicien et anti-métaphysique ne donne cependant de la pensée contre laquelle il se fonde et par laquelle il existe qu’une image caricaturale. Le lecteur attentif, dégagé des ambitions novatrices, cherchera en vain dans les dialogues de Platon le « système » dénoncé. Les textes contredisent ce qui prétend les contredire. On discerne mal dans le magnifique entre-tissage d’arguments et de contre-arguments des Dialogues, cette pensée qu’il serait si aisé de « renverser » ou ce « système » qu’il faudrait « déconstruire ». Ce qui, en l’occurrence, se trouve renversé ou déconstruit n’est qu’un résumé scolaire, un schéma arbitraire, une hypothèse mal étayée.
Nos philosophes qui se croient novateurs alors qu’ils ne sont que modernes, c’est-à-dire plagiaires ingrats, ne renversent et ne déconstruisent que ce qu’ils ont eux-mêmes édifié et construit pour les besoins de leur démonstration. Leur volonté est certaine : en finir avec l’Idée, le Logos, le Sens, la Vox cordis, mais les instruments de leurs démonstrations sont défaillants et leurs arguments sont fallacieux. L’exposé des idées qu’ils combattent est trompeur, tant il se trouve subordonné à leur argumentaire et, pour ainsi dire, fabriqué de toutes pièces pour les besoins de la cause. Platon ne dit pas, ou ne dit pas seulement ce qu’ils envisagent, non sans vanité, de contredire, et la logique même de leur contradiction, soumise à l’arbitraire de celui qui fait à la fois les questions et les réponses, masque difficilement l’envie de celui qui dénigre une audace intellectuelle qu’il pressent demeurer hors de sa portée. Il lui faudra donc, avant même d’engager les hostilités, réduire l’adversaire à sa mesure, le portraiturer à son image.

Anti-platonicienne, la doxa moderne est aussi, de la sorte, caricaturalement platonicienne. Elle suppose que tous les ouvrages de Platon se résument à l’opposition de l’Idée et du monde sensible, à une sorte de dualisme, aisément réfutable, entre deux mondes, alors même que Platon unit ce qu’il distingue par une gradation infinie. Ce système dualiste qui oppose le corps et l’esprit, l’intelligible et le sensible, l’Un et le Multiple, et auquel les Modernes prétendent s’opposer, c’est le leur. Lorsque Platon et les platoniciens unissent ce qu’ils distinguent, comme le sceau invisible et l’empreinte visible, nos Modernes s’en tiennent à l’opposition, au dualisme, en marquant seulement – ce qu’ils imaginent être une faramineuse nouveauté ! – leur préférence pour le corps, pour le sensible, pour le multiple, autrement dit pour l’empreinte, en toute ignorance de la cause et du sceau. Dualistes, ces chantres de la primauté du corps le sont éperdument puisqu’ils l’opposent à l’Esprit et leur éloge du Multiple n’est jamais que l’envers outrecuidant de la célébration de l’Un. Ce qui manque à ces gens-là, ce n’est point la dialectique – encore que ! – c’est bien le sens platonicien de la gradation infinie.
Je m’étonne que personne jusqu’à présent n’ait esquissé une physiologie de l’anti-platonicien ou ne se soit aventuré à interroger précisément, et selon l’art généalogique, les origines de cette hostilité à l’Esprit et au Logos. Que cache ce repli sur le corps et la matière conçus comme le « négatif » de l’Esprit nié ? Quelle est la nature du ressentiment dans l’affirmation du corps et de la matière comme « réalités premières » dont toutes les autres, métaphysiques ou « idéales », ne seraient que les épiphénomènes ? À quelles rancœurs obscures obéissent ces sempiternelles redites ? Quelle image du monde proposent-elles ? Si les mots gardent un sens où rayonnent encore leurs vérités étymologiques, force est de reconnaître que ces philosophes d’obédience anti-platonicienne font ici figure de réactionnaires. Niant l’Idée, qui leur apparaît coupable d’intemporalité et d’immatérialité, ils en viennent tout naturellement à opposer la matière et le temps à l’Esprit et à l’Éternité dont elles sont, selon Platon, la forme et l’image mobile. Or, dans la langue grecque, dont Platon use avec un bonheur propre à susciter la rage des consciences malheureuses, la forme et l’Idée se rejoignent en un seul mot : idéa.
Cette idée qui est la Forme et cette forme qui est l’Idée apparaissent, pour des raisons qu’il s’agit d’éclaircir, comme insoutenables à la pensée exclusive-ment réactive des Modernes, qui préfèrent rendre la pensée impossible ou la déclarer telle, plutôt que de reconnaître le monde comme ordonné par le Logos ou par le Verbe. Ce refus de reconnaissance, cette ingratitude foncière, cette vindicte incessante, cette accusation insistante, le Moderne voudra l’ennoblir sous les appellations de « contestation » ou de « subversion », lesquelles, nous dit-on, sont au principe du « progrès » et des conquêtes de la « démocratie » et de la « raison ». Ces pieux mensonges satisfont à la raison de celui qui n’en use guère, mais laisse dubitatif l’intelligence distante, dont nous parlions plus haut, par laquelle ce corps, cette multiplicité idolâtrée demandent encore à être interprétés dans le jeu inépuisable de leurs manifestations. Nos matérialistes de choc qui, en bons consommateurs, ne se refusent rien, ne se sont pas privés d’enrôler Nietzsche dans leurs douteuses campagnes. Nietzsche, qui, soit dit en passant, ne croyait nullement en l’existence de la matière, se trouve ainsi réduit au rôle de magasin d’accessoires pour les « philosophes » éperdus à trouver quelques justifications présentables à leur ruée vers le bas. Seulement, l’accessoire le plus usité, à savoir la critique que Nietzsche fait des arrière-mondes et du ressentiment, se retourne contre eux, car, à vanter le corps au détriment de l’Esprit, la lettre et le « fonctionnement du texte » au détriment du Logos et de son magnifique cœur de silence, nos Modernes illustrent à la perfection la parabole de la paille et de la poutre. Ce corps, cette matière auxquels ils veulent restituer la primauté ne sont pour eux que des réalités abstraites, qui n’existent que par l’abstraction ou l’ablation, pour ainsi dire chirurgicale, de l’Esprit.
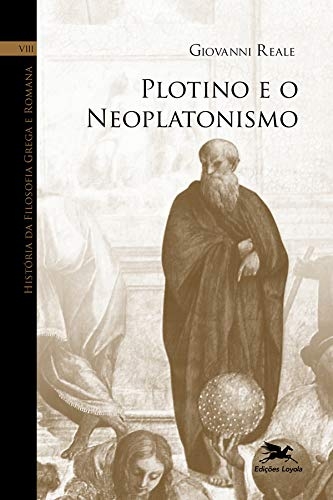
Le Moderne veut que le corps soit, en lui-même, que la matière soit, en elle- même, en même temps qu’il dénie à l’âme, à l’Esprit – gardons l’insolence et l’ingénuité de la majuscule – et même au cœur, toute possibilité de prétendre à cette réalité « en soi ». Ce platonisme inverti prétend nous emprisonner à jamais dans la représentation subalterne, seconde, de la pensée qu’il parodie en l’inversant. Alors que les œuvres de Platon, de Plotin, de Proclus – comme celle de tous les philosophes dignes de ce nom, qui aiment la sagesse, c’est-à-dire le mouvement de leur pensée vers la vérité dont elle naît – nous enseignent à nous délivrer d’elles-mêmes, à devenir ce que nous sommes, nos anti-platoniciens de service – qui sont, la plupart du temps, des fonctionnaires d’un État qu’ils dénigrent – n’existent qu’en réaction à ce qui pourrait se détacher de leurs systèmes, échapper à leur pouvoir, et vaguer à sa guise, qui est celle de l’Esprit, qui souffle où il veut.
Le corps qu’ils idolâtrent, et dont ils font une abstraction d’autant plus revendiquée qu’elle est, par définition, moins éprouvée, loin d’être le principe d’une relation au monde, et donc, d’une pérégrination du Logos, n’est, au mieux, que le site d’une expérimentation refermée sur ses propres conditions. Philosophes, ou mieux vaudrait dire idéologues du Non, du refus de la relation, le corps et la matière, qu’ils installent en médiocres métaphysiciens croyant ne l’être plus à la place de Dieu, ne valent que par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Une philosophie de l’assentiment, une philosophie du Oui resplendissant de toute chose, et de toute cause, cette philosophie, que l’on trouve au cœur même de la pensée Héraclite, de Maître Eckhart et de Nietzsche, leur est la plus étrangère, la plus inaccessible. Le corps qu’ils vantent abstraitement et dont ils n’éprouvent point la nature spirituelle n’est pour eux qu’une arme contre l’Esprit. L’« idéal » de ces anti-idéalistes est de peupler le monde de corps sans esprit, c’est-à-dire de corps pesants, fermés sur eux-mêmes, réduits à leurs plus petits dénominateurs communs, en un mot des « corps-machines ». La science, qui suit l’idéologie bien plus qu’elle ne la précède, s’applique aujourd’hui à déconstruire et à parfaire ces mécanismes, non sans cultiver quelque nostalgie d’immortalité, mais d’une immortalité réduite aux dérisoires procédures californiennes de la survie prolongée, voire de l’acharnement thérapeutique.
La distinction platonicienne du sensible et de l’intelligible ouvre à celui qui la médite des perspectives à perte de vue, où la « vérité » n’est point acquise, mais à conquérir dans l’espace même de l’aporie, de la perplexité, de la suspension de jugement. La hâte à juger, à réduire la pensée à une opinion, l’empressement à déclarer caduques, mensongères, hors d’usage, des pensées et des œuvres dont le propre est de nous inquiéter, de nous dérouter – et, par un paradoxe admirable, de nous contraindre à une liberté plus grande – sont, en ces temps qui adorent le temps linéaire et la fuite en avant, les pires conseil-lères. Elles abondent dans nos facilités, nos prétentions indues, nos paresses. Elles nous invitent à voir court. Elles nous prescrivent le mépris du Lointain, elles nous enclosent dans un corps abstrait, c’est-à-dire dans un corps mécanique, sans humeurs ni mystères. Le propre de ce corps abstrait est d’être transparent à lui-même et opaque au monde. Il se perçoit lui-même comme corps, un corps qui serait un « moi », en oubliant qu’il n’est d’abord, et sans doute rien d’autre, qu’un instrument de perception.

L’œil, l’oreille, la bouche, la peau, les bras qui nous donnent à saisir et à embrasser et les jambes qui nous permettent de cheminer dans le monde, sans oublier les mains, créatrices, devineresses, travailleuses et caressantes, et les sexes, en pointes ou en creux, sont d’abord des instruments de perception. Notre corps n’existe qu’en fonction de ce qu’il perçoit et de ce qu’il dit, par les regards, les gestes et les paroles. Or, ce qu’il perçoit est de l’ordre du langage qui est, lui, radicalement immatériel, car il ne se situe ni dans le corps, en tant que réalité matérielle, ni dans le monde, mais entre eux. Le corps n’existe pas davantage « en soi » que l’instrument de musique n’existe en dehors de la musique qui le suscite et à laquelle il obéit. Un instrument de musique dont on se servirait comme d’une massue cesse, par cela même, d’être un instrument de musique, un corps qui n’est qu’un corps « en soi », et dont les œuvres de l’Esprit ne seraient que les épiphénomènes, serait également méconnu.
La méconnaissance du corps se laisse constater par la singulière restriction de nos perceptions ordinaires. Le Moderne qui idolâtre le corps « en soi » réduit à l’extrême l’empire de ce qu’il perçoit. La réduction des perceptions s’accélère encore par l’oubli, caractéristique de notre temps, d’une science empirique du percevoir qui fut, naguère encore, la profonde raison d’être de l’Art sous toutes ses formes. Le corps ne dit point « je suis un corps », formule abstraite, s’il en est, le corps dit « je suis ce que je perçois ». Je est un autre. Sitôt nous sommes-nous délivrés du ressentiment qui prétend venger le corps des prétendues autorités abusives de l’Esprit, sitôt se déploient en nous les gradations qui n’ont jamais cessé d’être, mais dont nous étions exclus par un retrait arbitraire, voici qu’un assentiment magnifique nous saisit, au cœur même de nos perceptions, à cette étrangeté si familière du monde.
Cette énigme de l’écorce rugueuse sous nos doigts, ce mystère de la voûte parcourue du discours magnifique des météores, ce bruissement des feuilles, cette pesanteur douce, sans cesse vaincue et retrouvée de nos pas sur la terre ou l’asphalte ne cessent de nous faire savoir que nous sommes faits pour le monde que nous traversons et qui nous traverse. Qu’en est-il alors du « moi » ? Sinon à l’intersection de ces deux traverses, il faut bien reconnaître qu’il ne se trouve nulle part. Notre œil n’existe que par la lumière étrangère et sur-prenante qui le frappe et dont notre intelligence se fera l’éminente métaphore. Le discours entre le monde et nous-mêmes ne résiste pas davantage à l’interprétation qu’à la contemplation. Seuls peuvent le perpétuer et lui donner une apparence de vérité notre ressentiment contre l’Esprit et notre aveuglement aux signes, intersignes et synchronicités, qui, sans cesse, en vagues de plus en plus pressantes, s’offrent à nous avec munificence. Le déni de l’Esprit et de l’âme et l’affirmation pathétique du corps en tant que réalité ultime et première ne reposent que sur notre crainte, sur notre attachement craintif, effarouché, à ce que nous croyons être notre « identité » et qui n’est, et ne peut être, qu’un moment de notre traversée. L’interprétation infinie à laquelle nous invite l’Esprit nous effraie. Nous nous raccrochons désespérément, quitte à nous refermer sur nous-mêmes comme un cercueil, à ce corps qui, pour être éphémère, nous semble certain, et nous préférons cette certitude éphémère à l’éternité incertaine de l’Esprit.

Alors qu’aux temps de Nietzsche, si proches et si lointains, le ressentiment se figurait sous les espèces d’un idéalisme scolaire, taillant la part du lion à la redite, notre époque timorée et pathétique s’est constitué un matérialisme vulgaire aux ordres de ce même ressentiment qui semble être passé d’une idéologie à l’autre, à l’instar de la police politique tsariste recyclée avec les mêmes hommes et les mêmes méthodes au service de la police stalinienne.
L’homme derrière ses écrans, ne jetant plus un regard aux nues que pour planifier son week-end, l’homme calculateur, tout appliqué à « gérer » les conditions de son esclavage et ourdissant, aux avant-gardes, de sinistres projets eugénistes d’amélioration de l’espèce – venus se substituer aux anciens idéaux, stoïciens, ou théologiques, du perfectionnement de soi –, l’homme pathétique et dérisoire des « temps modernes » se trouve désormais si peu aventureux, si narcissiquement contenté, si piteusement restreint à sa fonction édictée par le « Gros Animal » social, dont parlaient Platon et Simone Weil, que l’idée même d’un mouvement, d’une âme, d’une métamorphose obéissant à une loi impalpable et incalculable lui paraît une offense atroce à ses certitudes chèrement acquises.
Le cercle vicieux est parfait. Le Moderne tient d’autant plus à sa servitude ; sa servitude est d’autant plus volontaire, et même volontariste, que la liberté sacrifiée est plus grande. L’esprit de vengeance contre les œuvres qui témoignent de « la liberté grande » n’en sera que plus radical, jusqu’au ridicule. Il suffit, pour s’en persuader, de lire les ouvrages de biographie et de critique littéraire qui parurent ces dernières décennies alors que se mettaient en place les procédures draconiennes de réduction de l’homme au « corps-machine », sinistre héritage du prétendu « Siècle des Lumières ». Entre les biographies qui s’appliquent consciencieusement à ramener des destinées hors pair à quelques dénominations connues d’ordre sociologique ou psychologique – « expliquant » ainsi l’exception par la règle, et le supérieur par l’inférieur – et les critiques formalistes se fermant délibérément à toute sollicitation et à toute relation avec les œuvres pour n’en étudier que le « fonctionnement » à la manière d’un horloger si obnubilé à démonter et à remonter ses montres qu’il en oublie qu’elles ont aussi pour fonction de donner l’heure, la littérature secondaire, critique et universitaire, apparaît rétrospectivement pour ce qu’elle est : une propagande dépréciatrice dont les ruses plus ou moins grossières ne sont plus en mesure de tromper personne, sinon quant à leur destination : la ruine du Logos.

Au corps qui ne serait « que le corps », au texte qui ne serait « que le texte », à la vie qui ne serait « que la vie », il importe désormais d’opposer, en cette « grande guerre sainte » dont parlait René Daumal, le corps comme intercession de l’Esprit – c’est-à-dire passage des perceptions, des intersignes et des heures –, le texte comme témoin du Logos, empreinte visible d’un sceau invisible et la vie comme promesse, comme preuve de l’existence de l’âme. Cette guerre n’a rien d’abstrait, elle est bien sainte, selon la définition que sut en donner René Daumal dans un poème admirable, car loin de définir un ennemi extérieur, par la race, la classe, la religion, ou d’autres catégories, plus vagues encore, cette guerre intérieure, sainte, cet appel à l’inquiétude de l’être ne connaît d’autre ennemi que le dédire. Chaque homme est à la fois le servant et le pire ennemi du Logos, du Verbe. Celui qui peut dire peut dédire, de même que celui qui chante peut déchanter. Le monde moderne, s’il fallait en définir la nature dans une formule, pourrait être défini comme l’Adversaire résolu du Verbe, ou du Logos – nous tenons en effet, à tout le moins dans leur résistance au dédire moderne, le Verbe créateur de la Bible et le Logos invaincu de la philosophie platonicienne pour équivalents, sinon similaires.
Le monde moderne ne semble être là, avec ses théories, ses politiques, ses blagues et ses méthodes de lavage des cerveaux, de mieux en mieux éprouvées, que pour mieux récuser la possibilité même du Verbe. La réalité du monde moderne ne semble tenir qu’au ressentiment de la créature contre ce qu’il suppose être son créateur et dont sa vanité lui prescrit de s’affranchir. D’où, en effet, l’irréalité croissante de ce monde, sa nature de plus en plus virtuelle et évanescente, mais aussi cauchemardesque. Ce monde où rien ne peut se dire est aussi un monde où rien ne peut être éprouvé. La réduction de notre vocabulaire, de nos tournures grammaticales est corrélative de la restriction de nos sensations et de nos sentiments. Le déni de la Surnature nous ôte le senti-ment de la nature et le refus de la métaphysique nous exile du monde physique. La guerre contre le Logos, guerre d’images, de signifiants réduits à eux-mêmes est à la fois une guerre contre toute forme d’autorité et contre toute forme de relation. L’antipathie instinctive que suscite chez les Modernes le déploiement heureux de la parole humaine est un signe parmi d’autres de leur soumission au nihilisme, également hostile à la raison et au chant. Loin de s’exclure, d’être ces adversaires perpétuels livrés à un combat qui ne connaîtrait que de rares et surprenantes accalmies, la raison et le chant, pour celui qui pense à la source du Logos, sont bien de la même eau castalienne, ou du même feu.

Sans céder à l’outrecuidance historiciste qui consisterait à lui trouver une date précise, il est permis de situer le premier signe d’une déchéance qui se poursuivra jusqu’au triomphe du nihilisme moderne à ce moment fatidique où la raison, se disjoignant du chant, l’un et l’autre furent livrés aux incertitudes respectives de leurs spécialisations. Cette scission fatale, ourdie par « Celui Qui Divise », incontestablement la première étape du déclin de notre culture – les forces de la raison s’opposant désormais aux puissances de la poésie, s’épuisant dans leurs contradictions aveugles, au lieu d’étinceler en joutes amoureuses – fut à l’origine de ce double mensonge qu’est le dualisme théorique où la rationalité folle se retourne contre la raison et où la poésie, anarchique et confuse, devient l’ennemie du chant.
Réduite à la logique marchande et technologique, la raison, oublieuse de ses questions essentielles, de ce nécessaire retour sur elle-même qui s’interroge sur « la raison de la raison », laissa la poésie au service de la publicité et de l’expression lassante, voire quelque peu répugnante, des subjectivités abandonnées à elles-mêmes et n’ayant plus d’autres motifs qu’elles-mêmes. Le poisson, dit-on, pourrit par la tête. Mais il faut croire que nous n’en sommes plus là. La doxa populaire reproduit désormais exactement les sophismes diserts de ceux qui furent, naguère, des nihilistes de pointe. Le « tout est relatif » du café du commerce par lequel on entend sans doute nous faire entrer dans la tête, et si possible une fois pour toute, qu’il n’existe aucune clef de voûte au jeu des relations et que toute « vérité » vaut n’importe quelle autre – « chacun a la sienne », ce qui ne fâche personne... – entre en parfaite résonance avec les sophismes des intellectuels qui se croient énigmatiquement mandatés pour « déconstruire » et « démystifier », le premier terme leur convenant à ceci près qu’ils déconstruisent surtout pour rebâtir – avec les pierres dérobées aux édifices vénérables – des cachots modernes, le second relevant de la pure vantardise, ou de l’antiphrase, car ils furent, lâchant leurs proses jargonnesques comme les sèches leur encre, ces éminent mystificateurs dont le monde moderne avait besoin pour dissimuler la froide monstruosité de ses machinations.
Rationalistes contre la raison, de même que les publicitaires sont « créatifs » contre la création, qu’ils entendent nous vendre universellement après étiquetage, les Modernes, qui se donnent encore la peine, non sans ringardise, de justifier leurs dévotions ineptes par des arguments, n’ont plus désormais pour tâche, dans leur guerre contre le Logos, que de nous rendre impossible l’accès aux œuvres, soit par le dénigrement terroriste, soit par l’accumulation glossatrice. Les plus « humanistes », ceux qui osent encore se revendiquer de cette appellation délicieusement désuète, ne considèrent plus les œuvres qu’en tant que témoins de « valeurs », cédant ainsi, quoi qu’ils en veuillent, à une forme particulièrement mesquine de la morale : la « moraline » dont parlait Nietzsche et qu’illustra – si l’on ose dire, car il y eut là bien peu de lumière – le sinistre épisode pétainiste qui ne vanta les « valeurs » du travail, de la famille et de la patrie qu’au détriment du Principe qui seul peut, en certaines circonstances rares et heureuses, délivrer ces « valeurs » de leur nature domestique et de leurs caractéristiques souvent ignominieuses.

Ainsi nous trouvons-nous en un pays et une époque où les œuvres, ces songes de grandeur et d’espérance, lorsqu’elles ne sont point mises en pièces par les cuistres « déconstructeurs » sont jaugées à l’aune d’une morale inerte, dépourvue de toute ressouvenance divine. Une morale sans transcendance, une morale qui n’oppose plus à l’infantilisme et à la bestialité de la nature humaine le refus surnaturel ne saurait être qu’un ersatz, une caricature. Tels sont nos modernes moralisateurs, à quelque bord qu’ils appartiennent : les uns, idolâtres du Démos et du Progrès, trouvent l’incarnation du Mal en tout esprit libre qui s’autorise à douter du bien-fondé systématique de l’opinion majoritaire et considère avec scepticisme l’ordalie électorale, tandis que les autres fourvoient et profanent leur intransigeance en d’infimes combats pour « l’ordre moral » au-dessous de la ceinture. Aux uns comme aux autres, le Logos est inutile et même hostile. Ces moralisateurs sans morale, plus soucieux de leur conformité à la bien-pensance, à l’approbation de la secte dont ils sont les débiteurs, que de la vérité qu’ils défendent avec une sorte de mollesse hargneuse sont aux antipodes de Nietzsche et de Bernanos qui nous enseignent à penser contre nous-mêmes et les nôtres.
Tout engagement digne des belles exigences du fanatisme éclairé se devra poser, en préalable à ses mouvements, ce propos de Bernanos : « Je crois toujours qu’on ne saurait réellement servir, au sens traditionnel de ce mot magnifique, qu’en gardant vis-à-vis de ce que l’on sert une indépendance de jugement absolue. C’est la règle des fidélités sans conformisme, c’est-à-dire des fidélités vivantes. » Le Verbe est le principe de cette fidélité nécessaire, car au-delà des formes qu’il engendre, il porte ceux qui le servent au cœur du silence embrasé dont toute parole vraie témoignera. Que les querelles intellectuelles ne soient plus aujourd’hui que des querelles de vocabulaire et les « intellectuels » – par antiphrase – des babouins se jetant au visage l’écorce vide des mots idolâtrés nous laisserait au désespoir si nous ne savions de source sûre, de la source même de Mnémosyne, qu’il n’en fut pas toujours ainsi.
Et s’il n’en fut pas toujours ainsi, il y a de fortes chances qu’il n’en sera pas toujours ainsi : patientia pauperum non péribit in aeternum. Et s’il n’en fut pas toujours ainsi, peut-être est-ce précisément parce qu’il n’en sera pas tou-jours ainsi.
« Le temps n’existant pas pour Dieu, écrit Léon Bloy, l’inexplicable victoire de la Marne a pu être décidée par la prière très-humble d’une petite fille qui ne naîtra pas avant deux siècles. » Les ennemis du Verbe ne s’évertuent si bien à nous ramener au temps linéaire que pour donner à leur refus d’interprétation l’apparence d’une vérité absolue et préalable. Une raison médiocrement exercée peut s’y laisser prendre, mais non le chant dont l’ingénuité porte en elle la vox cordis et la très humble prière.
Luc-Olivier d'Algange
13:41 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : plotin, néoplatonisme, luc-olivier d'algange, philosophie, grèce antique, antiquité grecque, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 17 janvier 2022
Marx et les Grecs de l'antiquité

Marx et les Grecs de l'antiquité
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2021/11/21/marx-och-de-gamla-grekerna/
Une lecture de Karl Marx pour le XXIe siècle comporte plusieurs pièges potentiels, mais aussi beaucoup de valeur significative, notamment parce qu'elle nous rappelle que les choses ne sont pas nécessairement ce qu'elles prétendent être ou ce qu'elles étaient hier. La première idée découle de l'accent mis par la tradition idéologique marxiste sur "l'idée et l'intérêt" ; si les dirigeants de l'un ou l'autre "parti ouvrier" ont des intérêts communs avec diverses classes supérieures, leur rhétorique pro-ouvrière peut n'être que rhétorique et poudre aux yeux. Soit dit en passant, quiconque est familier avec l'analyse idéologique marxienne et n'a pourtant jamais caressé l'idée que le "privilège blanc", dont les classes supérieures parlent beaucoup, confirme que ce privilège n'existe pas dans le monde de l'esprit, est un mouton. Cette dernière idée part de l'observation que "tout ce qui est fixe est périssable", les classes supérieures sont tout à fait capables de récupérer et de transformer tout, des coalitions aux idéologies hégémoniques. À la lumière de ce qui précède, la pensée statique et bipolaire qui se traduit par des revendications de "privilège blanc" et de "racisme systémique" semble carrément embarrassante, ou un élément de cette même récupération. Le système nourrit ses idiots utiles et ils ne sont pas trop stupides pour s'adapter en conséquence.
Quoi qu'il en soit, il y a dans Marx et son frère d'armes Engels beaucoup de valeur à la fois pour comprendre et attaquer l'état des choses présentes, d'une part, et leurs apologistes idéologiques, d'autre part. Mais pour ne pas tomber dans des impasses, il faut un certain nombre de clés, qui consistent souvent à rendre explicite ce qui était implicite, voire inconscient, dans les masses de textes des deux messieurs barbus. Ce n'est pas seulement à travers l'Europe du XIXe siècle qu'un "fantôme" est passé, il en va de même pour les propres textes de Marx et Engels. Même si ce n'est pas le fantôme du communisme, mais le fantôme de la génétique et de la consanguinité.

Il n'est pas déraisonnable d'adopter ici une perspective plus cyclique, afin de comprendre le processus qu'ils tentaient d'analyser au XIXe siècle à la lumière de changements similaires dans l'Antiquité et ailleurs. Nous avons affaire à une forme de société plus organique qui s'effondre, notamment parce que les classes supérieures rompent le contrat social avec leurs parents de sang moins fortunés. Il peut s'agir de la population de l'Antiquité ou de la communauté un peu plus artificielle qu'est la nation moderne. Mais des similitudes significatives existent, et elles nous aident non seulement à comprendre la révolution d'en haut qui se déroule en ce moment, mais aussi à mesurer l'ampleur des enjeux. Les sociétés fondées sur des hommes libres ont été remplacées à plusieurs reprises au cours de l'histoire par des sociétés dans lesquelles la plupart des gens étaient des esclaves d'une sorte ou d'une autre.
Ce processus est décrit dans l'étude d'Engels sur les Francs, dans la furieuse querelle entre Marx et la duchesse de Sutherland, anti-esclavagiste (étrangement applicable à la classe supérieure "anti-blanche", soit dit en passant), et dans l'étude d'Engels sur le christianisme primitif, entre autres. Les carnets ethnographiques du vieux Marx, dans lesquels il décrit, entre autres, l'effondrement de l'Athènes antique, sont également intéressants. Incidemment, un fil conducteur de ces études, bien que non nommé, correspond au concept pratique d'asabiya chez Ibn Khaldoun. Ce que Marx et Engels dépeignent, c'est l'effondrement de la solidarité sociale que Khaldoun nommait asabiya.
Chez Marx et Engels, l'accent est mis sur les conditions matérielles de l'asabiya. Dans son incomparable anglo-allemand, Marx écrit que "die älteste land tenure was die in common dch den trib", la plus ancienne forme de propriété foncière était le commun à travers la tribu (plus tard gensen). Dans un anglo-allemand tout aussi atrocement impénétrable, il écrit qu'avant la naissance de l'État, il existait des "institutions gentilices", des institutions fondées sur la parenté. "Là où les institutions gentilices ont prévalu - et avant l'établissement de la société politique - nous trouvons des peuples ou des nations dans les sociétés gentilices et rien au-delà. "L'État n'existait pas." Il décrit le Gensen (du latin gens, gentis) comme étant "essentiellement démocratique", fondé sur la parenté, "toutes les gentes d'une tribu - en règle générale - d'ascendance commune, portant un nom tribal commun. L'organisation phratrique avait un fondement naturel dans la parenté immédiate de certaines gentes en tant que subdivisions d'une gens originelle".

Deux processus ont miné l'ordre des gentes. L'un était la propriété et l'autre l'État. Avec la propriété individuelle plutôt que gentilice, des différences sont apparues au sein des gentes qui étaient difficiles à concilier à long terme avec la logique et la solidarité gentilices. Marx a écrit à ce sujet que lorsque "des différences de statut entre les parents de sang au sein de la gens apparaissent", cela est "en conflit avec le principe de gentilicité".
Les nationalistes contemporains peuvent parler de communauté des nations et de "sang supérieur à l'or", il s'agit d'une contradiction similaire. Il est intéressant de noter qu'ici, la logique gentilice implique que "les hommes riches comme les hommes pauvres sont compris dans la même gens", sans pour autant exclure les différences de statut entre les membres de la gens. Nous pouvons parler ici d'un contrat social entre membres de la gens qu'il est intéressant de maintenir, notamment pour les plus pauvres d'entre eux qui ont réussi. Dans le même temps, nous pouvons discerner des tendances à une communauté d'intérêts entre les membres riches de différentes familles. Les membres ordinaires de la gens risquaient d'être réduits à la non-liberté dès que la logique gentilice s'affaiblissait, "als Solon zur archonship came, social state malignant, in Folge des struggle for the possession of property". Une partie des Athéniens est tombée en esclavage, à cause de l'endettement, la personne du débiteur étant susceptible d'être réduite en esclavage à défaut de paiement ; d'autres avaient hypothéqué leurs terres et n'étaient pas en mesure de lever les charges." L'esclavage de la dette s'est répandu.
L'aspect démographique est également intéressant. Marx était conscient que la croissance démographique et les migrations renforçaient les processus qui minaient le système gentilice. Il mentionne ici, entre autres, le groupe croissant d'immigrants pauvres qui ne sont pas invités dans le système des gentes, "la classe la plus pauvre ne serait pas admise en tant que gens "in einen tribe od. adoptée in eine gens eines tribes". Ce groupe est de plus en plus nombreux et mécontent, "le nombre de personnes sans attaches - à l'exclusion des esclaves - est devenu important ; cette classe de personnes est un élément croissant de mécontentement dangereux". D'où, entre autres, les réformes qui ont introduit une logique territoriale et un certain nombre de classes. Ces classes, soit dit en passant, sont également intéressantes en tant que contexte pour l'analyse contemporaine des classes, car elles élargissent le concept marxien commun de classe.
La croissance démographique, les migrations et les divisions de classe ont contribué à l'émergence d'un nouvel ordre politique, dans lequel les gentes ont été remplacés par l'État ("gentilis transformés en civis"). Le lien de l'individu avec la gens a été remplacé par la ville, la cité, une logique personnelle a été remplacée par une logique territoriale. Marx écrit à ce sujet que "la propriété était l'élément nouveau qui avait progressivement remodelé les institutions grecques pour préparer ce changement". Les réformes politiques qui l'ont précédé peuvent être considérées à la fois comme la disparition du système gentilice et comme une tentative de transmettre des éléments de celle-ci dans un monde nouveau (la familière Aufhebung).
Toute tentative de ce type a toutefois eu pour effet d'affaiblir quelque peu la solidarité organique et authentique, ce qui soulève la question omniprésente de savoir si les étrangers veulent subvenir aux besoins les uns des autres. "État providence ou migration", tel que le dilemme est parfois formulé à notre époque. Le fait que les classes supérieures invitent des étrangers à partager ce qui était autrefois le patrimoine commun des gentes, du clan ou de la nation n'est en rien un phénomène nouveau. Marx a décrit cette situation de manière très éloquente dans les paragraphes sur les "fuidhirds" d'Irlande. Prôner l'"ouverture des frontières" sous cet angle revient à négliger et à encourager l'une des méthodes historiquement récurrentes des classes supérieures pour affaiblir les intérêts du peuple. Cela ne signifie pas nécessairement que la gauche d'aujourd'hui n'essaie pas d'inviter les "fuidhiris" de la fin de la modernité dans le peuple et de les retourner contre les classes supérieures, mais faciliter le processus de fuidhirisation est une folie. La folie dans la mesure où elle s'est transformée en son contraire, ceux qui prétendent représenter le peuple tout en défendant l'ouverture des frontières tendent ainsi à révéler où se trouvent leurs véritables intérêts.
Les notes insaisissables de Marx sur le déclin de l'ancienne gens sont, prises ensemble, d'une valeur considérable pour comprendre notre présent. Ils décrivent une transformation sociale similaire à celle que nous vivons aujourd'hui, où les élites rompent avec leurs communautés historiques et forment les leurs. Ils soulèvent également des questions sur les conditions matérielles et ethniques de la solidarité auxquelles il est important de répondre.
14:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, karl marx, antiquité grecque, antiquité romaine, cité grecque, marxisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 janvier 2022
Guillaume Durocher : "Les Grecs de l'antiquité avaient un sens très fort de l'importance de leur ascendance et de leur identité ethno-civilisationnelle"
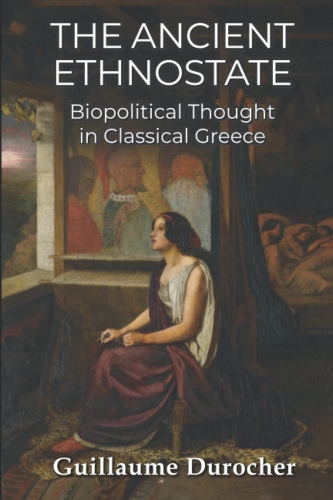
Guillaume Durocher : "Les Grecs de l'antiquité avaient un sens très fort de l'importance de leur ascendance et de leur identité ethno-civilisationnelle"
Propos recueillis par Andrej Sekulovic
Ex: https://tradicijaprotitiraniji.org/2021/12/16/guillaume-durocher-ancient-greeks-had-a-very-strong-sense-of-the-importance-of-their-ancestry-and-ethno-civilizational-identity/
Guillaume Durocher est un auteur, essayiste et traducteur qui s'intéresse, entre autres, à l'histoire et à la politique. Il écrit pour plusieurs sites de médias alternatifs tels que Occidental Observer, The Unz Review, Counter Currents et d'autres. Il a également publié récemment son premier livre, The Ancient Ethnostate : Biopolitical Thought in Classical Greece. Nous avons discuté avec lui de son nouveau livre et des questions sociopolitiques actuelles en Europe et aux États-Unis.
En tant qu'auteur et traducteur, vous avez écrit et traduit pour divers sites Internet de médias alternatifs. Pour commencer, parlez-nous un peu des principaux sujets de votre travail.
J'écris au carrefour de l'histoire et de la politique. Pour cette dernière, cela signifie principalement la politique de la France et de l'Union européenne. En ce qui concerne l'histoire, j'ai beaucoup voyagé, ayant écrit sur l'histoire de France, le fascisme et, plus récemment, les Grecs anciens. Je suis de ceux qui croient que l'histoire est une base nécessaire et excellente pour étoffer la pensée morale et l'action politique. Grâce à l'histoire, nous apprenons de l'expérience humaine dans son ensemble, nous commençons à comprendre notre trajectoire collective et nous apprenons des luttes et des expériences passées qui peuvent nous préparer et nous fortifier dans nos propres efforts.
Quels sont vos auteurs et écrivains préférés ?
Je dois beaucoup à de nombreux auteurs. Lorsqu'un écrivain me frappe, lorsque je sens qu'il a une réelle perspicacité qui fait défaut au discours commun, je le dévore. J'exploite ce filon jusqu'à l'épuisement. Il y en a trop pour les citer tous. Mais pour les contemporains, je dois surtout à Kevin MacDonald et à Dominique Venner, pour les anciens, à Marc Aurèle et à Aristote. J'ajoute que nous devrions tous apprendre attentivement tout ce que nous pouvons du "livre de la vie", notre propre expérience subjective.
Vous avez récemment publié votre premier livre, intitulé The Ancient Ethnostate : Biopolitical Thought in Classical Greece. Pouvez-vous nous donner un bref résumé de ce livre ?
Ce livre est le fruit d'une confrontation : entre mon propre statut d'hérétique à l'ère du libéralisme-égalitarisme et mes lectures des classiques de la Grèce antique, d'Homère à Aristote. J'ai découvert que les Grecs étaient résolument biopolitiques et ne s'en cachaient pas. Ils étaient immensément fiers et conscients de leur identité ethno-civilisationnelle grecque, considéraient l'engendrement et l'éducation des enfants comme un devoir familial et social, et promouvaient des valeurs de vertu martiale et de solidarité afin de triompher dans les conflits avec d'autres groupes.

En bref, il s'agit d'une analyse de l'hellénisme par les lumières du darwinisme. Il s'agit d'une lecture non forcée. Il ne fait aucun doute que les traditions occidentales ultérieures - romaines, chrétiennes, libérales - ont été beaucoup moins biopolitiques dans ce sens.
Plus généralement, ce livre est une introduction aux valeurs et à la pensée politique de la Grèce antique, ainsi qu'à l'état d'esprit remarquable qui leur a permis de se développer, de survivre et de prospérer dans le monde violent de la Méditerranée antique. Nous avons tous besoin de nous détacher spirituellement des hypothèses libérales modernes, qui jugent les sociétés et les cultures à l'aune du choix individuel et de l'égalité fictive, l'esprit du "tout m'est dû". Rafraîchissez-vous en conversant avec les anciens Grecs : leur esprit était celui de l'excellence, de l'épanouissement et du bien commun bien compris !
De nombreux historiens "grand public" affirment que la "race" est un concept relativement "moderne", inconnu dans la Grèce ou la Rome antiques. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, quelle était l'attitude des Grecs anciens à l'égard de leur identité raciale ou ethnique ?
Les Grecs avaient un sens très fort de l'importance de leur ascendance et de leur identité ethno-civilisationnelle. C'est tout simplement omniprésent, d'Homère à Aristote. Ces identités étaient multicouches et concentriques : un Grec était membre de sa famille patrilinéaire, de sa cité, de sa tribu (dorienne, ionienne...), et enfin un Hellène. L'identité la plus saillante différait selon le contexte, mais dans chaque cas, l'identité était essentiellement définie par le partage du sang et de la culture. En cas de conflit avec des étrangers, tels que les Perses et les Carthaginois, les Grecs étaient convaincus qu'ils devaient s'unir pour défendre leur race et leur civilisation contre les menaces communes.
Les Grecs étaient donc tout à fait conscients des différences raciales et de leur propre identité dans ce sens ?
Les Grecs avaient également des idées raciales précoces. Ils pensaient que la géographie pouvait modifier le caractère d'une race et provoquer l'apparition de traits héréditaires. Par exemple, on pensait que les Éthiopiens étaient noirs à cause de la chaleur du soleil. Les Grecs n'ont pas développé de théories raciales systématiques comme l'ont fait les Européens modernes, mais cela n'est pas surprenant, étant donné que le colonialisme signifiait que les Européens modernes étaient constamment confrontés à des êtres humains radicalement différents. En revanche, dans la Méditerranée antique, les différences raciales et ethniques avaient tendance à être graduelles et moins frappantes.
Pourtant, les Grecs étaient frappés par les différences physiques des Africains noirs qu'ils rencontraient occasionnellement. Les Greco-Romains racontaient parfois des blagues sur les Noirs, dont certaines ont été attribuées à Diogène le Cynique. Il est frappant de constater à quel point les idées raciales remontent loin dans le temps, bien avant le colonialisme européen. Les penseurs arabes et perses médiévaux, par exemple, ont longtemps eu des opinions très similaires à celles des Européens sur les Noirs.
Alors que la société américaine semble de plus en plus polarisée, certains auteurs de droite suggèrent que la dissolution de l'empire américain en différents ethnostates serait la meilleure solution. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue et, surtout, pensez-vous que cela pourrait devenir une possibilité réelle à l'avenir ?
Je n'ai aucune prétention à la perspicacité ici. Il semble clair que le gouvernement fédéral américain ne peut pas être récupéré par les forces patriotiques. En tant que telle, la partition semble être l'option la plus souhaitable et, en fait, une option de plus en plus plausible étant donné le degré hystérique de polarisation. Il est certain que pour l'Europe, l'effondrement des États-Unis éliminerait un vecteur majeur du mondialisme libéral sur le Vieux Continent et mettrait une pression énorme sur les hommes d'État européens pour qu'ils améliorent leur jeu sur le plan géopolitique.

L'Amérique rouge (c'est-à-dire l'Amérique républicaine) et le "Flyover Country", tenu en si grand mépris par les libéraux de la côte, semble affirmer de plus en plus son autonomie. Si une sécession devait se produire, il est crucial que les nouveaux dirigeants soient ethniquement conscients, politiquement vigoureux et conscients des conditions particulières, étranges et fluctuantes, de notre siècle. Les dirigeants américains pourraient consulter les mémoires de Lee Kuan Yew, le défunt premier ministre de Singapour, qui a eu de grandes idées sur la façon de construire et de préserver une nation dans une ère de transformation.
Les migrations de masse sont un gros problème pour l'Europe depuis des décennies. Outre les migrations en cours à travers la Méditerranée, nous assistons également à une nouvelle "crise migratoire" aux frontières polonaises, provoquée par le président biélorusse Loukachenko, que les Polonais accusent de "guerre hybride". Quelle est votre opinion sur cette crise actuelle aux frontières entre la Pologne et la Biélorussie ?
L'UE s'est offusquée des élections frauduleuses en Biélorussie et a, je crois, imposé des sanctions, notamment à la demande de la Pologne et de la Lituanie. Le gouvernement biélorusse a riposté en inondant la région de migrants du Moyen-Orient. Il s'agit d'un énième exemple d'instabilité causée par une politique étrangère wilsonienne qui ne peut tolérer des formes alternatives de gouvernement. Nous devrions oublier les obsessions démo-libérales - dont les conséquences sont souvent très néfastes - et œuvrer pour la stabilité et la coopération entre tous les Européens.
Au sein de l'Union européenne, il existe un conflit permanent entre Bruxelles et le V4 et certains autres pays d'Europe centrale. La Hongrie en particulier, et récemment aussi la Slovénie, sont critiquées par Bruxelles et la presse internationale. La plupart du temps, ils prétendent qu'il y a un manque de liberté des médias dans ces pays. Comment voyez-vous ces attaques ou accusations, et ce fossé qui se creuse entre l'Europe de l'Est et du Milieu d'un côté, et l'Europe de l'Ouest de l'autre ?
Il y a clairement un énorme fossé culturel entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale et orientale aujourd'hui. Cela tient essentiellement au fait que les Occidentaux se sont radicalisés, adoptant des interprétations extrêmes des droits de l'homme qui nient le sexe biologique, l'hétéronormativité et les fondements ethniques de l'État-nation. Beaucoup nient la légitimité des frontières légales en général. Les gouvernements doivent être jugés en fonction de la mesure dans laquelle ils servent les intérêts de leur peuple. Dans cette mesure, il est évident que les régimes d'Europe occidentale ont fait la preuve de leur faillite et ne sont pas en mesure de juger leurs voisins d'Europe centrale et orientale.
Vous avez également beaucoup écrit sur la politique française, alors peut-être pourriez-vous nous dire comment vous percevez la récente annonce d'Éric Zemmour de se porter candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine en France ?
C'est un moment passionnant. Le discours d'Éric Zemmour est tout simplement remarquable dans la politique de la France et de l'Occident dans son ensemble. Il est pro-français, accessoirement pro-blanc et, bien que juif lui-même, il est complètement libéré des tabous de la communauté organisée sur la Shoah, le régime de Vichy et le lobbying ethnique lui-même. Son principal axe de campagne est l'opposition explicite au Grand Remplacement. Il y a toutefois des défauts dans la rhétorique de Zemmour. Il continue à promouvoir l'assimilation - impossible et indésirable à ce stade - et fait une distinction intenable entre les musulmans et l'islam. Mais, dans l'ensemble, il s'agit d'un développement extraordinaire.
Pensez-vous que Zemmour puisse gagner ?
Zemmour a une chance de gagner. Nous ne pouvons évidemment pas dire comment il gouvernerait - il n'a aucune expérience dans ce domaine et beaucoup dépendra de la dynamique imprévisible du pouvoir. Nous pouvons être sûrs que la majeure partie des médias et de l'industrie "culturelle" seront constamment en guerre contre lui. Pourtant, nous pouvons légitimement espérer qu'un président Zemmour préférerait prospérer comme Orbán ou Salvini (jusqu'au coup d'État parlementaire contre lui), plutôt que de patauger comme Trump. Bien sûr, il y a les risques d'échec et de déception, mais qui ne tente rien n'a rien ! C'est la vie !
Quand on parle du grand remplacement, généralement le nom de Richard Coudenhove von Kalergi revient....
L'eau est trouble ici pour deux raisons : Premièrement, Kalergi (photo) est un personnage complexe. Et deuxièmement, il était le croque-mitaine du mouvement national-socialiste. Il a dirigé la principale organisation de la "société civile" appelant à l'unité européenne dans l'entre-deux-guerres et a été reconnu comme un ancêtre spirituel de l'UE en étant le premier lauréat du prix Charlemagne décerné par la ville d'Aix-la-Chapelle en 1950.

De nombreux groupes et sites web identitaires, dont le nôtre, mentionnent le plan Kalergi et sa "vision" d'un nouvel homme métissé dirigé par la nouvelle "aristocratie juive" européenne. Mais vous avez écrit un article très intéressant sur le sujet, dans lequel vous affirmez que, même si Kalergi était "pacifiste" et "cosmopolite", ses idées comportaient des aspects positifs, et que la vérité est un peu plus complexe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Kalergi prédisait l'émergence d'une humanité métisse cosmopolite et était extrêmement philosémite (il voyait dans les Juifs un peuple supérieur apte à diriger spirituellement l'Europe). En même temps, dans les années 1920, il a écrit contre l'importation de Noirs africains en Europe. Kalergi avait également une sensibilité aristocratique et pas particulièrement démocratique. Il a donc flirté avec l'Italie de Mussolini pendant un certain temps. Il a donné une interview remarquable, à Julius Evola entre tous, en 1933, dans laquelle il appelait à étendre le fascisme à l'Europe "car il exprime un sage mélange du principe aristocratique autoritaire avec ce qui peut être sain dans le principe démocratique." Nous voyons donc que l'histoire est compliquée !
Mon impression est que Kalergi était opportuniste, ou peut-être ouvert d'esprit. Je ne pense pas qu'il avait un plan très précis pour l'Europe, bien qu'il ait souvent mentionné la Suisse comme modèle. Ces mouvements de la société civile cosmopolites et "paneuropéens" ont tendance à être insipides. Quoi qu'il en soit, bien que Kalergi ait remporté le prix Charlemagne, l'UE a essentiellement suivi sa propre trajectoire - indépendamment de ce que Kalergi préconisait - sous l'impulsion de l'économie et des idéaux libéraux, avec des avancées occasionnelles dues à la politique franco-allemande et à l'éternel plus petit dénominateur commun.
Merci pour cet entretien. Pour finir, dites-nous, en tant que personne qui suit et écrit régulièrement sur les affaires européennes, dans quelle mesure vous connaissez notre pays, la Slovénie, et avez-vous un dernier message pour les lecteurs slovènes et nos militants ?
Je ne suis jamais allé en Slovénie mais je connais quelques Slovènes et je suis frappé de voir à quel point ils ressemblent à leurs voisins autrichiens plutôt qu'aux peuples des Balkans. J'ai goûté de nombreux bons vins slovènes. J'exhorte les patriotes slovènes à ne pas se laisser intimider par la richesse, le prestige et l'empiètement culturel des libéraux occidentaux : restez fidèles à vos instincts et à votre pays ! Aucune folie n'est éternelle.
13:04 Publié dans Entretiens, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : entretiens, guillaume durocher, livre, grèce antique, antiquité grecque, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 août 2021
Comment Alexandre le Grand a triomphé en Afghanistan

Davide Montingelli
Comment Alexandre le Grand a triomphé en Afghanistan
Ex: http://novaresistencia.org/2021/08/14/como-alexandre-o-grande-triunfou-no-afeganistao/
Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan avec l'avancée des Talibans rappelle le retrait soviétique il y a plusieurs décennies, ainsi que d'autres tentatives ratées d'occupation permanente de l'espace afghan. Pourtant, il y a quelques millénaires, Alexandre le Grand a conquis, pacifié et occupé les terres afghanes, fondant des villes, installant des colons grecs et laissant un héritage qui a duré des siècles. Comment y est-il parvenu ?
Le retrait américain d'Afghanistan est le sujet du moment. Après 20 longues années, ce que nous avons glané, à part les morts et les blessés, c'est une poignée de sable et l'ombre de la défaite. Chaque grand empire a échoué dans ce pays. Cependant, quelqu'un a réussi en Afghanistan, et les noms de villes aujourd'hui tristement connues, comme Herat et Kandahar, nous le disent. Ces deux centres urbains de l'antiquité ont été fondés sous le nom d'Alexandrie. Oui, Alexandre de Macédoine a réussi là où beaucoup d'autres après lui ont échoué. Mais comment a-t-il fait ? Un récit complet serait trop long, mais nous pouvons nous concentrer sur quelques éléments clés.
Les choix occidentaux en matière de contre-insurrection ont souvent ignoré la dimension militaire, oubliant que les talibans étaient une menace à détruire. Dans plusieurs cas, les États-Unis et leurs alliés se sont engagés dans une véritable course à la popularité, confondant popularité et autorité. Deux choses très différentes, surtout dans une société comme celle de l'Afghanistan.

Alexandre a cependant adopté une ligne de conduite très différente, car il a dû faire face à des tribus finalement peu différentes de celles qui peuplent l'Afghanistan aujourd'hui.
Avant tout, le dirigeant macédonien a offert à la population une alternative tangible de stabilité, de sécurité et de développement économique. Alexandre était bien préparé à atteindre ses objectifs sans utiliser d'armes, mais il était fermement convaincu de la grande importance des moyens guerriers dans la contre-guérilla. Enfin, il s'est adapté au type de guerre irrégulière et asymétrique qui s'est présenté à lui dans la région.
Bien sûr, les actions d'Alexandre doivent être replacées dans leur contexte temporel : nos démocraties ne pourraient jamais entreprendre un certain type d'action aujourd'hui. Cependant, de nombreuses leçons auraient pu être tirées.
Le plus important est peut-être que la contre-guérilla n'est pas quelque chose qui se situe en dehors des limites de la stratégie de guerre. La contre-guérilla est une guerre, avec un ennemi à anéantir.
Alexandre ne l'a jamais oublié, les Occidentaux l'ont manifestement fait.
18:29 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, afghanistan, alexandre le grande, hellénisme, antiquité grecque, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 29 avril 2021
Thymós, Noos et Menos

Thymós, Noos et Menos
Alex Capua
Ex : https://animasmundi.wordpress.com/2019/03/02/thymos-noos-...
Dans la tradition épique, les principales parties de l'âme du moi étaient le thymós, le noos et le menos. Le référent le plus courant de l'âme dans le texte homérique est le thymós. Le thymós n'est actif que dans le corps éveillé. L'une des qualités du thymós est qu'il peut pousser les gens à réaliser une activité particulière. Par exemple, lorsqu'Achille fait des ravages parmi les Troyens et va à la rencontre d'Énée, "son vaillant thymós animait son esprit" (XX 174). Le thymós est surtout connu pour être la source des émotions et des sentiments. Par exemple, Hector reproche à Pâris de ne pas se joindre au combat en exprimant: "Fou, tu as tort d'emmagasiner une amère rancœur dans ton thymós" (VI- 326).
Selon des sources érudites, on pensait que le thymós résidait principalement dans la poitrine, le phren étant son emplacement principal. Héra demande à Poséidon: "Le thymós de ton phren n'éprouve-t-il pas de la pitié pour les Troyens mourants? (VIII. 202).

Au moment d'un évanouissement, le thymos est annulé, perd son énergie, mais au réveil, le thymos retrouve son activité incessante. Par exemple, lorsqu'Andromaque s'évanouit à la vue du corps d'Hector traîné dans toute la ville, son rétablissement est décrit comme suit: "Une fois qu'il eut repris son souffle et que son thymós se fut recentré sur son phrén..." (XXII.475).
D'autre part, le terme vacille et le thymós semble quitter le corps ou rester dispersé dans le corps. Il existe plusieurs exemples qui peuvent être interprétés dans les deux sens: Ménélas se rend compte qu'il n'est pas sérieusement blessé, "le thymós s'est à nouveau concentré dans sa poitrine" (IV. 152). Il fait ici allusion à une action de dispersion de cette énergie qui est ensuite retournée à son lieu d'origine.
Lorsque Sarpédon disparaît, il semble indiquer un abandon du corps puisqu'il dit que le vent "a rendu la vie à laquelle il avait arraché son thymós " (V. 697 s.). Ici, le thymós est représenté comme une sorte de souffle (sans être identifié à la psyché), bien qu'un tel concept ait pu être influencé par le concept de la psyché.
Le noos est l'intuition ou l'appréhension immédiate et a un double objet: a) l'Un, et b) lui-même. Dans le noos, il y a des Idées, non seulement de classes, mais aussi d'individus, bien que la multitude entière des Idées soit contenue dans le noos de façon indivisible. Mais une marque distinctive et exclusive du noos est que l'Un est au-dessus de toute multiplicité. Un autre rang à souligner est que le noos est éternel et intemporel, car son état de béatitude n'est pas quelque chose d'acquis, mais une possession perpétuelle. Ainsi, le noos jouit de cette éternité dont le temps n'est qu'une imitation. Le noos connaît toutes les choses ensemble, simultanément, puisqu'il n'a ni passé ni futur, mais voit tout dans un éternel présent. Le noos est l'âme du monde: incorporelle et indivisible. Elle constitue le lien entre le monde suprasensible et le monde des sens, et est donc orientée non seulement vers le haut, vers le noos, mais aussi vers le bas, vers le monde de la nature. Le noos échappe à toute pensée, nous ne pouvons même pas l'imaginer, car le contraire, le multiple, émergerait. En bref, le noos est la première et la plus intense forme d'unité après l'Un, et reflète l'unité pure et absolue.
Chez Homère, le noos est la partie la plus intellectuelle. Le noos est exclusif de l'être intelligent, de celui qui se conduit en fonction d'un objectif préalablement fixé. Le noos est une vision intellectuelle distincte de la vision sensorielle, bien que dans la littérature archaïque, sa signification soit parfois plus proche de cette dernière. Dans ce terme, la faculté de penser, la capacité de réflexion et la méditation sont liées à la compréhension, à la perception et même à la mémoire. Ces attributs sont mis en relation avec une pensée objective, avec une forme d'intelligence divine. Ainsi, dans le grec tardif, notamment dans les écrits philosophiques, le noos est utilisé pour désigner l'intelligence suprême, le principe ordonnateur de l'univers. Il faut distinguer que l'"âme" est un principe "vivifiant" tandis que le noos est un principe "pensant".

Par exemple, quoi que fasse Patrocle, "le noos de Zeus est toujours plus puissant que celui des hommes" (XVI. 668).
Le noos est toujours situé dans la poitrine, mais il n'est jamais considéré comme quelque chose de matériel, ni envisagé à l'origine comme un organe du corps. D'autre part, Platon et Aristote, entre autres philosophes, développent le concept de noos de manière remarquable, en soulignant avant tout son statut divin. Pour l'école philosophique, le noos serait la composante impérissable et transcendante.
Pour Anaxagore, il est un principe organisateur et animateur de l'univers. Platon distinguait un "Noos" cosmique de la raison commune. Pour lui, il s'agit de la plus haute intuition intellectuelle sans besoin d'argument. Aristote la considérait comme une faculté impliquée dans l'acquisition de la connaissance en général. Il distingue le "Noos poietikos" (raison active) du "Noos pathetikos" (raison passive). Les Oracles chaldéens le considèrent comme le "Fils ou Intellect paternel" qui conserve les intelligibles du Dieu Père et introduit la sensation dans les mondes. Plotin considère le "Noos" (esprit divin, Logos, raison) comme un principe quasi absolu et comme la première émanation de l'Un. L'hypostase dérivée du Noos est l'âme du monde.
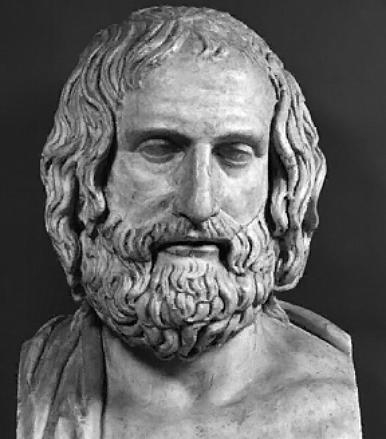
Le menos est utilisé, principalement, pour désigner l'ardeur d'un guerrier. Il était situé soit dans la poitrine, soit dans le thymos. Il était aussi situé dans le phren. Lorsqu'un homme ressent le menos dans sa poitrine, il est conscient d'une mystérieuse augmentation d'énergie; la vie en lui est forte, et il est rempli d'une nouvelle confiance et ardeur. Dans le feu de la bataille, Hélène décrit à Énée et Hector la situation désespérée créée par Diomède, car "il montre toute sa fureur et aucun homme ne peut rivaliser avec son menos" (VI. 101).
Pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie au lien suivant: Epifanía de Atenea
Ouvrage de référence recommandé :
00:46 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce antique, hellénisme, thymos, menos, noos, traditions, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 avril 2021
Le suicide dans le monde grec

Le suicide dans le monde grec
Par Álex Capua
Ex: https://animasmundi.wordpress.com/2021/03/30/el-suicidio-...
Ajax et Achille
Dans la Grèce antique, existait une croyance selon laquelle l'âme, après le rituel funéraire, ne commençait pas sa vie ultra-terrestre immédiatement après la mort et qu'elle errait près du cercueil, bien qu'elle ne prenne généralement pas les traits caractéristiques du défunt, mais plutôt la forme d'un homoncule. Cependant, dans le traitement post mortem, les personnes dont le décès est dû à un suicide, ne sont ni enterrées ni incinérées. Une explication claire : les suicidés appartenaient à la classe des morts qui n'avaient pas de statut. Dans des villes comme Thèbes, ou à Chypre, par exemple, les cadavres suicidaires étaient jetés de l'autre côté de la frontière. À Athènes, selon Platon, les suicidés n'avaient le droit d'être enterrés qu'aux frontières de douze districts, ce qui signifiait un morceau de terre à l'écart du monde social et ordonné.
Par conséquent, les funérailles font partie d'un complexe de rites funéraires qui, à son tour, appartient au complexe des rites liés à la mort. Il faut noter que, dans la mort, il y a un rite de séparation, puis une période liminale, et enfin un rite d'incorporation. Les rites funéraires appartiennent donc au groupe des rites d'incorporation, dont le but est la transition des morts vers le monde ultra-terrestre et, d'une manière particulière, l'adaptation des vivants à la nouvelle situation créée après le départ d'un des membres de la famille.
Dans la Grèce antique également, il existait des traditions concernant le suicide volontaire des personnes âgées, une pratique qui indique qu’existait la coutume d'éliminer les personnes âgées.

D'autre part, les philosophes pensaient que l'homme n'avait pas le droit de mourir de son plein gré. Celui qui a expulsé violemment l'âme de son corps n’a pas permis à son âme d'être complètement libre, parce qu'elle n'avait pas encore achevé son cycle d'apprentissage dans la vie terrestre, parce que la mort devrait être pour l'âme une libération du corps, et non une chaîne, mais, si elle était forcée de partir, l'âme serait de plus en plus enchaînée au corps. Et, à vrai dire, les âmes ainsi arrachées erraient longtemps autour du corps, de sa tombe, ou du lieu où le suicide avait été perpétré. En bref, la seule mort louable est celle à laquelle on s'est préparé à l'avance.
Le suicide était donc considéré comme une mort maudite, puisqu'il ne permet pas à l'âme de trouver son havre de paix, étant considéré comme une mort impure. Cependant, selon Épicure, dont la pensée est associée aux atomistes, le sage peut adoucir la douleur physique par le souvenir des joies passées, et, dans le cas où cette douleur serait insupportable, il lui reste toujours la possibilité de mettre fin à son tourment par le suicide.
Dans la société grecque, les hommes meurent sur le champ de bataille, accomplissant ainsi l'idéal de la civilité. La ville leur accorde une belle tombe et une oraison funèbre élogieuse avec plusieurs jours de rituels. Dans la tragédie grecque, le suicide n'est pas un "acte héroïque" mais une "solution tragique" que la morale réprouve. Aristote affirme qu'’’une sorte de déshonneur accompagne le suicidé, qui est regardé comme coupable envers la société’’ et définit la mort provoquée de sa propre main comme un acte injuste que la loi ne permet pas et un déshonneur qui accompagne celui qui se donne la mort. De même, Platon affirmait que "se tuer soi-même était un acte injuste", sauf dans trois cas: parce qu'il est ordonné par l'État, parce qu'il est contraint par un malheur ou parce qu'il a encouru l'ignominie. Œdipe, la mère d'Œdipe, se pend après avoir appris son inceste avec son propre fils Œdipe et le déshonneur familial que représente la lignée de Laïus.
Le suicide d'Ajax était très populaire dans la Grèce antique :
Selon la légende, le père d'Ajax lui conseilla de se battre avec des armes mais aussi avec l'aide des dieux, ce à quoi il répondit que même le plus lâche pouvait gagner avec l'aide des dieux. Avec cette réponse, il gagnait l'inimitié des dieux, qui, comme il arrive dans beaucoup de légendes grecques, les deux choses qu'ils ne pardonnaient pas étaient l'hybris et le manquement au culte.

Ajax, le héros de Salamine, est privé du trophée des armes d'Achille à cause des manœuvres d'Ulysse. En désespoir de cause et sous le coup de la colère, Ajax attaque ses hommes avec l'intention de tuer Agamemnon, Ménélas et Ulysse. Athéna lui barre la route et parvient à le confondre pour que ses attaques soient dirigées vers le bétail qui constitue le butin de guerre des Grecs. Devant les murs de Troie, Ajax l'invincible prend conscience de la grande humiliation dont il a été victime et sombre dans un abattement qui le conduit au suicide. Les supplications de son peuple ne servent à rien. Une fois mort, les Atrides décident d'interdire sa sépulture, mais Ulysse, qui était son ennemi irréconciliable, intercède pour Ajax et fait en sorte qu'à sa dernière heure, celui qui était proscrit et persécuté pour son crime contre la propriété grecque, reçoive les honneurs qui correspondent au soldat qui fut héroïque pendant ce long affrontement.
Avant son suicide, selon l'intrigue de la pièce de Sophocle, Ajax invoque plusieurs dieux grecs : Zeus pour convoquer son demi-frère Teucros et empêcher que son cadavre ne soit profané ; Hermès, pour le conduire aux demeures infernales ; les Erinnyes (les déesses de la vengeance), pour tourmenter les Grecs ; le Soleil, pour apporter ses messages à Salamine ; la Mort, pour venir à sa rencontre. Et adressant un dernier adieu à Salamine, à Athènes, aux fontaines, aux fleuves et aux plaines de Troie, il se donne la mort en se couchant sur son épée.

Lorsqu'Ulysse descend aux enfers, dans le XIe chant de l'Odyssée, il se retrouve face à Ajax :
Ajax, fils de l'irréprochable Télamon, n'oublieras-tu pas, même dans la mort, ta colère contre moi au nom des armes infâmes? Les dieux ont donné aux Argiens cette cécité, car tu as péri comme rempart pour les Achéens. Nous, Achéens, pleurons ta mort comme nous avons pleuré la vie du fils de Pélias. Et personne d'autre n'est responsable que Zeus, qui détestait l'armée des Danéens belliqueux et vous a mis à mort. Viens ici, souverain, pour entendre notre parole et nos explications. Et contrôlez votre colère et votre esprit généreux. Je disais ainsi, mais il ne me répondit pas.
En bref, les mortels ne sont pas autorisés à s'ôter la vie sans un ordre divin. Pour ceux-ci, il est prescrit de les enterrer à l'écart des autres, sans gloire et dans l'anonymat.
Ouvrages de référence recommandés :
Bremmer, J. N. “El concepto del alma en la antigua Grecia”. Ediciones Siruela.
Rohde, E. “Psique: la idea del alma y la inmortalidad entre los griegos” Fondo de Cultura Económica
11:58 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hellénisme, iliade, ajax, suicide, grèce antique, homère, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 mars 2021
Homère dans la Baltique : essai sur la géographie homérique

Homère dans la Baltique : essai sur la géographie homérique
Un livre de Felice Vinci (*) paru aux Editions Fratelli Palombi à Rome
Pourquoi, Homère dans la Baltique ? Depuis l'Antiquité, tous les chercheurs ont été surpris par les nombreuses et inexplicables contradictions de la géographie de l'Iliade et de l'Odyssée concernant des lieux méditerranéens comme, par exemple, la situation et la topographie d'Ithaque, la configuration de son archipel, l'aspect plat du Péloponnèse, etc. Plutarque est celui qui nous donne la clé pour entrer dans le monde réel des deux poèmes lorsque, dans l'une de ses œuvres, De fade quae in orbe lunae apparet, il affirme une chose étonnante : Ogygia, l'île de la déesse Calypso, se trouverait dans l'Atlantique Nord" à cinq jours de navigation de cette île que nous appelons maintenant la Grande-Bretagne".

Le monde d'Homère dans la Baltique et l'Atlantique Nord
Voici le début de nos recherches: en effet, l'archipel des Färöer, où se trouve une île appelée "Mykines", correspond parfaitement aux indications de Plutarque. De plus, sur une des îles du même archipel, appelée Stòra Dimun, face à la mer, se trouve une montagne appelée Högoyggj. D'ici, en suivant toujours les indications détaillées de l'Odyssée sur la route vers l'Est qu'Ulysse a suivie après avoir quitté l'Ogygie, on peut identifier le pays des Phéaciens, "Escheria", sur la côte méridionale de la Norvège: près de Stavanger, on découvre une région très riche en témoignages archéologiques de l'âge du bronze et, de plus, dans l'ancienne langue du Nord "skerja" signifiait "récif". En suivant ce littoral, un examen comparatif attentif nous permet de découvrir le véritable archipel d'Ithaque parmi les îles du Danemark, car selon l'Odyssée, près d'Ithaque se trouvaient trois îles principales : Dulychius ("la longue" en grec, introuvable en Méditerranée), Same et Zacinthe, qui correspondent respectivement à Langeland ("le long pays" en danois), Aere et Tâsinge, les principales îles de l'archipel danois du "Sud-Fyn". Et Ithaque, la patrie d'Ulysse, quelle est-elle ? Il s'agit simplement de l'actuelle Lyo, qui lui correspond parfaitement par sa position géographique: en effet, comme l'Odyssée le souligne à plusieurs reprises, elle est située à l'extrémité occidentale de l'archipel et à côté d'Aero; de plus, Homère nous apprend qu'entre Ithaque (Lyo) et Same (Aero) se trouvait une autre petite île, Asteris, qui correspond en fait à l'actuelle Avernako. Or, si l'Ithaque méditerranéenne est très différente de l'Ithaque homérique non seulement par sa situation dans l'archipel mais aussi par sa topographie, Lyo correspond à la patrie d'Ulysse tant dans les détails morphologiques que topographiques. On y trouve par exemple le "Port de Forcis" et le "Rocher du Corbeau" (un dolmen néolithique dans la partie occidentale de l'île). À l'est de Lyo se trouve le "Péloponnèse" homérique - ou "l'île de Pylos" - où régnaient les rois Atreus et Nestor, c'est-à-dire la grande île de Sjaelland (où se trouve aujourd'hui Copenhague, la capitale du Danemark). En effet, cette île est plate et correspond à la description d'Homère. Au contraire, le Péloponnèse grec n'est ni plat ni insulaire, malgré son nom ; il est néanmoins situé au sud-ouest de la mer Égée, c'est-à-dire dans une position correspondant à celle du Sjaelland dans la Baltique : voilà encore un témoignage de la transposition des noms géographiques faite par les Achéens lorsqu'ils descendirent du nord pour atteindre le sud de l'Europe.
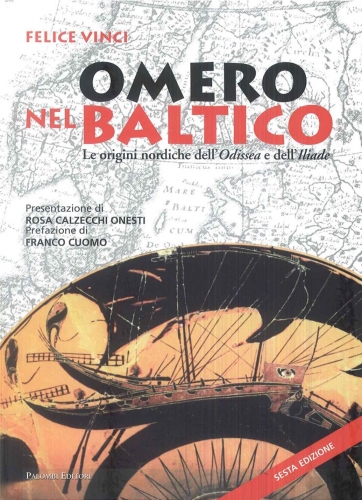
Et les voyages d'Ulysse après la guerre de Troie? Alors qu'il était sur le point d'atteindre Ithaque, il fut chassé de sa patrie par une tempête, après quoi il eut de nombreuses aventures dans des lieux fabuleux avant d'atteindre l'île d'Ogygie : aventures dont le cadre, comme nous allons le voir, est certainement celui de l'Atlantique Nord, où Plutarque nous a indiqué la situation d'Ogygie. En effet, l'île Aeolia, où règne le "roi des vents", fils d'Hippocrate, c'est-à-dire "le fils du chevalier", est l'une des îles Shetland (peut-être Yell) où soufflent les vents terribles et où vivent aussi de petits chevaux. Les Cyclopes - qui ressemblent aux Trolls, les géants mythiques du folklore norvégien dont la mère s'appelle "Toosa" - se sont installés sur la côte norvégienne (où il y a un "Tosen-fjorden"). La région des Lestrigones se trouvait également sur la même côte, plus au nord: l'Odyssée nous apprend que les journées y sont très longues. Et où se trouve l'île "Lamoy" (c'est-à-dire le "Lamos" homérique), l'île de la magicienne Circé, où le soleil est visible à minuit et où ont lieu les levers de soleil qui tournent (Homère les appelle "les danses de l'Aurore"), danses qui se retrouvent sous la forme des "danses d'Ushas" de la mythologie védique dont parle Tilak dans son ouvrage Origine polaire de la tradition védique ? Cette île peut être identifiée à Jan Mayen, au nord du cercle polaire. Il convient de noter que jusqu'au début de l'âge du bronze, le climat du Nord était beaucoup plus chaud. Il faut également noter que les "Wandering Rocks" (les rochers mouvants) sont des icebergs et que Charybde correspond sans doute au célèbre tourbillon appelé Maelström, près des îles Lofoten. Après l'épisode de Charybde, Ulysse débarque sur l'île de Trinacria, c'est-à-dire "le Trident" ; or, à côté du Maelström, il existe certainement une île à trois pointes appelée Vaeroy.

Les Sirènes, qu'Ulysse rencontre avant d'atteindre le détroit de Charybde, sont en réalité des récifs très dangereux pour les marins qui sont attirés par le murmure mélancolique du ressac, et qui, s'ils s'en approchent en croyant que la côte est proche, courent le risque de s'échouer. Ainsi, le "chant des sirènes" est une métaphore comparable à celle des kennings de la littérature nordique. Enfin, le "fleuve océan" de la mythologie grecque correspond au Gulf Stream, qui longe les côtes de la Norvège jusqu'à la mer glaciaire arctique.
En un mot, ces aventures, probablement inspirées des récits de marins de l'âge du bronze sur la mer du Nord, datent d'une époque où la navigation était très développée, surtout en Norvège où le climat était plus doux qu'aujourd'hui, et rappellent les routes océaniques des marins de l'époque telles qu'elles ont été revues par l'imagination du poète ; ces aventures deviendraient incompréhensibles si elles étaient transposées dans un tout autre contexte, à savoir la Méditerranée.
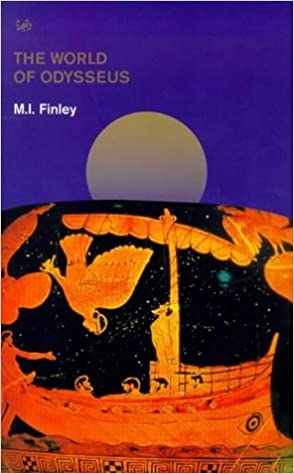 Notre enquête porte maintenant sur la situation de Troie : il existe aujourd'hui des chercheurs, comme le célèbre professeur anglais Moses Finley, qui nient que la Troie homérique puisse coïncider avec la ville découverte par Heinrich Schliemann sur la colline de Hissarlik en Anatolie. En effet, la ville chantée par Homère était située au nord-est de la mer, en face du "vaste Hellespontine" (dont on sait qu'il est très différent du détroit des Dardanelles), et l'historien médiéval danois Saxo Grammaticus a plusieurs fois fait mention d'un village des "Hellespontines", ennemis des Danois, dans la Baltique orientale. Or, dans une région du sud de la Finlande, entre les villes d'Helsinki et de Turku, on trouve de nombreux noms de lieux similaires aux noms de lieux et de villages alliés aux Troyens mentionnés dans l'Iliade: Askainen, Reso, Karjaa, Nâsti, Lyökki, Tenala, Killa, Kiikoinen, Aijala, et bien d'autres. De plus, des noms de lieux tels que Tanttala et Sipitä (le roi mythique Tantalus était enterré sur le mont Sipylus) ne rappellent pas seulement la géographie homérique mais évoquent aussi toute la mythologie grecque. Et Troie, où la trouve-t-on ? Au centre de cette région baltique, où se trouvent de nombreux témoignages archéologiques de l'âge du bronze, nous découvrons un lieu dont la morphologie est extraordinairement similaire aux descriptions homériques, c'est-à-dire un territoire vallonné dominant une plaine traversée par deux rivières, c'est-à-dire un territoire qui descend vers la mer avec une zone plus accidentée. Et puis nous découvrons que la cité du roi Priam a survécu aux pillages et aux incendies des Achéens et qu'elle a gardé son nom presque inchangé jusqu'à ce jour: c'est "Toija", comme on l'appelle maintenant. La vraie Troie est un paisible village finlandais qui a oublié son passé glorieux et tragique. Quelques kilomètres plus loin en mer, là où se trouvait l'ancien littoral, le village appelé Aijala rappelle cette plage qu'Homère appelle, en grec, "aigialos" (Iliade XIV, 34), la plage où les Achéens avaient débarqué et établi leur camp retranché.
Notre enquête porte maintenant sur la situation de Troie : il existe aujourd'hui des chercheurs, comme le célèbre professeur anglais Moses Finley, qui nient que la Troie homérique puisse coïncider avec la ville découverte par Heinrich Schliemann sur la colline de Hissarlik en Anatolie. En effet, la ville chantée par Homère était située au nord-est de la mer, en face du "vaste Hellespontine" (dont on sait qu'il est très différent du détroit des Dardanelles), et l'historien médiéval danois Saxo Grammaticus a plusieurs fois fait mention d'un village des "Hellespontines", ennemis des Danois, dans la Baltique orientale. Or, dans une région du sud de la Finlande, entre les villes d'Helsinki et de Turku, on trouve de nombreux noms de lieux similaires aux noms de lieux et de villages alliés aux Troyens mentionnés dans l'Iliade: Askainen, Reso, Karjaa, Nâsti, Lyökki, Tenala, Killa, Kiikoinen, Aijala, et bien d'autres. De plus, des noms de lieux tels que Tanttala et Sipitä (le roi mythique Tantalus était enterré sur le mont Sipylus) ne rappellent pas seulement la géographie homérique mais évoquent aussi toute la mythologie grecque. Et Troie, où la trouve-t-on ? Au centre de cette région baltique, où se trouvent de nombreux témoignages archéologiques de l'âge du bronze, nous découvrons un lieu dont la morphologie est extraordinairement similaire aux descriptions homériques, c'est-à-dire un territoire vallonné dominant une plaine traversée par deux rivières, c'est-à-dire un territoire qui descend vers la mer avec une zone plus accidentée. Et puis nous découvrons que la cité du roi Priam a survécu aux pillages et aux incendies des Achéens et qu'elle a gardé son nom presque inchangé jusqu'à ce jour: c'est "Toija", comme on l'appelle maintenant. La vraie Troie est un paisible village finlandais qui a oublié son passé glorieux et tragique. Quelques kilomètres plus loin en mer, là où se trouvait l'ancien littoral, le village appelé Aijala rappelle cette plage qu'Homère appelle, en grec, "aigialos" (Iliade XIV, 34), la plage où les Achéens avaient débarqué et établi leur camp retranché.
C'est pourquoi, dans les récits de l'Iliade, un "brouillard épais" s'abat souvent sur les guerriers qui combattent dans la plaine de Troie. Il est maintenant facile de comprendre pourquoi la mer d'Ulysse ne ressemble en rien à la mer brillante de la Grèce, mais est toujours décrite comme "grise" et "brumeuse": le monde homérique est empreint de la rigueur du climat nordique, dans lequel prédominent le froid, le vent, le brouillard, la pluie, la tempête, la glace et la neige (Iliade XII, 284), et où le soleil et la chaleur sont absents. En effet, les personnages d'Homère sont toujours enveloppés dans de lourds manteaux de laine - des manteaux semblables à ceux que l'on trouve dans les tombes danoises de l'âge du bronze - même pendant la saison la plus propice à la navigation. En bref, ce monde homérique n'a rien à voir avec les plaines torrides d'Anatolie. De plus, les murs de Troie, faits de pierres et de rondins, ressemblent davantage à ceux des anciennes cités du Nord qu'à ceux des puissantes forteresses mycéniennes.
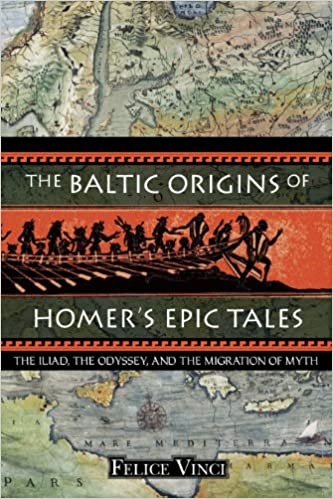 Ainsi, ce qui est étrange dans la longue bataille, dans la partie centrale de l'Iliade, avec deux midi (XI, 86 ; XVI, 777) et une "nuit terrible" (XVI, 567) mais sans aucune interruption des combats pendant la nuit - ce qui est impossible dans le bassin méditerranéen, où toutes les batailles sont interrompues par l'obscurité - est immédiatement expliqué : il s'agit d'une description de la nuit claire du solstice d'été dans les hautes latitudes qui permet aux troupes reposées de Patroclus, qui sont entrées dans le combat le soir, de combattre sans repos jusqu'au lendemain.
Ainsi, ce qui est étrange dans la longue bataille, dans la partie centrale de l'Iliade, avec deux midi (XI, 86 ; XVI, 777) et une "nuit terrible" (XVI, 567) mais sans aucune interruption des combats pendant la nuit - ce qui est impossible dans le bassin méditerranéen, où toutes les batailles sont interrompues par l'obscurité - est immédiatement expliqué : il s'agit d'une description de la nuit claire du solstice d'été dans les hautes latitudes qui permet aux troupes reposées de Patroclus, qui sont entrées dans le combat le soir, de combattre sans repos jusqu'au lendemain.
Et maintenant, après avoir découvert le monde d'Ulysse dans les îles danoises et celui de Troie dans le sud de la Finlande, le "Catalogue des navires", tiré du chant II de l'Iliade, nous permet de reconstituer tout l'univers perdu d'Homère et de la mythologie grecque en suivant les côtes de la Baltique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un exemple: la région de Stockholm correspond à la Béotie homérique; ici, la baie suédoise de Norrtälje, d'où partent aujourd'hui les ferry-boats pour Helsinki, correspond à l'ancienne Aulide béotienne, où la flotte achéenne se rassemblait avant de partir pour Troie. Autre exemple : dans l'archipel d'Åland, entre la Suède et la Finlande, l'actuelle Lemland est Lemnos, où les Achéens s'arrêtaient pendant la traversée, tandis qu'au retour de la guerre ils passaient devant Chios, qui correspond à Hiiumaa, ou Chiuma, une île estonienne. Notons également que près de Stockholm, Täby est Thèbes, la ville d'Œdipe, Tyresö rappelle le devin thébain Tirésias, et une colline appelée Nysättra est le mythique mont Nyssa, où naquit le thébain Dionysos. L'Athènes d'origine de Thésée se trouvait sur la côte sud de la Suède, près de Kalkskrona: en effet, selon le dialogue de Platon, Critias, elle était située dans une plaine sinueuse avec de nombreux fleuves, très différente de sa morphologie actuelle ; ensuite, le "Catalogue des navires" mentionne les régions du Péloponnèse, de Dulychium et de l'archipel d'Ithaque, selon une séquence impossible en Méditerranée, et confirme son identification avec Sjaeltand, Langeland et Lyo, déjà obtenue par l'Odyssée. La Crète, qu'Homère n'appelle jamais "île" mais "le vaste pays", était située le long de la côte polonaise de la Baltique: c'est pourquoi l'art minoen crétois ne fait aucune allusion à la mythologie grecque (d'ailleurs, le nom de la Pologne, "Polska", rappelle les "Pélasgiens", habitants mythiques de la Crète). De plus, en suivant le mythe de Thésée et Ariane, qui nous dit qu'entre "Crète" et "Athènes" se trouvait l'île de Naxos, nous pouvons voir qu'entre les côtes polonaises et suédoises se trouve une île, Bornholm, avec une ville appelée Nekso. Toujours selon le "Catalogue", le long de la longue côte finlandaise, la ville mythique de Jason, Yolco, correspond à l'actuelle Jolkka, près du golfe de Botnie. Toujours en Finlande, le mont Pallas (Pallastunturi) ressemble à Pallas, c'est-à-dire à Athéna, et la rivière Kyrön (Kyrönjoki) évoque le centaure Chiron, et semble indiquer que les Lapons actuels seraient les descendants des mythiques Lapithes, ennemis des Centaures. Ainsi, dans le monde balte, on trouve aussi d'autres peuples que l'on croyait perdus: les descendants des Danaens et des Curètes homériques seraient respectivement les Danois actuels et les habitants de Curlandia, une région de Lettonie.

Et que dire de l'île de Paros, "à une journée de navigation du fleuve Égypte", et de la ville appelée "Thèbes d'Égypte", qui, selon Homère, était proche de la mer ? C'est l'une des plus célèbres énigmes de la géographie homérique, car l'île égyptienne de Paros se trouve près de la côte, devant le port d'Alexandrie, et la ville de Thèbes est à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Or, le fleuve qui, dans la Baltique, se trouve dans une position correspondant à celle du Nil est la Vistule. En effet, devant son embouchure (un delta semblable à celui du fleuve africain), au milieu de la Baltique (c'est-à-dire "à une journée de navigation"), se trouve une île appelée Fårö. C'est donc ici que Ménélas rencontre Protée, le "Vieux de la mer", que l’on retrouve dans la figure du "marmendill", un devin de la mythologie nordique. De plus, à la même bouche du fleuve, la ville polonaise de Tczew rappelle le nom de la Thèbes homérique. Quant à l'Égypte que nous connaissons, son ancien nom était "Kemi", tout comme celui de Thèbes était "Wò'se" : les noms actuels ont été donnés par les Mycéniens qui, après leur descente en Méditerranée, ont voulu reconstituer ici leur monde d'origine.
En somme, la géographie homérique, qui souffre en Méditerranée d'innombrables et irrémédiables contradictions, trouve sa place naturelle dans le monde balto-scandinave: cette localisation nordique dessine un tableau géographique, morphologique, toponymique et climatique totalement cohérent avec le monde des deux poèmes et de la mythologie grecque. De plus, la civilisation chantée par Homère présente des affinités singulières avec celle des Vikings, ainsi qu'avec leur mythologie, malgré l'énorme distance temporelle qui les sépare. Toutefois, les spécialistes ont remarqué que le monde homérique semble nettement plus archaïque que celui des Mycéniens, apparus en Grèce aux alentours du XVIe siècle avant J.-C. De toute évidence, ces derniers, qui étaient de grands navigateurs et commerçants, ont immédiatement établi des contacts avec les civilisations méditerranéennes les plus raffinées après leur arrivée en zone méditerranéenne: c'est la raison de leur évolution rapide.
Pour le reste, en ce qui concerne l'origine nordique de la civilisation mycénienne, tout cela est corroboré par les preuves archéologiques recueillies en Grèce. En effet, l'archéologie l'a constaté (Prof. Martin P. Nilsson, Homère et Mycènes, Londres 1933, pages 71-86) :
- la présence d'une grande quantité d'ambre, probablement balte, dans les tombes mycéniennes les plus anciennes et son absence dans les autres;
- les caractéristiques nordiques de son architecture: le mégaron mycénien "est identique à la salle de réunion des anciens rois scandinaves";
- "la ressemblance frappante" des dalles de pierre, trouvées dans une chambre funéraire près de Dendra, "avec les menhirs connus de l'âge du bronze en Europe centrale";
- les crânes de type nordique de la nécropole de Kaîkani, etc.
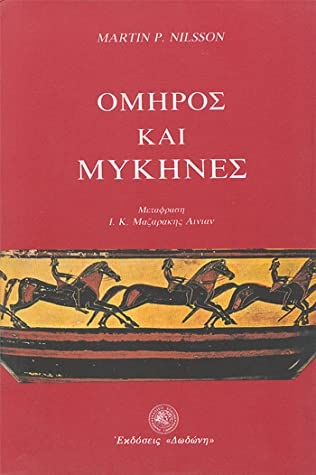 D'autre part, les chercheurs ont trouvé des similitudes remarquables entre la représentation des figures de l'art minoen (mycénien et crétois) et certaines gravures uniques trouvées sur les dalles de sarcophage appartenant à un énorme monticule de l'âge du bronze (75 mètres de diamètre) à Kivik, dans le sud de la Suède. Et que dire de la présence d'un "graffiti" représentant une dague mycénienne sur un mégalithe à Stonehenge en Angleterre? En outre, on trouve dans cette région d'autres traces ("civilisation du Wessex") qui rappellent la civilisation mycénienne, mais qui semblent avoir précédé de quelques siècles ses débuts en Grèce. À cet égard, l'Odyssée mentionne un marché de bronze dans une localité étrangère, située outre-mer, appelée "Tamise", jamais identifiée en Méditerranée: en se rappelant que le bronze est un alliage de cuivre et d'étain et que, en Europe du Nord, ce dernier était produit presque exclusivement en Cornouailles, on pourrait en déduire que cette "Tamise" homérique correspondait à l'estuaire de la Tamise (appelé "Thamesis" ou "Tamensîm" dans l'Antiquité).
D'autre part, les chercheurs ont trouvé des similitudes remarquables entre la représentation des figures de l'art minoen (mycénien et crétois) et certaines gravures uniques trouvées sur les dalles de sarcophage appartenant à un énorme monticule de l'âge du bronze (75 mètres de diamètre) à Kivik, dans le sud de la Suède. Et que dire de la présence d'un "graffiti" représentant une dague mycénienne sur un mégalithe à Stonehenge en Angleterre? En outre, on trouve dans cette région d'autres traces ("civilisation du Wessex") qui rappellent la civilisation mycénienne, mais qui semblent avoir précédé de quelques siècles ses débuts en Grèce. À cet égard, l'Odyssée mentionne un marché de bronze dans une localité étrangère, située outre-mer, appelée "Tamise", jamais identifiée en Méditerranée: en se rappelant que le bronze est un alliage de cuivre et d'étain et que, en Europe du Nord, ce dernier était produit presque exclusivement en Cornouailles, on pourrait en déduire que cette "Tamise" homérique correspondait à l'estuaire de la Tamise (appelé "Thamesis" ou "Tamensîm" dans l'Antiquité).
En bref, le véritable lieu d'origine des poèmes homériques et de la mythologie grecque était le monde balto-scandinave, où l'âge du bronze, favorisé par un climat exceptionnellement doux, s'est épanoui avec des produits splendides semblables à ceux de la Méditerranée. Rappelons que les savants fondent leurs spéculations sur un "optimum climatique", après la dernière glaciation, qui aurait duré jusqu'au début du deuxième millénaire avant J.-C., ce qui confirme également la thèse de l'origine arctique des Aryens soutenue par Tilak en Inde. Notons également que lorsque cette période s'est terminée et que le climat est devenu très rude (plus qu'aujourd'hui), c'est le moment où commencent les migrations des Indo-Européens: ainsi, alors que les Aryens se sont installés en Inde, leurs "cousins" achéens se sont dirigés vers la Méditerranée - en descendant peut-être les grands fleuves russes, comme le Dniepr - et ont donné naissance à la civilisation mycénienne; de sorte qu'ils ont attribué, aux différents lieux où ils se sont installés, des noms identiques à ceux des régions qu'ils avaient quittées dans leur patrie perdue, en se servant d'une certaine similitude entre les deux bassins, la Baltique et la Méditerranée. En outre, les vieilles histoires de leurs ancêtres ont été transmises d'une génération à l'autre, à partir desquelles ont germé les premières graines de l'Iliade et de l'Odyssée, et qui peuvent être considérées comme des "fossiles littéraires" ayant survécu à l'effondrement de l'âge du bronze en Europe du Nord.
C'est pourquoi on ne sait rien de leur(s) auteur(s). Enfin, l'effondrement de la civilisation mycénienne (causé par les Doriens vers le XIIe siècle avant J.-C.) a fait oublier définitivement le souvenir de leur émigration du Nord, pourtant attestée par l'archéologie: ainsi, leurs anciens récits, transmis par les aèdes jusqu'à l'âge classique, ont perdu leur contexte "hyperboréen" originel, bien que celui-ci n'ait jamais été complètement oublié par les Grecs anciens, et ont ensuite été transférés dans le monde méditerranéen, où ils sont restés dans une dimension mythique hors de l'espace et du temps (1).
 Felice Vinci
Felice Vinci
(*) Italien, né à Rome, spécialisé dans l'ingénierie nucléaire ; cependant, son penchant pour la Grèce antique l'a fait travailler pendant des années avec érudition sur l'approche inédite de la géographie des œuvres d'Homère.
Note :
(1) En avril 2017, une conférence internationale sur "Homère dans la Baltique" a été organisée dans un institut académique grec à Athènes. Un résumé actualisé de cet article a été publié par le Athens Journal of Mediterranean Studies. Pour accéder au contenu, rendez-vous sur le site :
https://www.athensjournals.gr/mediterranean/2017-3-2-4-Vinci.pdf
Par ailleurs, une critique de l'article, signée par Arduino Maiuri, philologue à l'Université de Rome, vient d'être publiée dans l'American Journal et peut être consultée sur le site :
Http://www.davidpublisher.com/Home/Journal/SS
ou également à :
Http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=31714.html
00:41 Publié dans archéologie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : archéologie, felice vinci, homère, iliade, odyssée, ulysse, guerre de troie, mer baltique, histoire, mythologie, mythologie grecque, hellénisme, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 janvier 2021
Pierre Le Vigan : La nouveauté de Platon
18:02 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : platon, platonisme, philosophie, hellénisme, grèce antique, antiquité grecque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 novembre 2020
Homère, l'Odyssée et les évangiles: une exégèse allégorique

Homère, l’Odyssée et les évangiles: une exégèse allégorique
par Nicolas Bonnal
On connaît l’usage chrétien fait de la quatrième églogue de Virgile. Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo…Des milliers de gloses furent écrites à ce sujet. On connait aussi les écrits de Porphyre sur le symbolisme des grottes dans l’Odyssée. L’exégèse allégorique d’Homère fut faite par Platon, par Plutarque, Héraclite, Cicéron dans l’Antiquité.
Millième lecture nocturne de l’Odyssée au cours d’une énième heureuse insomnie (veillez donc, vous qui ne savez pas l’heure…). Le hasard du livre électronique me mène à la fin, lorsque l’on découvre le traître chevrier Mélanthios. Ce misérable sera ligoté puis atrocement mutilé après la grande liquidation des prétendants dont nous allons reparler.
Or le matin même, nous lisions un extrait de l’évangile selon saint Matthieu (25,32) : « comme le berger sépare les brebis d’avec les chèvres ». Il y a dans l’Odyssée le bon bouvier et le bon porcher Eumaios, contre le mauvais chevrier. Le caprin comme mauvais troupeau ? Le bouc a du souci à se faire. Le bouvier et le porcher aideront Ulysse à exterminer les prétendants et découperont cruellement ce chevrier.
Serviteurs, servantes ? J’ai toujours été étonné par la cruauté du châtiment des servantes infidèles (sic), qui se retrouvent pendues. Mais elle n’est pas fortuite. Elles ont manqué au maître et à son Epouse qui l’attend. Elles ont couché avec les prétendants.
Pensons à l’Evangile (Matthieu, 25,2) :
« Alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l’époux. Et cinq d’entre elles étaient prudentes, et cinq folles. Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles…
La punition des vierges folles est plus dure que l’Evangile selon Bergoglio et la presse néo-catho. Cela donne :
« Or, comme elles s’en allaient pour en acheter, l’époux vint; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces; et la porte fut fermée.

Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais lui, répondant, dit: En vérité, je vous dis: je ne vous connais pas. »
Un peu d’Homère ? Chant 18, traduction Leconte de Lisle, pour comprendre la fonction sacrée des servantes (ebooksgratuits.com) :
« Puis ils enduisirent les torches. Et les servantes du subtil Ulysse les allumaient tour à tour ; mais le patient et divin Ulysse leur dit :
– Servantes du roi depuis longtemps absent, rentrez dans la demeure où est la reine vénérable. Réjouissez-la, assises dans la demeure ; tournez les fuseaux et préparez les laines. Seul j’allumerai ces torches pour les éclairer tous. »
Voici ce que disait la nourrice Eurykléia (orthographe Leconte de Lisle) à Ulysse :
« Mon enfant, je te dirai la vérité. Tu as dans tes demeures cinquante femmes que nous avons instruites aux travaux, à tendre les laines et à supporter la servitude. Douze d’entre elles se sont livrées à l’impudicité. »
Génie méditerranéen : même symbolique des corps (huile, viandes, vins) et même ici des nombres.
Dimension chrétienne, évangélique alors ? Un peu le hasard, est-ce par miracle ? Le retour d’Ulysse dans sa patrie, si célébré dans notre ancienne tradition est une parousie ; et le meurtre sanglant (pensons aux larmes, aux grincements de dents – βρυγμὸς τῶν ὀδόντων…) des prétendants est une punition, un jugement dernier. Le prétendant c’est le parasitisme moderne : le politicien, l’administrateur, le taxateur, le légiste, le critique, le théologien… Tout ce qui s’est mis entre le Maître et nous, entre la Vie et nous. Mais leur crime principal c’est l’impiété.
Homère encore et toujours :
« La moire des dieux et leurs actions impies ont dompté ceux-ci. Ils n’honoraient aucun de ceux qui venaient à eux, parmi les hommes terrestres, ni le bon, ni le mauvais. C’est pourquoi ils ont subi une mort honteuse, à cause de leurs violences. »

Homère, l’Odyssée et les évangiles : une exégèse allégorique
On connaît l’usage chrétien fait de la quatrième églogue de Virgile. Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo…Des milliers de gloses furent écrites à ce sujet. On connait aussi les écrits de Porphyre sur le symbolisme des grottes dans l’Odyssée. L’exégèse allégorique d’Homère fut faite par Platon, par Plutarque, Héraclite, Cicéron dans l’Antiquité.
Millième lecture nocturne de l’Odyssée au cours d’une énième heureuse insomnie (veillez donc, vous qui ne savez pas l’heure…). Le hasard du livre électronique me mène à la fin, lorsque l’on découvre le traître chevrier Mélanthios. Ce misérable sera ligoté puis atrocement mutilé après la grande liquidation des prétendants dont nous allons reparler.
Or le matin même, nous lisions un extrait de l’évangile selon saint Matthieu (25,32) : « comme le berger sépare les brebis d’avec les chèvres ». Il y a dans l’Odyssée le bon bouvier et le bon porcher Eumaios, contre le mauvais chevrier. Le caprin comme mauvais troupeau ? Le bouc a du souci à se faire. Le bouvier et le porcher aideront Ulysse à exterminer les prétendants et découperont cruellement ce chevrier.
Serviteurs, servantes ? J’ai toujours été étonné par la cruauté du châtiment des servantes infidèles (sic), qui se retrouvent pendues. Mais elle n’est pas fortuite. Elles ont manqué au maître et à son Epouse qui l’attend. Elles ont couché avec les prétendants.
Pensons à l’Evangile (Matthieu, 25,2) :
« Alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l’époux. Et cinq d’entre elles étaient prudentes, et cinq folles. Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles…
La punition des vierges folles est plus dure que l’Evangile selon Bergoglio et la presse néo-catho. Cela donne :
« Or, comme elles s’en allaient pour en acheter, l’époux vint; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces; et la porte fut fermée.
Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais lui, répondant, dit: En vérité, je vous dis: je ne vous connais pas. »

Un peu d’Homère ? Chant 18, traduction Leconte de Lisle, pour comprendre la fonction sacrée des servantes (ebooksgratuits.com) :
« Puis ils enduisirent les torches. Et les servantes du subtil Ulysse les allumaient tour à tour ; mais le patient et divin Ulysse leur dit :
– Servantes du roi depuis longtemps absent, rentrez dans la demeure où est la reine vénérable. Réjouissez-la, assises dans la demeure ; tournez les fuseaux et préparez les laines. Seul j’allumerai ces torches pour les éclairer tous. »
Voici ce que disait la nourrice Eurykléia (orthographe Leconte de Lisle) à Ulysse :
« Mon enfant, je te dirai la vérité. Tu as dans tes demeures cinquante femmes que nous avons instruites aux travaux, à tendre les laines et à supporter la servitude. Douze d’entre elles se sont livrées à l’impudicité. »
Génie méditerranéen : même symbolique des corps (huile, viandes, vins) et même ici des nombres.
Dimension chrétienne, évangélique alors ? Un peu le hasard, est-ce par miracle ? Le retour d’Ulysse dans sa patrie, si célébré dans notre ancienne tradition est une parousie ; et le meurtre sanglant (pensons aux larmes, aux grincements de dents – βρυγμὸς τῶν ὀδόντων…) des prétendants est une punition, un jugement dernier. Le prétendant c’est le parasitisme moderne : le politicien, l’administrateur, le taxateur, le légiste, le critique, le théologien… Tout ce qui s’est mis entre le Maître et nous, entre la Vie et nous. Mais leur crime principal c’est l’impiété.
Homère encore et toujours :
« La moire des dieux et leurs actions impies ont dompté ceux-ci. Ils n’honoraient aucun de ceux qui venaient à eux, parmi les hommes terrestres, ni le bon, ni le mauvais. C’est pourquoi ils ont subi une mort honteuse, à cause de leurs violences. »

Pénélope est bien sûr l’épouse. Elle est même l’Eglise et la reconnaissance mutuelle (elle est la dernière à reconnaître) se fait autour du lit conjugal et de cette construction. Ulysse a bâti son église. Homère la décrit précisément (voyez Guénon, symbolisme de la construction) :
« Il y avait, dans l’enclos de la cour, un olivier au large feuillage, verdoyant et plus épais qu’une colonne. Tout autour, je bâtis ma chambre nuptiale avec de lourdes pierres ; je mis un toit pardessus, et je la fermai de portes solides et compactes. Puis, je coupai les rameaux feuillus et pendants de l’olivier, et je tranchai au-dessus des racines le tronc de l’olivier, et je le polis soigneusement avec l’airain, et m’aidant du cordeau. Et, l’ayant troué avec une tarière, j’en fis la base du lit que je construisis au-dessus et que j’ornai d’or, d’argent et d’ivoire, et je tendis au fond la peau pourprée et splendide d’un bœuf. Je te donne ce signe certain… »
Chambre nuptiale ? Lisez Matthieu, 9, 15 ; Marc, 2, 19 ; Luc, 5, 34… La restauration de la chambre (génitif νυμφῶνος) nuptiale est au cœur des évangiles comme d’Homère.
Télémaque est le jeune prince impuissant, celui qu’on envoie à la place du roi, mais qui n’est pas à sa place et qui prend le risque d’être tué ou humilié par les prétendants. Encore un peu d’évangile (Matthieu, 21, 36-39) avec un prince et une captation d’héritage :
« Il envoya encore d’autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya auprès d’eux son fils, disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux: Celui-‑ci est l’héritier; venez, tuons-le, et possédons son héritage. Et l’ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. »
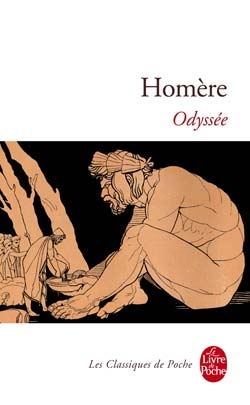 Le sort humilié de Télémaque dans l’Odyssée :
Le sort humilié de Télémaque dans l’Odyssée :
« Et Antinoos lui répondit :
– Tèlémakhos, agorète orgueilleux et plein de colère, qu’as-tu dit ? Si tous les prétendants lui donnaient autant que moi, il serait retenu loin de cette demeure pendant trois mois au moins. »
Concluons. Le chant 24, qui n’est pas du même « auteur » (mais qui est Homère ? Mais qui est Shakespeare ?) évoque une nouvelle descente aux enfers :
« Le Kyllénien Hermès évoqua les âmes des prétendants. Et il tenait dans ses mains la belle baguette d’or avec laquelle il charme, selon sa volonté, les yeux des hommes, ou il éveille ceux qui dorment. Et, avec cette baguette, il entraînait les âmes qui le suivaient, frémissantes. »
« Puis on a même droit à une intervention divine pour ramener la paix sur la terre (car il faut bien venger les prétendants et donc châtier encore ceux qui voudraient venger les prétendants !) :
Alors le Kronide lança la foudre enflammée qui tomba devant la fille aux yeux clairs d’un père redoutable. Et, alors, Athènè aux yeux clairs dit à Odysseus :
– Divin Laertiade, subtil Odysseus, arrête, cesse la discorde de la guerre intestine, de peur que le Kronide Zeus qui tonne au loin s’irrite contre toi.
Ainsi parla Athènè, et il lui obéit, plein de joie dans son cœur.
Et Pallas Athènè, fille de Zeus tempétueux, et semblable par la figure et par la voix à Mentôr, scella pour toujours l’alliance entre les deux partis. »
Deux ans après ces lignes j’ajoute cette lecture. On est chant 16 et Télémaque a reconnu son père grâce à la transfiguration opérée par Athéna :
« Athènè parla ainsi, et elle le frappa de sa baguette d'or. Et elle le couvrit des beaux vêtements qu'il portait auparavant, et elle le grandit et le rajeunit ; et ses joues devinrent plus brillantes, et sa barbe devint noire. Et Athènè, ayant fait cela, disparut. »

Télémaque reste interdit devant cette parousie :
« Alors Odysseus rentra dans l'étable, et son cher fils resta stupéfait devant lui ; et il détourna les yeux, craignant que ce fût un dieu, et il lui dit ces paroles ailées :
– Étranger, tu m'apparais tout autre que tu étais auparavant ; tu as d'autres vêtements et ton corps n'est plus le même. Si tu es un des dieux qui habitent le large Ouranos, apaise-toi. Nous t'offrirons de riches sacrifices et nous te ferons des présents d'or.
Épargne-nous.
Et le patient et divin Odysseus lui répondit :
– Je ne suis point un des dieux. Pourquoi me compares-tu aux dieux ? Je suis ton père, pour qui tu soupires et pour qui tu as subi de nombreuses douleurs et les outrages des hommes. »
Télémaque continue de ne pas croire :
Et le sage Odysseus lui répondit :
– Tèlémakhos, il n'est pas bien à toi, devant ton cher père, d'être tellement surpris et de rester stupéfait. Jamais plus un autre Odysseus ne reviendra ici. C'est moi qui suis Odysseus et qui ai souffert des maux innombrables, et qui reviens, après vingt années, dans la terre de la patrie. »
Père, fils, transfiguration… Je laisse à mon lecteur le soin alors d’établir tous les liens nécessaires…
10:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hellénisme, ulysse, odyssée, lettres, littérature, littérature grecque, lettres grecques, grèce antique, antiquité grecque, humanités gréco-latines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 septembre 2020
Mais qu’est-ce qui est proprement grec?

Mais qu’est-ce qui est proprement grec?
Par Diego Sanchez Meca
Ex: http://www.in-limine.eu
Dernier paragraphe du texte de Diego Sanchez Meca, professeur de philosophie à l’université de Madrid, « Généalogie et critique de la philologie aux sources de Choses humaines, trop humaines », paru dans le recueil Nietzsche, Philosophie de l’esprit libre sous la direction de Paolo D’Iorio et Olivier Ponton, éditions Rue d’Ulm, pp. 89-95, 2004.
On pourrait dire que les écrits philologiques de Nietzsche entre 1871 et 1875 cherchent à déterminer ce qui est proprement grec. Et cette recherche se fait sans la passion qui caractérisait La Naissance de la tragédie et les écrits antérieurs et préparatoires, rédigés en particulier sous l’influence du romantisme de Wagner. Maintenant, lorsque Nietzsche analyse par exemple la vie religieuse, le culte des dieux, il est prêt à démystifier l’idée classiciste de la religion grecque comme « religion de la beauté », pour déterminer le sens authentique de sa fonction strictement politique. Dans le cadre de cette recherche de type généalogique, la religion est considérée comme une expression parmi d’autres de la culture grecque, dans laquelle on analyse les symboles qui l’expriment, les forces sous-jacentes à ces symboles et l’origine des ces forces.
Dans cette analyse Nietzsche remarque qu’il appartient à la mentalité magique sous-jacente au culte grec de croire que, tout comme on peut maîtriser la volonté des hommes en agissant sur leur corps, on peut influer sur la volonté des dieux ou des esprits en agissant sur leurs idoles ou sur les objets matériels dans lesquels ils habitent ou s’incarnent : c’est croire qu’il est possible de négocier avec les dieux et d’user de procédés pour les maîtriser et exercer un pouvoir sur eux. Par exemple, on peut essayer d’attirer leur sympathie avec des dons ou des offrandes ; nouer une alliance avec la divinité en l’engageant par une promesse, en obtenant en échange un otage comme symbole qui reste sous le contrôle humain et qui est enfermé et protégé comme garantie de l’accomplissement de ce qui a été promis ; on peut aussi célébrer des purifications pour éliminer les forces malignes, brûler les mauvais esprits ou les éloigner avec une musique. Tous ces éléments sont des contenus du culte grec primitif1. En cela les Grecs anciens ne sont pas une exception : chez tous les peuples primitifs l’aspect magique, symbolique et mimétique constitue une étape précédent la pensée causale, logique et scientifique.

Contrairement à ce qui se passe chez les autres peuples, à partir de cette intelligence impure et impuissante, de cet état mental prélogique et magique, se développent cependant chez les Grecs les plus grandes œuvres et les plus hauts produits de l’esprit. En quoi consiste la différence entre les Grecs anciens et les autres peuples primitifs, cette différence qui les rend exemplaires, uniques, classiques ? C’est qu’ils ne restent pas immobilisés dans la paresse des mœurs, comme le font les peuples non civilisés. Si, dans une situation primitive, les Grecs croient que la nature est régie par un arbitraire dépourvu de toute loi, leur grandeur consiste en ce qu’ils apprennent à classer leurs expériences en généralisant les données de leurs observations et en découvrant finalement des régularités et des lois dans le cours des événements naturels. Comment les Grecs atteignent-ils cet état mental plus mûr et vigoureux ? Comment acquièrent-ils cette sérénité et cette noblesse que reflètent l’art, la science et la poésie de leur meilleure époque ? Étant donné que cette sérénité n’est pas primitive, mais manifestement acquise ou conquise, quel est le processus – se demande Nietzsche – par lequel les Grecs passent de l’aspect monstrueux de leurs dieux originels à l’aspect rayonnant et lumineux des dieux olympiens ? Et enfin, comment l’anthropomorphisme de ces dieux se forme-t-il ?
Nietzsche part de l’idée que les cultures s’expliquent fondamentalement par le sentiment qui les fait naître et qui illumine ou assombrit le genre de vie qui s’y développe. La pensée généalogique de Nietzsche considère, dès le départ, que ce sont des métamorphoses d’une force fondamentale d’affirmation ou de négation de la vie qui font surgir une culture et qui la transforment. C’est pourquoi, ce qu’il essaie d’analyser maintenant c’est la transformation, dans la formation du peuple grec, d’un sentiment originaire de faiblesse, de peur et de terreur face à la vie – ce en quoi les Grecs ne diffèrent des autres peuples primitifs – en un sentiment opposé, c’est-à-dire une attitude d’affirmation inspirée par la force qui ne craint plus ni la vie ni ses énigmes. C’est cela que Nietzsche cherche dans l’étude de l’évolution qui mène à l’abandon des rites obscurs et des sacrifices sanglants par lesquels les Grecs essayaient à l’origine d’apaiser les puissances infernales, pour arriver, à l’époque classique, à une solidarité exceptionnelle avec la société imaginaire de leurs dieux :
-
Dans le culte des Grecs et dans leurs dieux, on trouve tous les indices d’un état archaïque, rude et sombre. Les Grecs seraient devenus quelque chose de très différent s’ils avaient dû y persévérer. Homère les a délivrés, avec cette frivolité qui est le propre de ses dieux. La transformation d’une religion sauvage et sombre en une religion homérique est tout de même le plus grand événement2

Ce changement peut être déterminé historiquement et il peut être illustré par une lecture attentive d’Homère, Hésiode et Eschyle. De la Grèce pré-homérique à celle de Phidias il y a une transformation profonde de la sensibilité qui apparaît comme un passage des ténèbres à la lumière. Dans des fêtes comme les Diasies, quel était le dieu auquel on offrait originairement l’holocauste expiatoire de la manière la plus sombre (méta stygnotètôn) ? Comment les esprits souterrains des ancêtres laissent-ils la place à Zeus Meilichios (doux comme le miel) ? Comment, en partant des dieux-arbres ou des dieux-animaux de l’origine, les figures rayonnantes d’Apollon, Héra, Artémis surgissent-elles ? Les dieux grecs étaient, dans leur origine la plus lointaine, les animaux sacrificiels. Ils portaient en eux la force vitale que l’homme s’appropriait en mangeant leur chair et en buvant leur sang. Comment l’animal auquel on attribuait une force divine aurait-il pu ne pas devenir objet de vénération ? Un progrès important est réalisé par la transformation de cette croyance, transformation impliquée par le fait que c’est un homme qui incarne le dieu, bien qu’il porte un masque d’animal. Cet homme, le prêtre ou le roi, a donc le pouvoir – qui appartenait auparavant à l’animal sacré – d’éloigner les épidémies, de provoquer la pluie ou de stimuler la fécondité des femelles. Les Grecs homériques appellent déjà leurs dieux avec des chants bouleversants et ceux-ci combattent à leur côté sur le front de leurs armées. Le monde commence à offrir un nouvel aspect lorsque la croyance selon laquelle il serait dominé par des forces arbitraires, incompréhensibles et terrifiantes (titans, gorgones, sphinx, serpents souterrains, etc.) se dissout et qu’on commence à penser qu’il est régi par des dieux-hommes à la splendeur sereine. C’est là pour Nietzsche la démonstration que la culture grecque, qui se caractérise fondamentalement – comme toute culture – par une certaine interprétation du monde et de l’homme, se transforme suivant un changement dans l’évaluation que l’homme grec fait de lui-même en tant qu’homme. La valeur que l’homme attribue aux choses et à lui-même modifie peu à peu sa substance et son pouvoir.
Le Grec homérique ne se considère pas originairement comme différent des dieux eux-mêmes. Contrairement à ce qui se passe chez les autres peuples primitifs, le sentiment de la différence essentielle entre les dieux et les hommes n’amène pas les Grecs à sous-estimer ce qui est humain, ni à s’humilier comme des esclaves :
-
Ils voient des dieux au-dessus d’eux, mais non comme des maîtres, ils ne se voient pas non plus eux-mêmes comme des serviteurs, à la manière des Juifs. C’est la conception d’une caste plus heureuse et plus puissante, un reflet de l’exemplaire le plus réussi de leur propre caste, donc un idéal et non un contraire de leur propre essence. On se sent en affinité complète. […] On a de soi-même une noble image, quand on se donne de tels dieux3.
Les Grecs se voient capables de vivre en société avec des puissances aussi différentes et terribles que l’étaient leurs dieux primitifs. Elles leur sont familières et ils cohabitent comme deux castes de puissance inégale, mais de même origine, sujettes au même destin et qui peuvent discuter sans honte ni crainte. En ce sens les dieux olympiens apparaissent comme le fruit d’un effort inégalable de réflexion dans lequel la force et l’équilibre triomphent. Au passage de la statue d’Athéna, sculptée par Phidias, les Grecs fermaient encore les yeux, de crainte d’être victimes de terribles malheurs : Athéna, symbole de la sagesse, conserve le mystère inquiétant de ces obscures forces primitives. Cependant, les Grecs instaurent avec leurs dieux une sorte de jeu politique dans lequel ces derniers dominent la relation, tandis qu’ils disposent des moyens symboliques pour les contrôler. Ceci explique la rigueur des formules rituelles et l’équilibre extraordinaire du culte grec, y compris dans sa capacité d’assimilation et de transformation. De là aussi sa place centrale et fondatrice dans la polis et les affreux châtiments qu’entraînait le délit d’asebeia (impiété).

De ce point de vue, le culte religieux, tout comme la tragédie, est une action (Handlung), un drame4, ainsi qu’une alliance, autrement dit un ordre, un monde, un cosmos. Le Grec parie sur une affirmation de soi dans le cadre de cette rivalité agonistique avec ses dieux, il croit en la maîtrise de l’esprit sur la nature et en l’aménagement du chaos par la clarté de l’ordre et de la beauté. En ce sens, tout comme le drame musical grec, le culte fait apparaître l’énigme de la génialité : « L’œuvre d’art est […] un moyen pour la perpétuation du génie5. » C’est en cela que la religion grecque se distingue des religions asiatiques. Pour les Grecs aussi, par exemple, le prêtre est le plus haut symbole de la relation entre les dieux et les hommes. Mais il n’en devient pas pour autant le « seigneur » des autres hommes. La famille, le clan, la phratrie, le démos ou la cité ont chacun leurs dieux et chacun de ces dieux a sa résidence dans un lieu et un temple précis. Il n’y a pas de dieux sous forme d’esprits diffus qui survoleraient le monde. Les dieux sont individuels et ils exigent d’être servis par un culte particulier et par des prêtres déterminés. La fonction sacerdotale en Grèce est intimement mêlée à la vie de la polis, elle n’est pas organisée en corporations ou hiérarchisée, tout comme cela arrive avec les dieux, leurs idoles ou les lieux de culte.
D’autre part, la substitution des dieux olympiens aux forces infernales primitives et aux esprits des morts n’entraîne pas la répression des enthousiasmes religieux originaires, même les plus brutaux. La religion grecque, contrairement par exemple à la religion italique primitive jusqu’à l’avènement de l’Empire romain, est un chaos de formes et de notions de différentes origines dans lequel les Grecs surent mettre de l’ordre et de la beauté. Dans ce processus d’organisation aucun culte ne fut aboli ni repoussé : dans le panthéon grec les dieux étrangers se confondirent avec les dieux grecs6. Cet éclectisme montre jusqu’à quel point les Grecs classiques conservent les énergies ancestrales présentes dans leurs origines : c’est une manière naïve de dire que celles-ci ne sont pas perdues. C’est pourquoi l’on peut dire que la véritable magie des grecs est en ce sens celle par laquelle ils arrivent à transfigurer les passions humaines. À la vie humaine, pleine de misère et de souffrances, les Grecs opposent l’image de leurs dieux comme image d’une vie facile et resplendissante. Dans cette opposition, la véritable grandeur de l’homme consiste à souffrir héroïquement :
-
Du reste, au temps d’Homère, l’essence grecque était achevée ; la légèreté des images et de l’imagination était nécessaire pour calmer et libérer l’esprit démesurément passionné. La raison leur parle-t-elle, oh ! comme la vie leur paraît dure et cruelle. Ils ne s’abusent pas. Mais ils mentent pour jouer avec la vie : Simonide conseilla de prendre la vie comme un jeu : la douleur du sérieux leur était trop connue. La misère des hommes est une jouissance pour les dieux, quand on la leur chante. Les Grecs savaient que seul l’art peut faire de la misère une jouissance7.
Avec sa magie, l’homme calme la fureur des immortels, mais en même temps, cette magie le séduit lui-même et le transforme, car la douleur transformée en force et en une plus grande résistance est ce qui nous élève à la condition divine.

C’est ainsi que l’étude du monde préhomérique, duquel a surgit l’hellénisme, nous montre une époque sombre, pleine d’atrocités, de ténèbres et d’une sensualité funèbre, une période de cruauté, de crimes et d’implacables vengeances. L’originalité des Grecs consiste en ce que ce spectacle permanent d’un monde de lutte et de cruauté ne conduit pas au dégoût de l’existence, ni à concevoir celle-ci comme châtiment expiatoire pour quelque crime mystérieux qui toucherait aux racines de l’être. Ce pessimisme n’est pas le pessimisme grec. L’exemplarité des Grecs anciens consiste dans le fait d’avoir été capables de s’adapter à un monde enflammé par les passions les plus déchaînées, sans les réprimer ni les repousser. Leur pessimisme est le pessimisme de la force qui accepte comme légitimes tous les instincts qui font partie de la substance de la vie humaine en essayant de sublimer leur énergie. Et sur la base de cette affirmation initiale ils ont su construire une nouvelle mythologie et une culture fascinante : « Les ‘’dieux à la vie facile’’ sont le suprême embellissement que le monde ait reçu en partage ; comme il est difficile de le vivre dans le sentiment8. »
Ces dieux gardent une image avec des traits sombres, qui ne peuvent pas s’effacer complètement, mais qui fonctionnent comme de sublimes allégories qui ne résolvent pas les contradictions de la vie humaine en des intuitions rationnelles, claires et distinctes. Ce n’est qu’à l’époque de la décadence grecque que la pensée rationnelle, qui se veut affranchie du pathos de la mythologie et de la sensibilité religieuse, réduit l’image des dieux à une pure fantaisie mythique de poètes et d’artistes. Les dieux olympiens, ridiculisés par Xénophane, laissent la place au Nous d’Anaxagore, au Bien de Platon et à la tuchè d’Épicure. C’est ainsi que la sérénité grecque se dénature déjà dans la philosophie. Mais avant cela, le culte assume une extraordinaire fonction de formation, de spiritualisation des instincts en tant que forces naturelles dangereuses et de sublimation des impulsions violentes, sauvages et capables de détruire l’humanité de l’homme. La violence et la souffrance se transforment avec cette religion qui les sublime et cette sublimation est l’essence de la culture grecque, à l’opposé de la tâche d’apprivoisement de d’intoxication des instincts qu’accomplira le christianisme, comme tâche fondamentale de débilitation et de déformation de l’homme moderne.
1« Le culte religieux est à rapporter au fait d’acheter ou de mendier la faveur des divinités. Cela dépend du degré de crainte qu’on éprouve à l’égard de leur défaveur. - Par conséquent, là où l’on ne peut ou ne veut pas obtenir un succès par sa propre force, on cherche des forces surnaturelles : et donc à soulager la peine de l’existence. Quand on ne peut pas ou quand on ne veut pas réparer quelque chose par l’action, on demande grâce et pardon aux dieux, et l’on cherche donc à soulager la conscience oppressée. Les dieux ont été inventés pour la commodité des hommes : et finalement leur culte est la somme de tous les délassements et de tous les divertissements. » Fragments Posthumes 5 [150] 1875
2Fragments Posthumes 5 [165] 1875. Cf. FP 3 [17] 1875 : « la manière de voir sceptique : l’héllénité sera reconnue comme le plus bel exemple de la vie » ; cf. aussi FP 3 [65] 1875.
3PF 5 [150] 1875.
4« Presque tous les cultes comprennent un drame, une action mimétique, un fragment de mythe représenté qui se réfère à la fondation du culte ».
5FP 7 [139] 1870-1871.
6Nietzsche insiste sur le fait que, malgré tout ce qu’ils empruntent aux autres peuples, les Grecs font preuve de génialité pour l’originalité de l’interprétation et de l’élaboration de ce qu’ils reçoivent : « Les Grecs comme le seul peuple génial de l’histoire du monde ; ils le sont même comme élèves, ce qu’ils savent être mieux que quiconque parce qu’ils ne se contentent pas d’utiliser ce qu’ils empruntent pour le décor et la parure : comme le font les Romains. La constitution de la Polis est une invention phénicienne : même cela, les Hellènes, l’ont imité. Pendant longtemps, comme de joyeux dilettantes, ils ont appris d’un peu tout le monde d’alentour ; l’Aphrodite aussi est phénicienne. Au reste, ils ne désavouent pas du tout ce qu’ils ont d’importé et de non originel. » FP 5 [65] 1875.
7FP 5 [121] 1875 ; cf. aussi FP 5 [71] 1875.
8FP 5 [105] 1875.
18:40 Publié dans archéologie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, grèce antique, antiquité grecque, philosophie, esthétique, classicisme, antiquité gréco-romaine, hellénisme, hellénité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook